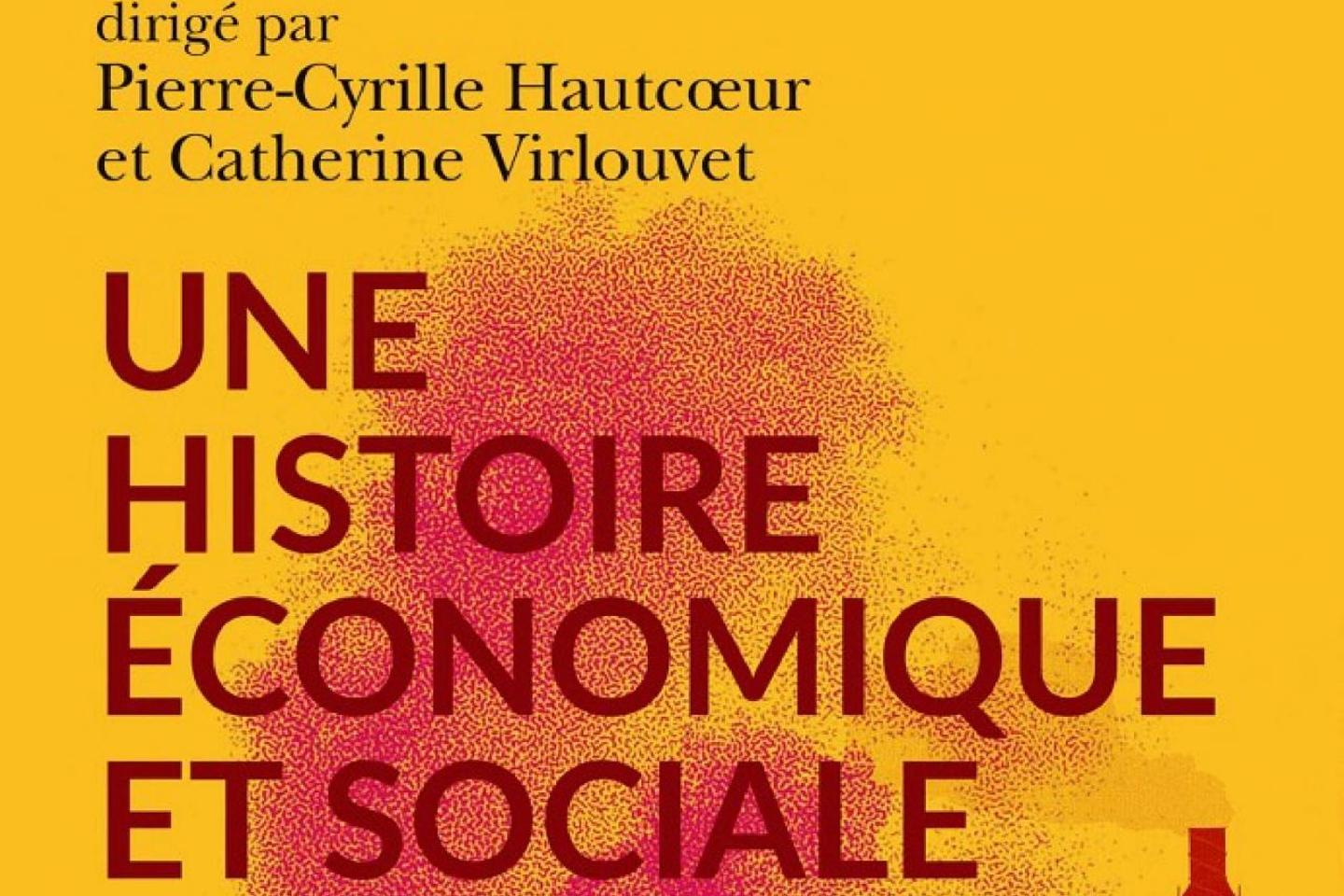On n’ouvre pas Une histoire économique et sociale. La France, de la Préhistoire à nos jours (Passés composés) comme un roman à lire d’une traite. Plus de 1 000 pages, 70 auteurs, plusieurs dizaines de milliers d’années d’histoire : le volume impressionne, mais il appelle davantage à la consultation qu’à la lecture linéaire. Conçu comme un ouvrage de référence, il le deviendra sans doute.
Par son ampleur et par son titre, il fait écho à la monumentale Histoire économique et sociale de la France publiée entre 1970 et 1982 sous la direction de Fernand Braudel (1902-1985) et Ernest Labrousse (1895-1988). A l’époque, l’histoire économique dominait la discipline. Tableaux et courbes fournissaient l’ossature d’un récit historique unifié, qui commençait au Moyen Age. Les séries de prix, de salaires, de rendements agricoles ou de données démographiques devaient fournir la clé scientifique des crises sociales et politiques.
Un demi-siècle plus tard, le ton a changé. Les ambitions se sont faites plus modestes, mais l’idée d’une histoire économique « attentive au sort du plus grand nombre » conserve sa force. Oubliées, les certitudes méthodologiques ou géographiques d’hier : l’histoire économique et sociale se nourrit certes encore de mesures et de chiffres, mais elle les prend désormais avec beaucoup de pincettes.
Aux séries longues, elle préfère les ordres de grandeur. Le souci « braudélien » de situer la France dans des dynamiques mondiales est plus que jamais d’actualité, mais l’ouvrage rejette tout regard trop « européocentré » : toute histoire est située. On ne raconte pas la même « histoire globale » selon qu’on la voit de Paris, Port-au-Prince ou Shanghaï.
A quatre mains
Ces précautions ne bannissent pas la synthèse, mais en redéfinissent les contours. Au lieu d’un récit unique, le projet prend la forme d’un chantier collectif où coexistent des approches diverses. Pour donner à cette polyphonie sa cohérence, les directeurs de l’ouvrage, Pierre-Cyrille Hautcœur, spécialiste de la période contemporaine (et chroniqueur au Monde), et Catherine Virlouvet, antiquisante, ont demandé que chaque chapitre soit rédigé à quatre mains : en croisant leurs regards, les auteurs de chaque tandem tressent la narration.
Il vous reste 58.03% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.