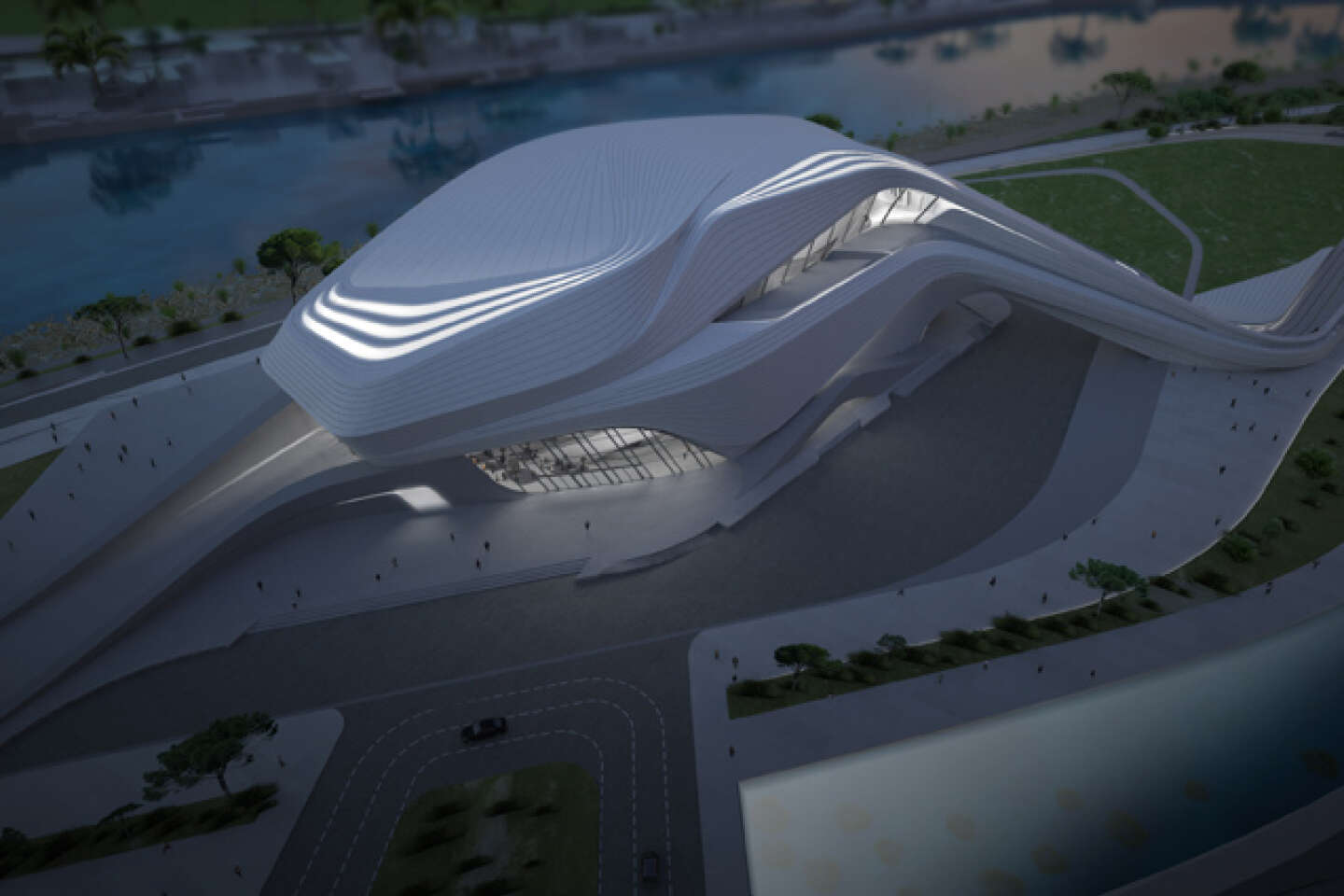Il ne faut pas manquer l’occasion de découvrir en salle, et en version restaurée, La Noire de…, prix Jean-Vigo 1966, coup d’essai et chef-d’œuvre du grand cinéaste sénégalais Ousmane Sembène (1923-2007). On parle généralement de ce film comme de l’acte de naissance du cinéma africain subsaharien, bien que son importance dépasse son seul statut historique. Voilà en effet une fable cinglante, qui a la concision d’une nouvelle et la force de frappe du fait divers, et qui, bien loin de jeter sur l’Afrique le regard attendu (sensibilisation et bonne conscience), vise au cœur de l’impensé colonial et du rapport de force métabolisé dans le quotidien.
Pour cela, on pouvait compter sur Sembène, qui, avant de s’emparer de la caméra, avait connu d’autres vies de combat : tirailleur dans l’artillerie coloniale, docker et syndicaliste à Marseille en 1946, militant anticolonial, enfin romancier autodidacte et reconnu, y compris par l’intelligentsia parisienne, avant d’apprendre le cinéma au VGIK, la célèbre école de cinéma soviétique, à Moscou, pour toucher plus de monde.
Dès son titre, La Noire de… a quelque chose de tranchant et d’énigmatique, suspendu à son complément d’appartenance qui laisse le spectateur au bord du vide, l’invitant à compléter par lui-même. Diouana (Mbissine Thérèse Diop), jeune nourrice sénégalaise d’un couple de Blancs, coopérants français, installée à Dakar, rejoint ses employeurs en vacances à Antibes, dans les Alpes-Maritimes, dans l’espoir de découvrir la France.
Jeu de contrastes
Mais, sur place, on lui confie des tâches ménagères qui n’ont plus rien à voir avec la garde des enfants, et ce, tous les jours de la semaine, sans repos, sans échappatoire. Diouana se retrouve piégée, transformée en bonne à tout faire, enfermée entre les murs de l’appartement. La France au-dehors est renvoyée au rang d’illusion inaccessible, de fausse promesse : « Est-ce ce trou noir qui est la France ? », dira-t-elle en scrutant la nuit par la fenêtre de la cuisine.
Dans un noir et blanc à la fois austère et minéral, le film investit cette situation minimale comme lieu de la persistance des relations coloniales, voire de la nouvelle donne biaisée entre Nord et Sud. Cela se traduit au niveau de la mise en scène par une foule de contrastes à l’ironie douloureuse, et de fines ruptures. Dès l’ouverture, où le paquebot blanc qui transporte Diouana accoste dans le port de Marseille, la jeune femme noire se distingue moins par sa couleur de peau que par son élégance – elle est habillée chic. Une fois dans l’appartement, elle n’est plus qu’un corps à domestiquer, à destituer de son apparat : on lui impose tablier et tenue de travail. Mais la présence rayonnante de Diouana continuera – contraste plastique – de se détacher sur la pâleur clinique des murs du logis. Un jeu de contrastes verbal s’installe également à travers l’usage de la voix off : celle-ci nous donne accès aux pensées de Diouana qui ne parle pas la langue de ses maîtres, dans une oralité à deux niveaux qui accentue son enfermement.
Il vous reste 38.51% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.