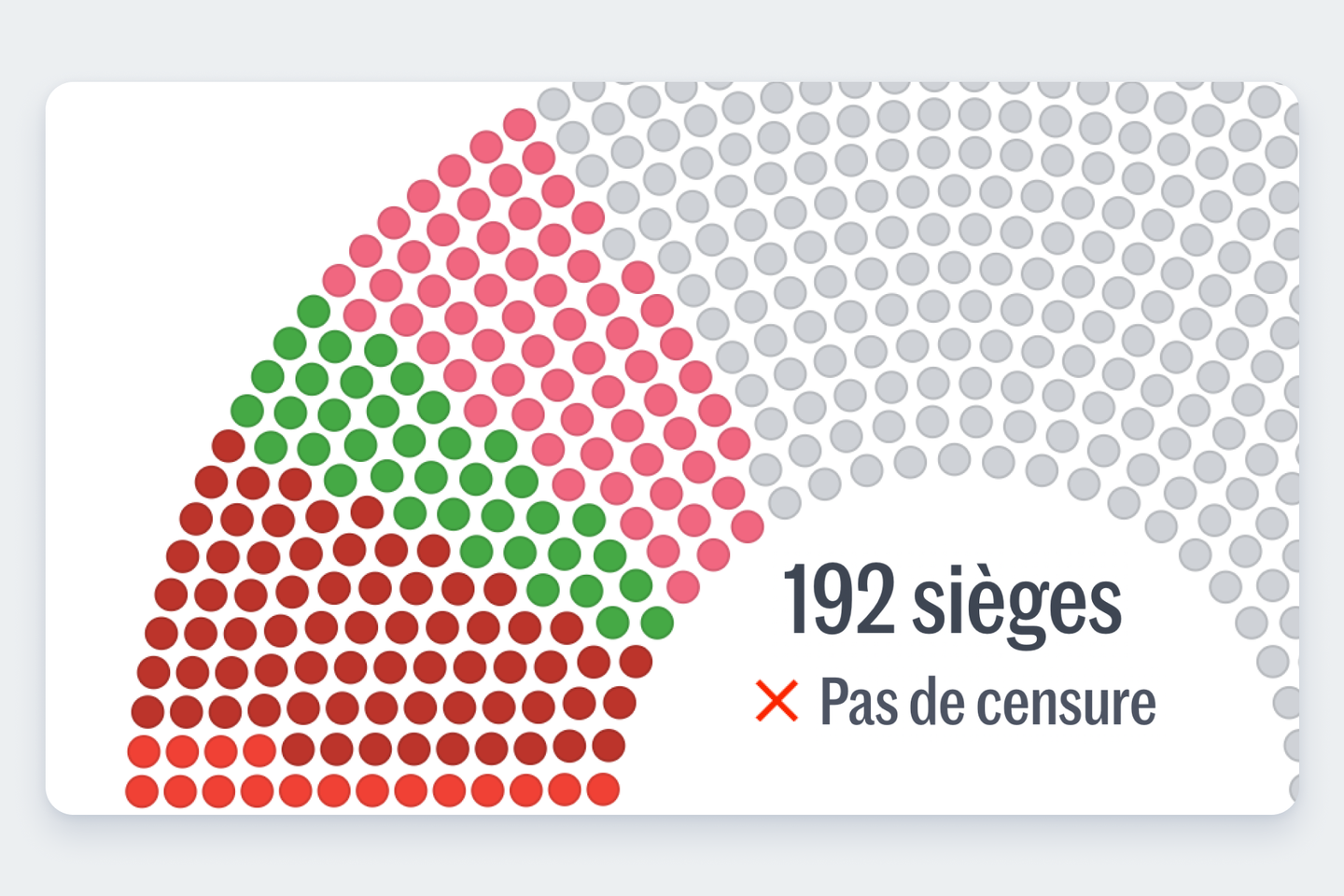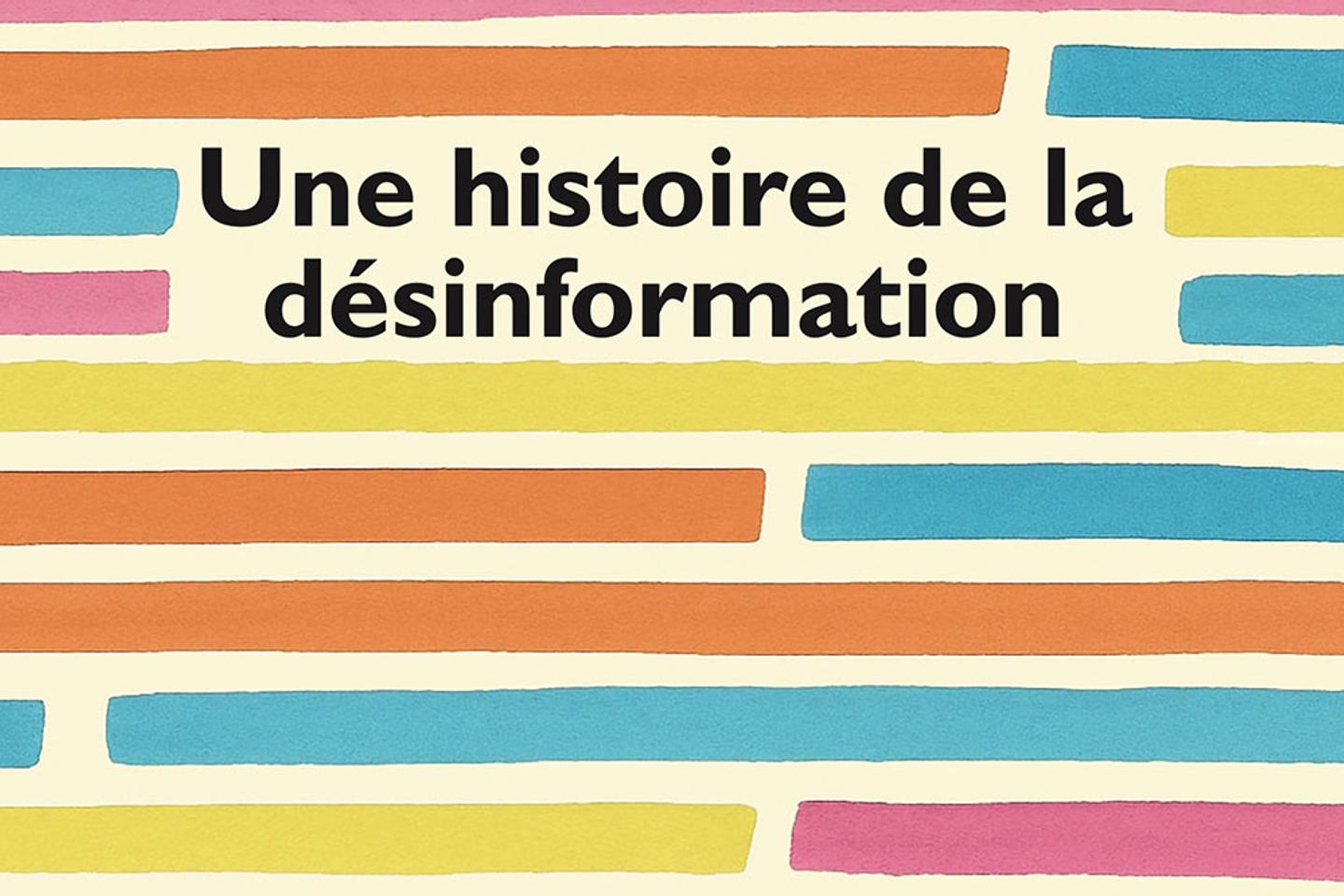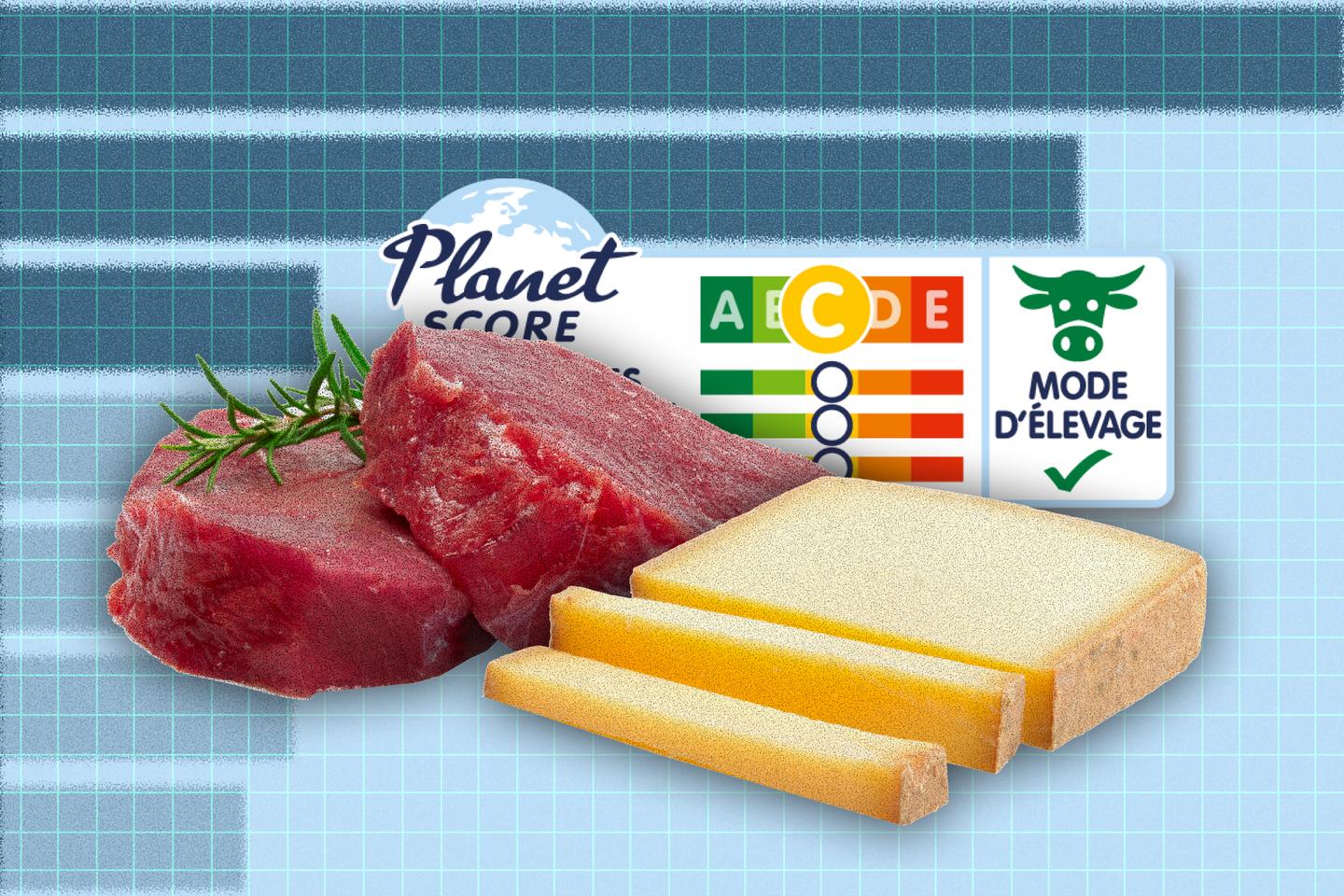En représailles à la guerre menée depuis le 7 octobre par Israël contre leurs alliés palestiniens du Hamas, les rebelles houthistes du Yémen ont multiplié les attaques visant l’Etat hébreu.
Membres revendiqués de « l’axe de la résistance », qui désigne les groupes armés ennemis d’Israël alliés avec l’Iran, les houthistes yéménites ont revendiqué plusieurs tirs de drones explosifs et de missiles balistiques, ainsi que des attaques de bateaux commerciaux et militaires mettant sous pression le trafic maritime en mer Rouge. Des actions qui illustrent leurs capacités de nuisance, mais surtout leurs ambitions régionales.
Face à ces attaques répétées, les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont mené début janvier 2024 plusieurs frappes visant des sites militaires tenus par les houthistes, qui font craindre une escalade dans la région.
Pourquoi ce groupe de rebelles, qui contrôle une bonne partie du Yémen, multiplie-t-il les attaques en mer Rouge ?
Qui sont les houthistes ?
Tirant leur nom du clan familial des Al-Houthi, les houthistes désignent un mouvement politico-militaire qui s’est développé dans les années 1990, dans le nord du Yémen, dans le gouvernorat de Saada, une province frontalière de l’Arabie saoudite. A l’inverse des deux tiers de la population yéménite qui sont d’obédience sunnite, les houthistes se réclament du zaïdisme, une branche minoritaire de l’islam chiite essentiellement implantée dans le pays.
Nostalgiques de l’imamat zaïdite, un régime politico-religieux longtemps en place au Yémen du Nord, qui a pris fin après la révolution républicaine de 1962, les houthistes partagent l’idée d’un renouveau de l’identité culturelle zaïdite. Une identité qui, selon eux, a été progressivement effacée par le pouvoir central, en particulier après l’unification du Yémen en 1990. Les houthistes se structurent alors autour des sentiments de marginalisation et de discrimination, d’une perte d’influence aussi bien politique, sociale et économique que religieuse. Ils perçoivent en effet comme une menace la diffusion de courants sunnites rigoristes, tels que le wahhabisme venu d’Arabie saoudite.
Ces griefs, auxquels s’ajoutent de complexes rivalités claniques, conduisent les partisans houthistes à s’opposer de plus en plus frontalement au pouvoir central. Au fil des conflits armés contre le régime au début des années 2000, du soulèvement populaire de 2011 et de la guerre civile commencée en 2014, les rebelles s’imposent progressivement comme les nouveaux maîtres du Yémen.
Aujourd’hui, ils contrôlent environ 30 % du territoire : une vaste partie au nord et à l’ouest du pays, le port de Hodeïda sur la mer Rouge et la capitale, Sanaa. Au total, les houthistes exercent leur autorité sur près des deux tiers de la population.
Comment sont-ils parvenus à étendre leur pouvoir au Yémen ?
Au début des années 2000, le mouvement dirigé par Hussein Al-Houthi, un ancien parlementaire entré en dissidence, apparaît progressivement comme l’unique force capable de remettre en cause la politique du régime. Les houthistes critiquent en particulier l’alliance conclue entre les Etats-Unis et le Yémen dans la lutte antiterroriste. Ils fustigent l’impérialisme américain et Israël, perçus comme de grandes menaces à la souveraineté du pays. Les slogans brandis par les partisans en témoignent : « Dieu est grand. Mort à l’Amérique, mort à Israël, la malédiction pour les juifs, la victoire pour l’islam. »
Le Monde
Soutenez une rédaction de 550 journalistes
Accédez à tous nos contenus en illimité à partir de 7,99 €/mois pendant 1 an.
S’abonner
Le dirigeant en place, le vieil autocrate Ali Abdallah Saleh, au pouvoir depuis 1978, s’inquiète de ce mouvement qui trouve un certain écho dans la population. Ce face-à-face entre forces gouvernementales et insurgés zaïdites débouche, à partir de 2004, sur un long conflit armé, appelé « guerre de Saada », au cours duquel Hussein Al-Houthi est tué. Sa mort contribue à radicaliser le mouvement.
A partir de 2011, dans le prolongement des printemps arabes, des manifestations populaires conduisent au départ du président Saleh. Les miliciens houthistes profitent de ce soulèvement pour renforcer leur contrôle territorial dans le nord du pays. L’ancien vice-président Abd Rabbo Mansour Hadi est alors chargé de conduire la transition qui doit aboutir à la rédaction d’une nouvelle constitution tenant compte de l’ensemble des forces du pays. Toutefois, le gouvernement se révèle incapable d’apporter une solution convaincante aux clivages politiques et communautaires et échoue à répondre aux aspirations de la population.
Les rebelles houthistes capitalisent sur cet échec et, grâce au soutien en sous-main de l’Iran et de l’ancien président Saleh, ils s’emparent de la capitale Sanaa en septembre 2014, puis du palais présidentiel quelques mois plus tard.
Ce coup d’Etat précipite l’internationalisation de la guerre civile. L’Arabie saoudite, où s’est réfugié le président déchu, prend en effet la tête d’une coalition militaire régionale en 2015 et s’engage à restaurer le gouvernement internationalement reconnu.
Mais le conflit s’enlise et la menace djihadiste gronde. Malgré la débauche des moyens dépêchés, l’Arabie saoudite ne parvient pas à modifier le rapport de force avec les houthistes et acte l’échec de sa coalition. Cherchant désormais à s’extirper de ce bourbier, Riyad ouvre la voie en avril 2023 à des négociations de paix avec les rebelles. Le bilan du conflit est très lourd : selon l’ONU, cette guerre a fait 400 000 victimes, notamment des civils. Le pays connaît actuellement « la plus grave crise humanitaire du monde », d’après l’Unicef.
Pourquoi les houthistes attaquent-ils Israël ?
Le groupe armé, qui a acquis son arsenal militaire avec l’aide de l’Iran, a toujours fait de la lutte contre Israël un marqueur idéologique. Les attaques récentes ne surprennent guère les spécialistes du conflit yéménite. « On pouvait s’attendre à ce qu’un groupe dont la formation idéologique anti-Israël et antiaméricaine n’est pas qu’un slogan prenne part à ce front, avec ou sans le feu vert de l’Iran », explique au Monde Farea Al-Muslimi, chercheur au centre de réflexion Chatham House (Londres).
Les rebelles houthistes mènent surtout une démonstration de force visant à accroître leur légitimité au sein de leur population, plutôt qu’à peser véritablement dans le conflit entre Israël et le Hamas. « Leur participation à la lutte contre Israël est une formidable opportunité d’unifier la population yéménite, qui est massivement propalestinienne mais subit sous leur règne la faim, la corruption et une gouvernance de style mafieux », précise encore le spécialiste du Yémen.
Tout en gagnant le soutien d’un peuple miné par une grave crise humanitaire, les rebelles espèrent aussi étendre leur influence dans la région et peser face à l’Arabie saoudite. Il s’agit d’une « stratégie calculée » dont l’objectif est de « faire pression sur les Américains » afin « d’accélérer la conclusion d’un accord avec les Saoudiens », assure à l’AFP Maged Al-Madhaji, cofondateur du think tank Sanaa Center for Strategic Studies.
Cette stratégie pourrait pourtant se retourner contre les houthistes. Après la capture du navire Galaxy Leader en mer Rouge au mois de novembre 2023, les Etats-Unis avaient annoncé qu’ils pourraient désigner à nouveau le groupe rebelle comme une « organisation terroriste ». Une décision qui, si elle était prise, pourrait faire obstacle à cette quête de légitimité.