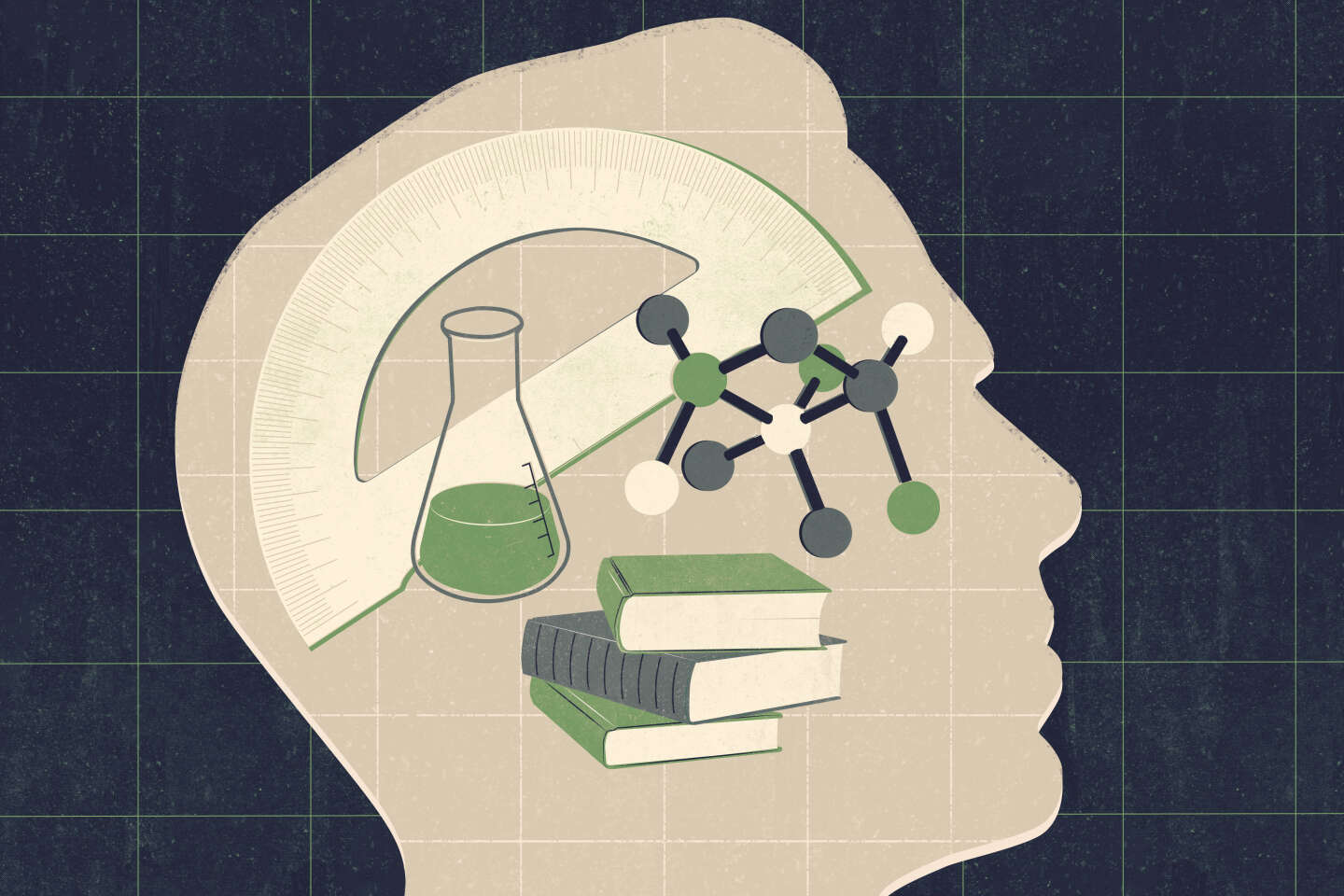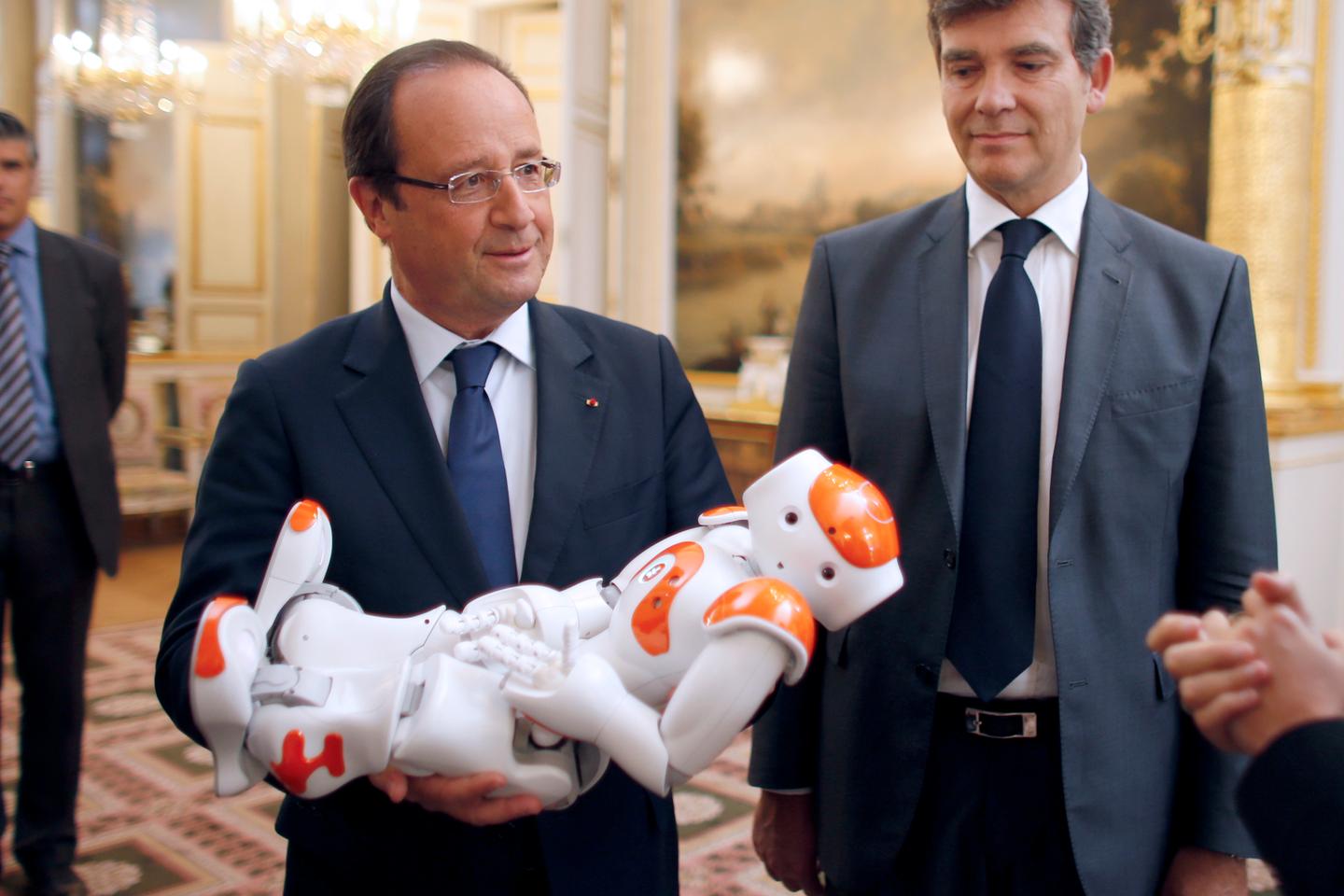C’est l’histoire d’un jeune homme de 19 ans atteint de drépanocytose, maladie hématologique causée par la mutation du gène de la bêta-globine, une protéine des
globules rouges chargée du transport de l’oxygène des poumons vers les tissus.
Si des transfusions sanguines soulagent les patients drépanocytaires, elles peuvent être associées à des effets secondaires importants et doivent être effectuées à vie. Le seul véritable traitement consiste en la greffe de cellules souches hématopoïétiques allogéniques, c’est-à-dire provenant d’un donneur compatible (« HLA compatible »).
Ce jeune patient est hospitalisé au centre médical universitaire d’Amsterdam (Pays-Bas)
pour recevoir une greffe de moelle osseuse provenant de son père. Conformément au
protocole, il reçoit également des transfusions fréquentes de globules rouges et de plaquettes. Il n’a auparavant jamais développé de réactions aux transfusions sanguines.
Le 13e jour après la greffe de cellules souches, il présente des nausées, des douleurs abdominales et un œdème facial quelques minutes après le début d’une transfusion de
plaquettes. Son état se dégrade rapidement, évoluant vers une défaillance cardio-pulmonaire, avec une diminution de la saturation en oxygène à 75 %, une chute de la tension artérielle (99/55 mmHg) et une tachycardie (123 battements cardiaques par minute), puis une perte de conscience. Aucune urticaire n’est observée.
La transfusion est interrompue. Le patient est traité par oxygénothérapie (15 litres par minutes), adrénaline par voie intramusculaire et antihistaminiques en intraveineux. Ses paramètres vitaux se normalisent immédiatement. Il reprend conscience.
L’auscultation des poumons exclut une pathologie pulmonaire aiguë. La température corporelle est d’ailleurs normale. Par ailleurs, aucune contamination bactérienne n’est trouvée dans le produit sanguin transfusé. Enfin, on ne détecte chez ce patient aucun anticorps anti-HLA ou anti-plaquettes, pouvant constitué un facteur d’agression qui pourrait donc expliquer la réaction post-transfusionnelle.
Le patient déclare à l’équipe soignante avoir eu une réaction grave un an plus tôt après avoir mangé des crevettes. Il avait souffert de nausées, douleurs abdominales, vomissements et développé un œdème de Quincke (également appelé angio-œdème, défini par un gonflement de zones situées sous la peau) et une urticaire. Il avait été traité par adrénaline et antihistaminiques. Depuis lors, ce jeune homme évite tous les fruits de mer.
À ce moment-là, Myrthe Sonneveld et ses collègues hématologues et médecins internistes émettent l’hypothèse que la réaction transfusionnelle de leur patient est due à des anticorps IgE (immunoglobulines E) et est possiblement liée à son allergie aux crevettes, étant donné la réponse immédiate à l’administration d’adrénaline.
Anticorps anti-tropomyosine, protéine immunogène de la crevette
Pour confirmer qu’il s’agit bien d’une allergie aux crevettes, les médecins demandent un dosage des IgE dirigés contre la tropomyosine, allergène majeur en cas d’allergie à cet aliment. Cette protéine, présente dans le cytosquelette des crustacés et des mollusques, peut être associée à de graves réactions allergiques. Chez ce jeune patient, les taux des IgE et de tropomyosine s’avèrent très élevés.
Sachant que les transfusions de plaquettes proviennent généralement de produits issus de cinq personnes ayant donné leur sang, les médecins néerlandais contactent tous les donneurs afin de se renseigner sur leur régime alimentaire dans les jours précédant le don. C’est alors qu’un donneur déclare avoir consommé un cocktail de crevettes la veille du jour où il a donné son sang.
Suite à cette réaction post-transfusionnelle sévère, le patient a été transfusé avec des concentrés de plaquettes d’aphérèse jusqu’à ce qu’il récupère sur le plan hématologique. La technique d’aphérèse, qui repose sur l’utilisation d’un séparateur de cellules, constitue le meilleur moyen d’obtenir des plaquettes en grande quantité à partir d’un seul donneur. « Nous avons sélectionné des donneurs de sang n’ayant pas consommé de fruits de mer pendant 10 jours avant le don », soulignent les auteurs de ce cas clinique rapporté en octobre 2024 dans EJHaem (eJournal of Haematology).
Cette observation montre donc qu’il importe d’évoquer, après exclusion d’autres causes, la possibilité qu’une réaction allergique sévère (anaphylactique) puisse se produire après une transfusion sanguine en réaction à un allergène alimentaire chez un patient qui y est sensibilisé et possède donc des anticorps IgE dirigés contre cet allergène.
La tropomyosine est résistante à la dénaturation par la chaleur et à la dégradation par les
enzymes digestives (protéases gastro-intestinales). Cette protéine peut être transmise par transfusion sanguine lorsque le sang est prélevé peu de temps après avoir consommé des crevettes, ce qui peut provoquer une réaction allergique grave chez un receveur sensibilisé possédant des anticorps IgE anti-tropomyosine.
Un cas de réaction anaphylactique sur 10 000 transfusions
Les réactions transfusionnelles anaphylactiques sont rares. Elles surviennent dans environ 1 cas sur 10 000 transfusions et sont le plus souvent liées à des transfusions de plaquettes.
Comme l’indiquent les auteurs de cette observation clinique, le produit initial de transfusion plaquettaire consiste en une suspension de globules rouges, de plaquettes et de plasma provenant du sang total, après quoi les plaquettes sont obtenues par centrifugation. Une réaction allergique transfusionnelle résulte de la liaison d’anticorps du receveur à certaines protéines plasmatiques du donneur. Elle est due à la présence chez le patient transfusé d’anticorps IgE, mais pas toujours. En effet, un déficit en anticorps IgA (immunoglobulines A) est la cause la plus fréquente d’une réaction transfusionnelle allergique. Chez ce patient, le
taux des IgA était normal.
Transfert passif d’un allergène alimentaire à un receveur allergique
En 2014, une équipe médicale du Centre médical de l’université Radboud de Nimègue (Pays-Bas) a rapporté dans The New England Journal of Medicine le cas d’un garçon de six ans, atteint de leucémie lymphoblastique aiguë, qui présentait une réaction anaphylactique grave (éruption cutanée, angio-œdème, chute de la tension artérielle, difficultés respiratoires) quelques minutes après le début d’une transfusion d’un culot leuco-plaquettaire, qui contient des plaquettes et des leucocytes (globules blancs).
La concentration de tryptase, mesurée immédiatement, était très élevée. En cas d’allergie sévère (anaphylaxie), une élévation de la tryptase sérique peut être mesurée dans les cinq minutes suivant la réaction allergique. Le bilan biologique avait permis d’exclure une réaction due à des anticorps anti-HLA.
À l’interrogatoire des parents, ceux-ci se sont souvenus que leur fils, à l’âge d’un an, avait développé une réaction anaphylactique, mais moins sévère, lors de la consommation d’arachide, aliment qu’ils avaient depuis spontanément écarté de l’alimentation de leur enfant. Aucun bilan allergologique n’avait cependant été réalisé.
Lors de son hospitalisation, les analyses biologiques ont détecté une sensibilisation importante à l’arachide. En outre, l’interrogatoire des cinq donneurs de sang a révélé que trois d’entre eux avaient consommé plusieurs poignées de cacahuètes le soir précédant le don.
Comme la tropomyosine de la crevette, l’allergène Ara h2 de l’arachide est extrêmement résistant aux enzymes digestives. Il peut passer dans la circulation sanguine du donneur et être transfusé, agissant alors comme un allergène alimentaire chez un receveur allergique. Le peptide allergisant peut être détecté dans le sérum jusqu’à 24 heures après l’ingestion orale. Sa taille est suffisamment importante pour qu’il se lie à des anticorps IgE et provoque une réaction allergique.
Toujours en 2014, des médecins chinois ont rapporté dans la revue Transfusion and Apheresis Science un cas d’allergie post-transfusionnelle en rapport avec une allergie aux crevettes. Il concernait un homme de 64 ans qui a développé un angio-œdème et une urticaire après avoir reçu une transfusion de plusieurs produits sanguins. Le patient était sensibilisé aux crevettes et l’un des donneurs de sang avait consommé des crevettes la nuit précédant le don de sang.
En 2013, des médecins allemands ont décrit dans Deutsche medizinische Wochenschrift le cas d’un enfant de 13 ans atteint d’un cancer osseux (ostéosarcome). Allergique à certains aliments, il avait développé une réaction post-transfusionnelle. Le bilan allergologique avait montré des résultats nettement positifs pour des IgE spécifiques à la carotte et au céleri, et moins élevés pour la noisette, l’arachide et un grand nombre d’autres antigènes alimentaires. Interrogé par les médecins, l’un des donneurs des concentrés plaquettaires transfusés s’est souvenu qu’il avait mangé des carottes et du chocolat aux noisettes au cours de la soirée précédant le don de plaquettes.
Premier cas associant allergie alimentaire et transfusion en 1942
La suspicion que des allergènes alimentaires puissent être responsables de réactions allergiques post-transfusionnelles remonte à un article publié en 1942 par deux médecins américains. Deux obstétriciens, Wendell Hughes et Arthur Martin, rapportent dans l’American Journal of Obstetrics and Gynecology le cas d’une femme qui présente des migraines sévères 6 à 8 heures après avoir ingéré du café, du chocolat, des pois, du sirop d’érable, du lait de vache, de la crème et du paprika. Le paprika a provoqué à trois reprises des sévères réactions d’œdème pulmonaire.
À l’époque, un des traitements de l’hyperémèse gravidique, caractérisée lors d’une grossesse par des vomissements incoercibles pouvant conduire à une déshydratation, consiste à transfuser la femme enceinte avec le sang de son mari. Lorsque cette femme enceinte a souffert d’hyperémèse, elle a été traitée par des injections de sang de son mari. Elle a alors commencé à présenter des crises migraineuses, similaires à celles liées à ses intolérances alimentaires.
Il a alors été découvert que son mari consommait régulièrement des aliments auxquels elle était sensibilisée, ce qui lui déclenchait un violent mal de tête deux à trois heures après les transfusions sanguines. Plus aucun incident n’a été observé après que le mari ait cessé de consommer ces aliments avant chaque transfusion programmée.
Pour en savoir plus :
Sonneveld ME, Bernelot Moens SJ, et al. Shrimp allergy leading to severe transfusion reaction : A case report. EJHaem. 2024 Oct 7 ;5(6) :1322-1324. doi : 10.1002/jha2.1021
Gao L, Sha Y, Yuan K, et al. Allergic transfusion reaction caused by the shrimp allergen of donor blood : a case report. Transfus Apher Sci. 2014 Feb ;50(1) :68-70. doi: 10.1016/j.transci.2013.09.016
Strobel E, Schöniger M, Münz M, et al. Allergische Transfusionsreaktionen bei einer Patientin mit multiplen Nahrungsmittelallergien [Allergic transfusion reactions in a patient with multiple food allergies]. Dtsch Med Wochenschr. 2012 Jul ;137(28-29) :1465-7. doi : 10.1055/s-0032-1305104
Jacobs JF, Baumert JL, Brons PP, et al. Anaphylaxis from passive transfer of peanut allergen in a blood product. N Engl J Med. 2011 May 19 ;364(20) :1981-2. doi: 10.1056/NEJMc1101692
Erick M. Food allergens and blood transfusions : a cause for concern ? Arch Intern Med. 2003 Aug 11-25 ;163(15) :1861. doi : 10.1001/archinte.163.15.1861-a
Hughes WL, Martin AC. Treatment of hyperemesis gravidarum with intramuscular injections of husband’s blood. Am J Obstet Gynecol. 1942 ;44 :103-108. doi : 10.1016/S0002-9378(42)91278-X