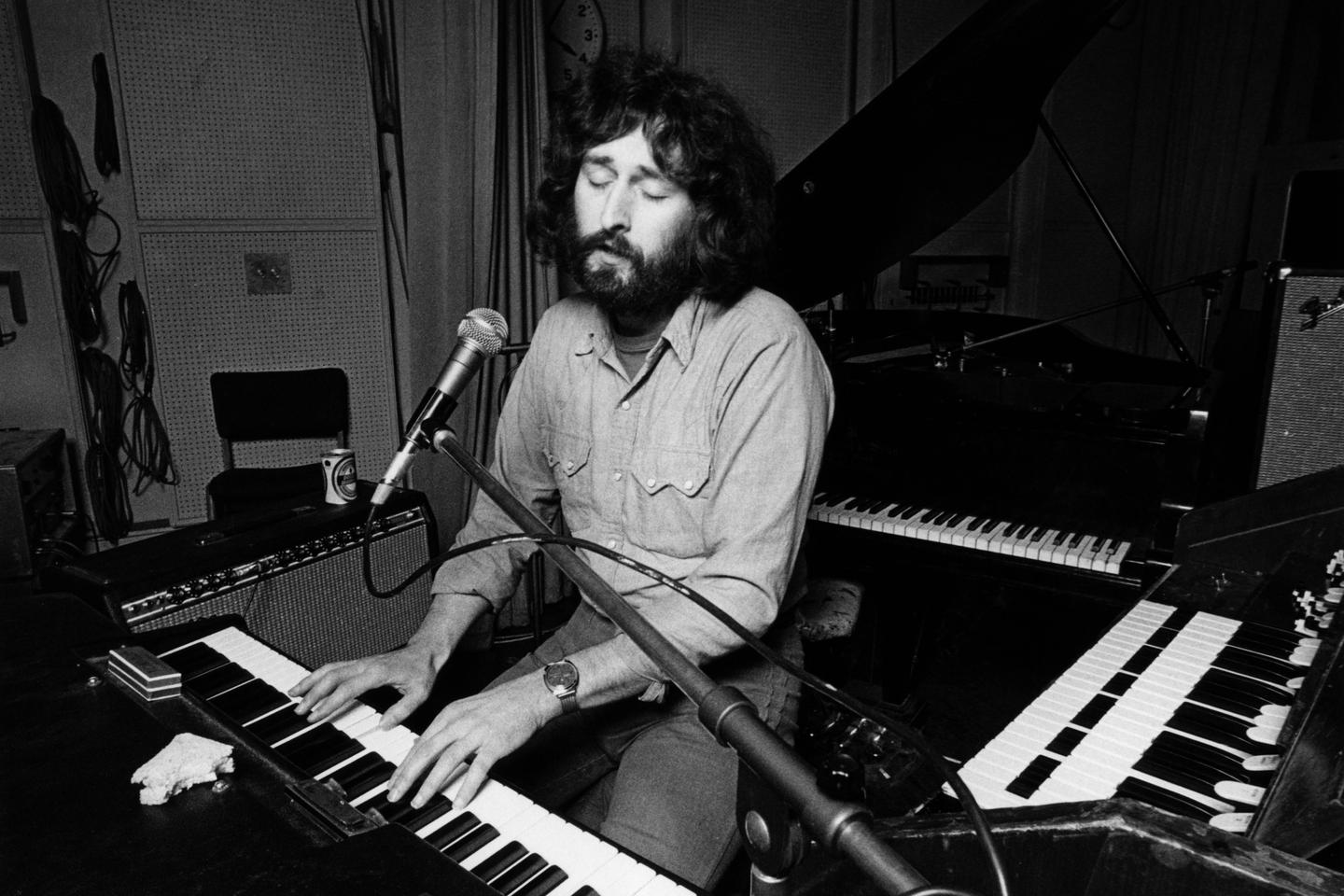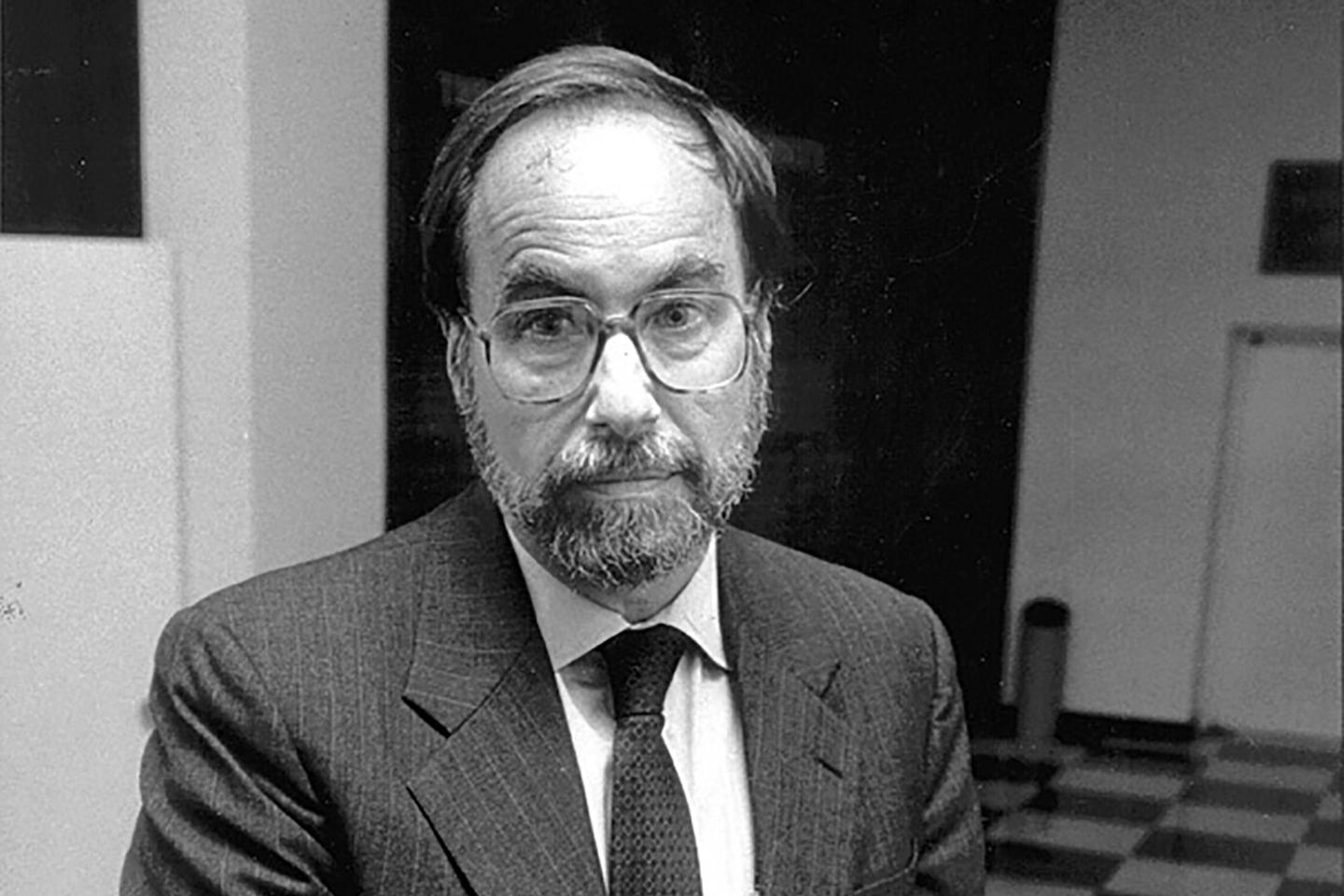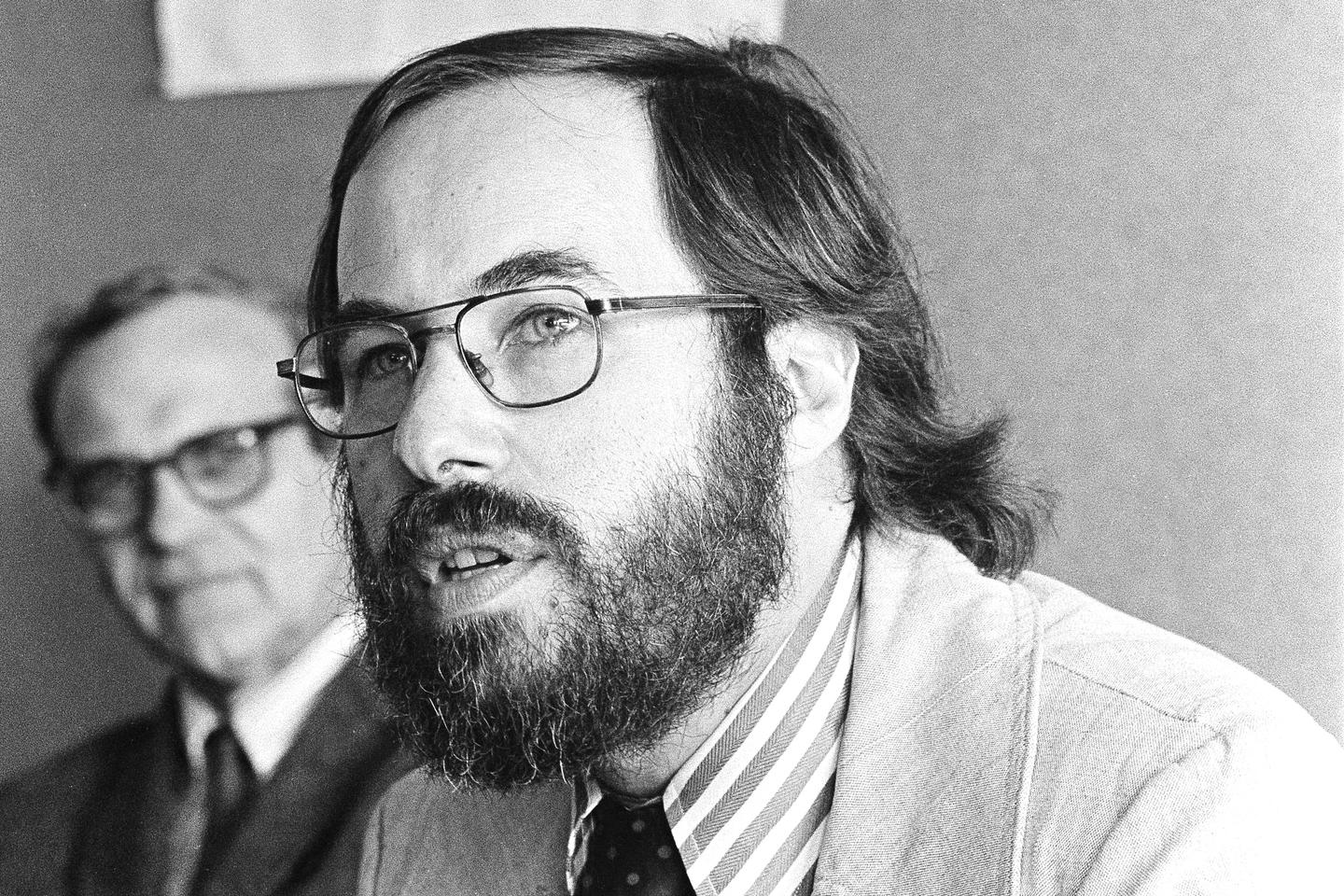C’est l’histoire d’un garçon de 14 ans qui développe une éruption cutanée, des bouffées de chaleur et une gêne respiratoire deux heures après avoir mangé un steak de thon frais légèrement grillé, acheté dans un marché de poissons voisin. Il n’est ni intolérant ni allergique au poisson. Son père en a consommé aussi, mais en moindre quantité.
Le jeune patient est conduit aux urgences après l’échec d’un traitement par antihistaminiques oraux. Malgré la prise de corticoïdes, son état s’aggrave : perte de conscience, urticaire, respiration sifflante, chute de la tension. Une injection d’épinéphrine, une perfusion, un bronchodilatateur en nébulisation et un apport d’oxygène à haut débit sont administrés.
Devant ce choc anaphylactique sévère, réfractaire au traitement, l’enfant est transféré dans une unité de soins intensifs pédiatriques où on lui administre des médicaments destinés à augmenter la pression artérielle, des corticoïdes et des antihistaminiques intraveineux. Ne présentant plus de symptômes, l’adolescent quitte l’hôpital le troisième jour.
Présence d’histamine dans la chair via une prolifération bactérienne
Cet enfant a souffert de scombrotoxisme, aussi appelé scombroïdose, une intoxication alimentaire causée par la présence d’histamine dans certains poissons, principalement des espèces à chair rouge appartenant à la famille des Scombridés (thon, thon jaune, thon listao ou bonite, maquereau, mahi-mahi), d’où le nom donné à cette intoxication. Il importe de souligner que d’autres familles de poissons, comme les Clupéidés (sardines, harengs) ou les Engraulidés (anchois), peuvent également provoquer ce type d’intoxication.
Si le poisson n’est pas conservé immédiatement après la pêche à une température inférieure ou égale à 0 °C, des bactéries Gram-négatives telles qu’Acinetobacter, Citrobacter, Enterobacter, Escherichia coli, Klebsiella, Morganella morganii, Proteus, Pseudomonas, Salmonella et Serratia, présentes dans les branchies et le microbiote intestinal, transforment l’histidine en histamine grâce à l’enzyme histidine décarboxylase lorsque la température de la chair dépasse environ 4,4 °C.
Ni la cuisson, ni la congélation, ne détruisent l’histamine thermostable
L’histamine résiste à la cuisson, au fumage, à la congélation et à la mise en conserve. Une fois ingérée, elle se fixe sur les récepteurs d’histamine, déclenchant des symptômes proches de ceux d’une allergie. L’intoxication scombroïde est sans doute sous-diagnostiquée et souvent confondue à tort avec une allergie au poisson. L’histamine se forme avant même que la détérioration du poisson ne soit perceptible.
Le taux d’histamine dans le poisson frais est normalement inférieur à 1 mg pour 100 g de chair. L’intoxication survient à des concentrations bien plus élevées, nécessitant au moins 50 mg/100 g pour provoquer un scombrotoxisme. Pour garantir une large marge de sécurité, la réglementation alimentaire européenne fixe une teneur maximale comprise entre 10 et 20 mg/100 g pour les produits frais. Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) limite ce taux à 5 mg pour 100 g de poisson. Dans ce pays, le scombrotoxisme représente environ 5 % de l’ensemble des intoxications alimentaires déclarées.
Ces dernières années, il a été suggéré que d’autres composés peuvent jouer un rôle dans l’intoxication scombroïde, notamment la cadavérine, la putrescine et l’acide cis-urocanique. Ce dernier est reconnu pour stimuler la dégranulation d’une catégorie de cellules immunitaires, les mastocytes, ce qui entraîne la libération d’histamine et augmente ainsi la concentration totale d’histamine dans les tissus du poisson. Alors que l’histamine provient de la décarboxylation de l’histidine, la cadavérine et la putrescine dérivent respectivement des acides aminés lysine et ornithine. Ces composés se forment rapidement en raison de la dégradation post-mortem des acides aminés du poisson.
Conserver la chaîne du froid
Pour éviter la prolifération bactérienne et la production d’histamine, il est essentiel de manipuler le poisson dans des conditions d’hygiène rigoureuses, en veillant particulièrement à sa conservation et à sa décongélation à basse température (pas plus de 6 °C), sans jamais interrompre la chaîne du froid.
Un refroidissement immédiat après la capture est crucial. Le maintien de basses températures de stockage et le respect de la chaîne du froid sont essentiels pour limiter la croissance bactérienne et prévenir les intoxications.
En résumé, le scombrotoxisme est une intoxication alimentaire de type chimique, caractérisée par des symptômes apparaissant généralement entre 10 minutes et 2 heures après la consommation de poissons contenant naturellement de fortes concentrations d’histidine. Il est donc crucial de conserver la chaîne du froid jusqu’à la consommation afin d’empêcher la prolifération bactérienne.
Des symptômes mimant une allergie
Après ingestion, l’histamine se fixe dans l’organisme sur des récepteurs spécifiques, entraînant une série de symptômes très similaires à ceux d’une réaction allergique. L’intoxication scombroïde est probablement plus fréquente qu’on ne le pense, mais souvent méconnue.
Il est facile de différencier une allergie d’une intoxication lorsque plusieurs convives présentent simultanément les mêmes symptômes, car il est peu probable que plusieurs personnes développent une allergie en même temps. En revanche, lorsqu’un seul patient est concerné, c’est généralement l’anamnèse (l’histoire clinique) qui permet de faire la distinction.
Des symptômes survenant habituellement dans les 10 à 30 minutes
Les symptômes se manifestent généralement par des rougeurs (flush) au niveau du visage, du cou et de la partie supérieure du thorax, accompagnées de bouffées de chaleur, de sueurs, de nausées, de vomissements, de diarrhée, de crampes abdominales, de maux de tête, de vertiges, de palpitations, d’une sensation de brûlure buccale et d’une baisse de la pression artérielle. On retiendra que tout poisson ayant un goût métallique, poivré ou piquant est à rejeter immédiatement.
Les symptômes surviennent habituellement dans les 10 à 30 minutes suivant la consommation de poisson. L’évolution est le plus souvent bénigne et se résout spontanément, en général en moins de 24 heures.
Les cas graves restent très rares. Un cas de collapsus vasculaire prolongé, menaçant le pronostic vital, a été rapporté en 2021 par une équipe américaine. La chair de poisson peut contenir d’importantes quantités d’histamine, générant un tableau clinique évoquant une anaphylaxie, comme dans le cas décrit en introduction de ce billet.
Ce syndrome peut parfois présenter des symptômes similaires à ceux d’un syndrome coronarien aigu, autrement dit d’un infarctus du myocarde. En effet, en plus de symptômes légers, certains patients présentent des signes cardiologiques tels que douleurs thoraciques, une hypotension et une anomalie du tracé à l’électrocardiogramme (élévation du segment ST), liés à un spasme coronaire. Ces situations sont généralement bénignes, mais peuvent parfois nécessiter un traitement adéquat en cas de chute importante de la tension artérielle.
Le diagnostic de scombrotoxisme repose soit sur le dosage des concentrations d’histamine dans le sang des patients, soit sur celui des concentrations en tryptase circulante. Ces composés, impliqués dans les réactions d’hypersensibilité immédiate, sont toujours élevés en cas de réaction allergique, alors que les taux de tryptase sont généralement normaux en cas de scombrotoxisme, qui – répétons-le – n’est pas une allergie. Ces dosages peuvent être réalisés en pratique courante, mais les prélèvements doivent être effectués peu de temps après un repas riche en histamine.
Le syndrome scombroïde est l’une des causes les plus fréquentes d’intoxication alimentaire liée à la consommation de poissons. Il a été décrit pour la première fois en 1799 en Grande-Bretagne, puis mentionné à nouveau dans la littérature médicale dans les années 1950. Par la suite, des flambées épidémiques ont été signalées aux États-Unis en 1968, au Japon en 1970 et en Grande-Bretagne en 1976.
Un diagnostic évoqué par une tolérance antérieure au poisson et des taux normaux de tryptase
Mais revenons au cas clinique rapporté par des médecins portugais. Les médecins du centre hospitalo-universitaire de Santo Antonio (nord du Portugal) ont évoqué une intoxication scombroïde, car leur jeune patient avait eu une forte réaction à un allergène qu’il tolérait auparavant et présentait un taux de tryptase normal. Une enquête rapide a permis de poser un diagnostic précis et d’entreprendre une prise en charge médicale adéquate.
Un diagnostic précis est essentiel pour localiser la source de la contamination et mettre en œuvre des mesures de santé publique rapides.
Après avis du département de santé publique, les conditions d’hygiène du marché aux poissons ont été évaluées, et un échantillon de thon congelé conservé par la famille a été envoyé pour analyse. Le marché respectait bien les bonnes pratiques d’hygiène. En revanche, le thon contenait 1 496 mg d’histamine par kg, ce qui a permis de confirmer le diagnostic d’intoxication scombroïde.
Poser un diagnostic correct pour éviter un régime restrictif inutile
Un diagnostic précis est crucial pour identifier la source de contamination et agir rapidement en termes de santé publique. En outre, cela permet d’éviter d’imposer au patient un régime trop restrictif et inutile. Ainsi, les patients non allergiques au thon ou à d’autres poissons pourront à nouveau en consommer sans problème, à condition qu’ils soient correctement conservés.
Trois cas de scombrotoxisme survenus en Italie méritent d’être racontés. Ils ont été rapportés en 2024 dans la revue La Clinica Terapeutica. Le premier concerne une jeune femme qui, environ 35 minutes après son repas, a soudainement ressenti une gêne respiratoire importante, avec bronchospasme, tachycardie, maux de tête, démangeaisons diffuses et
rougeurs sur le visage et le tronc, accompagnés d’un malaise général marqué. Son père, médecin biologiste, a rapidement interprété ces signes comme une réaction allergique et lui a administré des corticoïdes, un traitement antihistaminique et de l’oxygène. La patiente a ensuite été conduite aux urgences.
Le deuxième cas concerne le père, qui environ 30 minutes après avoir accompagné sa fille à l’hôpital, a ressenti un malaise avec de fortes douleurs gastriques, des nausées et un érythème diffus sur le tronc et le dos. Quelques heures après l’admission des proches, le fils, qui était resté asymptomatique dans la salle d’attente des urgences, a également ressenti un malaise, avec des rougeurs au visage et au tronc, accompagnés de tachycardie et de sueurs abondantes.
Une étude française rétrospective sur une décennie
En 2000, des médecins bordelais ont rapporté dans le New England Journal of Medicine le cas de neuf personnes ayant présenté un empoisonnement scombroïde entre 10 et 90 minutes après avoir partagé un repas contenant du thon cuit. L’analyse du thon a révélé des concentrations toxiques d’histamine dans un morceau, liées à une conservation inadéquate (6 kg de thon non vidé, stocké à 8 °C et consommé quatre jours après la pêche).
Publiée dans la revue Toxicologie Analytique et Clinique en 2023, une étude a rapporté l’expérience des Centres Antipoison de France sur une décennie (de 2012 à 2021 inclus) concernant cette « intoxication fréquente mais souvent méconnue ». Des cas de scombrotoxisme ont été identifiés chaque année. Il s’agissait dans 47 % des cas d’intoxications individuelles et dans 53 % des cas d’intoxications collectives. Au total, 173 repas concernant 543 patients ont été colligés.
Les symptômes sont apparus dans les 30 minutes suivant la consommation de poisson dans 50 % des cas, et dans les 75 minutes dans 89 % des cas.
Un signe de gravité, comme un effondrement de la pression artérielle (collapsus), n’a été observé que chez 3 patients sur 543. L’évolution de ces trois patients a été marquée par une amélioration rapide après des traitements symptomatiques, incluant l’administration d’adrénaline. Tous les patients ont rapidement récupéré sans séquelles, ce qui confirme que le scombrotoxisme, malgré un tableau clinique parfois impressionnant, ne pose pas de véritable difficulté de prise en charge lorsqu’il est correctement diagnostiqué.
Il ressort par ailleurs qu’il n’existe pas de véritable saisonnalité, avec des cas de scombrotoxisme observés tout au long de l’année. Les départements côtiers et du sud de la France sont plus concernés, mais l’ensemble du territoire y compris l’outremer peut être le théâtre de ce type d’intoxication.
Les données concernant l’origine du poisson indiquent que « 238 patients ont été intoxiqués à l’occasion d’un repas en collectivité, 131 l’ont été en mangeant au restaurant, 122 avaient acheté leur poisson en grande surface, 38 chez le poissonnier, pour 7 patients le poisson était issu de leur pêche personnelle, 4 se l’étaient procuré en boulangerie (sandwich au thon), et 3 l’avaient reçu par livraison (sushis) ».
Contrairement à une idée reçue, la consommation de poisson cru (tartare, ceviche, sushi) ne constitue pas un risque majeur de scombrotoxisme, notent les auteurs. En effet, dans la grande majorité des cas observés, le poisson était cuit, souvent grillé, voire longuement mijoté en sauce. Ces observations confirment également que l’histamine, thermostable, ne se dégrade ni à la cuisson ni à la congélation.
Un traitement médicamenteux par antihistaminique a été instauré pour 72 patients (87,8 %). En effet, le traitement du syndrome scombroïde repose uniquement sur l’administration rapide d’antihistaminiques, par voie orale, intramusculaire ou intraveineuse, selon la gravité des symptômes. Ce n’est qu’en présence de manifestations cliniques plus sévères (chute de la pression artérielle, complications cardiaques) que d’autres traitements sont indiqués.
Des corticoïdes ont été administrés chez 12 patients (14 % des cas). Les médecins des centres antipoison français soulignent que les corticoïdes n’ont pas leur place dans le traitement du scombrotoxisme, intoxication dans laquelle l’histamine provient directement d’une ingestion massive via le poisson contaminé, alors que dans une allergie, les corticoïdes agissent en empêchant la libération d’histamine produite par l’organisme. « L’emploi de corticoïdes, bien qu’inefficace, n’est pas dangereux et semble souvent rassurer patients et soignants. Le message de l’absence d’intérêt des corticoïdes dans cette intoxication semble tout particulièrement difficile à faire passer », reconnaissent Xavier Jarrige, Luc de Haro et ses collègues.
Au-delà de la question des traitements, il importe de réaliser que l’intoxication scombroïde représente une préoccupation majeure en matière de santé publique, d’autant que, soulignent-ils, « le scombrotoxisme reste de nos jours tout aussi fréquent qu’à la fin du siècle dernier. Un travail d’information du public et de formation des professionnels [de santé] est donc plus que jamais d’actualité ».
Pour en savoir plus :
Nogueira Oliveira J, Carvalho Queirós J, Calejo R, et al. La faute au thon ou au chef ? Enquêter sur une cause inhabituelle d’anaphylaxie. Rev Fr Allerg. 2025 May ;65(3) : 104224. doi : 10.1016/j.reval.2024.104224
Pallocci M, Messineo A, Passalacqua P, et al. Three cases of scombroid syndrome in Italy : clinical and preventive considerations. Clin Ter. 2024 May-Jun ;175(3) :92-95. doi : 10.7417/CT.2024.5049
Cheong T, Pothiawala S, David EK, Cooke VA. Scombroid poisoning : an anaphylaxis mimic. Singapore Med J. 2023 May 2. doi : 10.4103/singaporemedj.SMJ-2021-323
Jarrige X, Glaizal M, Sinno-Tellier S, et al. Scombrotoxisme : expérience des centres antipoison de France de 2012 à 2021. Toxicol Anal Clin. 2023 May ;35(2) :165-174. doi : 10.1016/j.toxac.2022.11.005
Eyer-Silva WA, Arteaga Hoyos VP, Nascimento L. Scombroid Fish Poisoning. Am J Trop Med Hyg. 2022 Mar 21 ;106(5) :1300. doi : 10.4269/ajtmh.21-1345
Lalmalani RM, Gan Hs J, Stacey S. Two Case Reports of Scombroid in Singapore : A Literature Review. Cureus. 2022 Feb 24 ;14(2) :e22580. doi : 10.7759/cureus.22580
de Gregorio C, Ferrazzo G, Koniari I, Kounis NG. Acute coronary syndrome from scombroid poisoning : a narrative review of case reports. Clin Toxicol (Phila). 2022 Jan ;60(1) :1-9. doi : 10.1080/15563650.2021.1959605
Katugaha SB, Carter AC, Desai S, Soto P. Severe scombroid poisoning and life-threatening hypotension. BMJ Case Rep. 2021 Apr 26 ;14(4) :e241507. doi : 10.1136/bcr-2020-241507
Colombo FM, Cattaneo P, Confalonieri E, Bernardi C. Histamine food poisonings : A systematic review and meta-analysis. Crit Rev Food Sci Nutr. 2018 May 3 ;58(7) :1131-1151. doi : 10.1080/10408398.2016.1242476
Harmelin Y, Hubiche T, Pharaon M, Del Giudice P. Trois cas de scombroïdose. Ann Dermatol Venereol. 2018 Jan ;145(1) :29-32. doi : 10.1016/j.annder.2017.07.007
Ridolo E, Martignago I, Senna G, Ricci G. Scombroid syndrome : it seems to be fish allergy but… it isn’t. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2016 Oct ;16(5) :516-21. doi : 10.1097/ACI.0000000000000297
Feng C, Teuber S, Gershwin ME. Histamine (Scombroid) Fish Poisoning : a Comprehensive Review. Clin Rev Allergy Immunol. 2016 Feb ;50(1) :64-9. doi : 10.1007/s12016-015-8467-x
Lionte C. An unusual cause of hypotension and abnormal electrocardiogram (ECG) — scombroid poisoning. Open Med 2010 ;5:292–7. doi : 10.2478/s11536-010-0003-z
Bédry R, Gabinski C, Paty MC. Diagnosis of scombroid poisoning by measurement of plasma histamine. N Engl J Med. 2000 Feb 17 ;342(7) :520-1. doi : 10.1056/NEJM200002173420718
Sinno-Tellier S, de Haro L. Intoxication à l’histamine : veillez à conserver vos poisons au frais ! Vigil’Anses 2022 ;17:1—4.