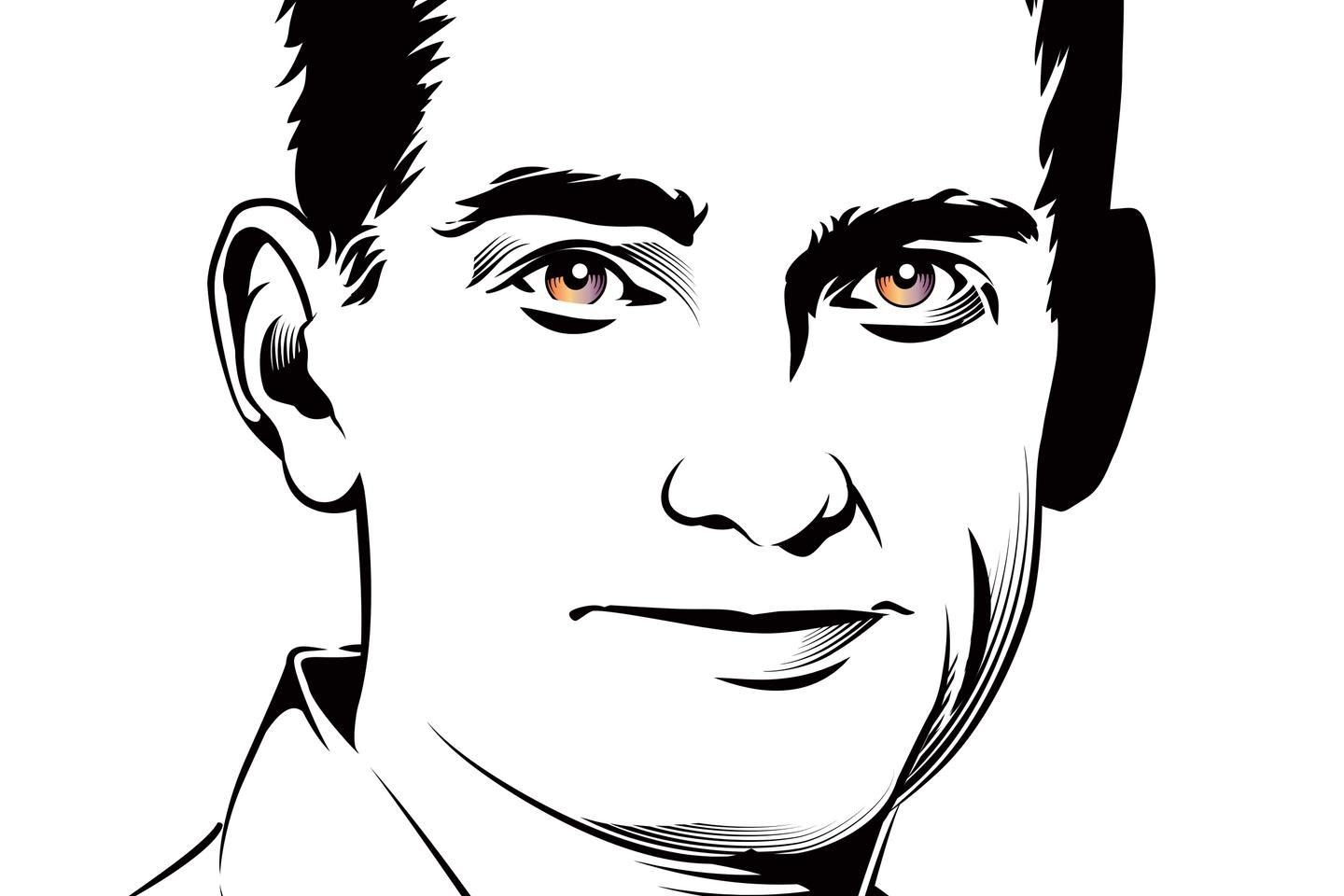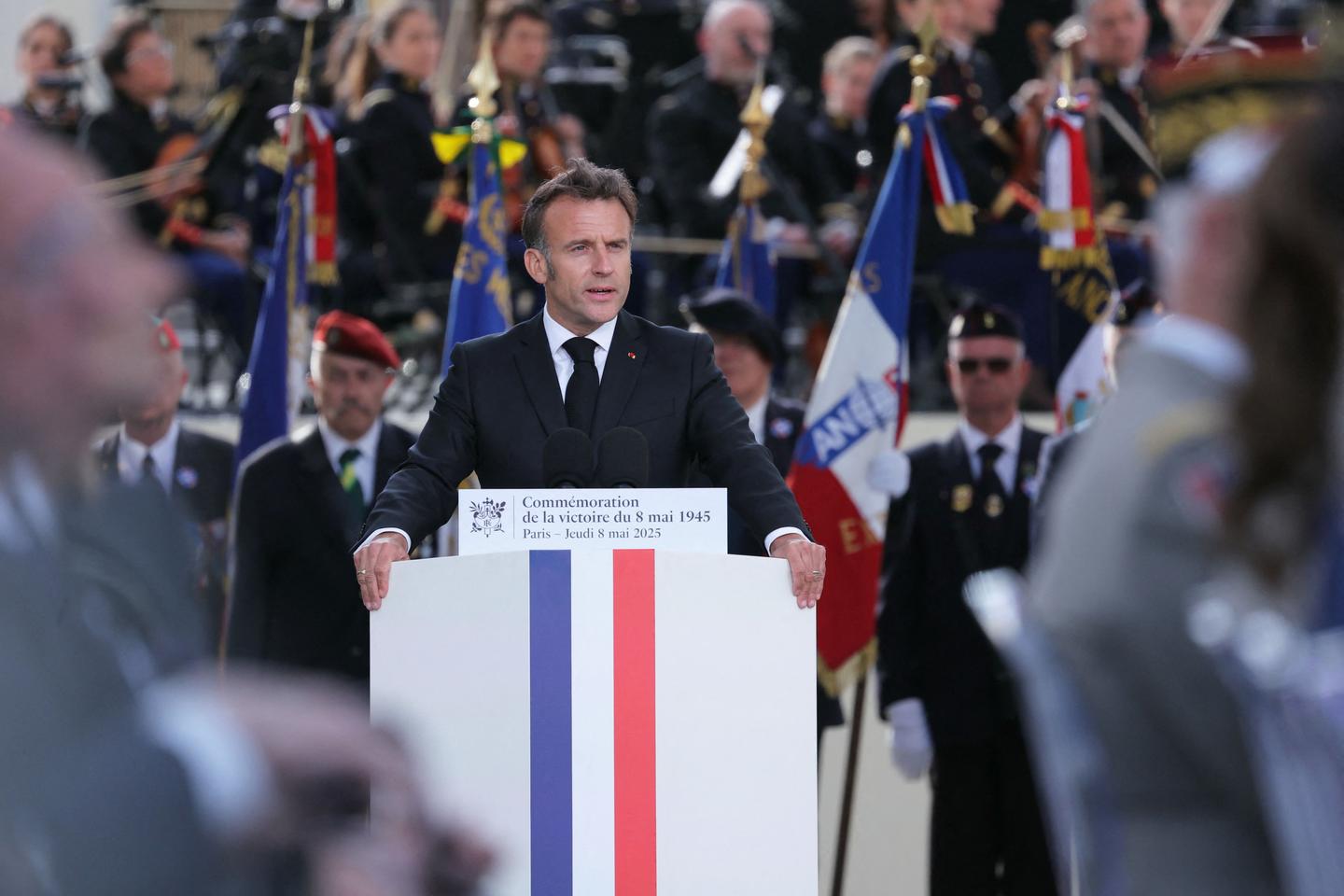Le sociologue et directeur de recherche à l’Ecole des hautes études en sciences sociales Arnaud Esquerre est l’auteur de travaux sur les sectes, la censure au cinéma ou les faits alternatifs. En 2022, il a cosigné avec le sociologue Luc Boltanski Qu’est-ce que l’actualité politique ? (Gallimard), une enquête sur les commentaires de l’actualité sur le Web, et en particulier ceux publiés sur Lemonde.fr. Dans son dernier ouvrage, Liberté, vérité, démocratie (Flammarion, 120 pages, 18 euros), il propose une réflexion sur les défis inédits auxquels fait face la liberté d’expression.
Votre essai part du constat qu’en matière de liberté d’expression deux discours contradictoires coexistent et semblent s’ignorer…
Je suis parti d’un étonnement : on entend d’une part que les fausses nouvelles prolifèrent, d’autre part que l’on ne peut plus rien dire. Non seulement dans l’espace entre l’extrême droite et la droite, mais aussi de l’autre côté du spectre politique, à l’extrême gauche ou au sein la gauche radicale. Pourquoi a-t-on ce sentiment, alors que l’on peut objectivement faire le constat inverse : il n’y a jamais eu autant de possibilités de s’exprimer, dans des espaces qui n’ont jamais été aussi nombreux ? Avec la multiplication des radios, des chaînes de télévision, puis, évidemment, à partir des années 2000 avec Internet, cette extension extraordinaire de l’espace public est inédite dans l’histoire. Le fait de considérer que l’« on ne peut plus rien dire » est en réalité concomitant à l’extension de l’espace d’expression.
Ce « sentiment » doit-il être qualifié de censure ?
Dans les Etats démocratiques, la censure institutionnelle – qui s’exerçait en France sur le cinéma par exemple jusque dans les années 1970 – a été abolie. Le terme lui-même n’est plus assumé par l’Eglise après Mai 68, ni par l’Etat à partir de Valéry Giscard d’Estaing, en 1974. En revanche, l’usage de ce mot a perduré, et on s’est mis à l’utiliser pour désigner autre chose. A la même époque a surgi l’idée d’« autocensure », à chercher en chacun de nous. Jacques Derrida [1930-2004] parle des « forces réprimées », des « choses qui ne peuvent pas se dire », à l’université par exemple. Chacun d’entre nous ne pourrait dire que des choses passées au tamis des normes sociales.
Il vous reste 49.39% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.