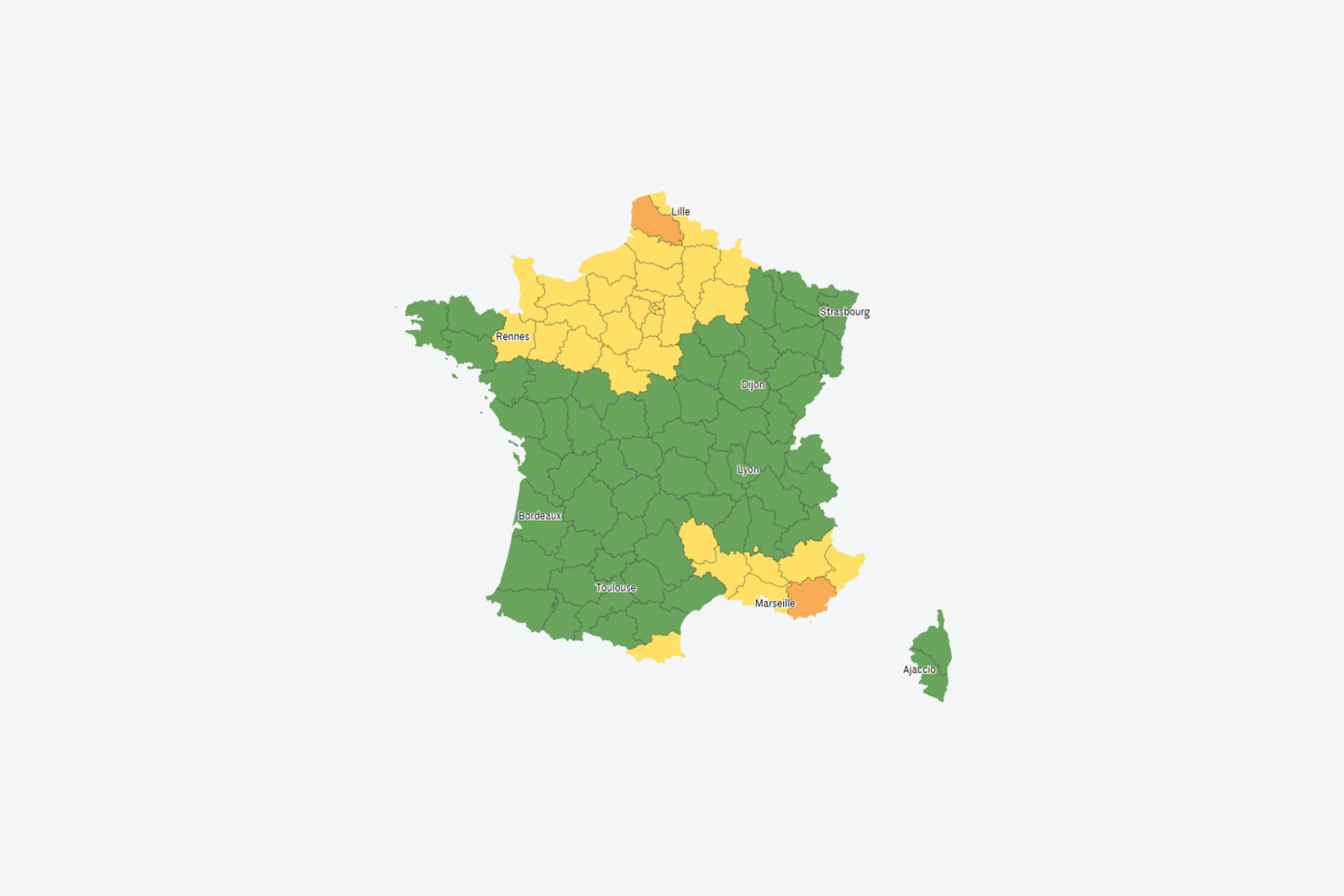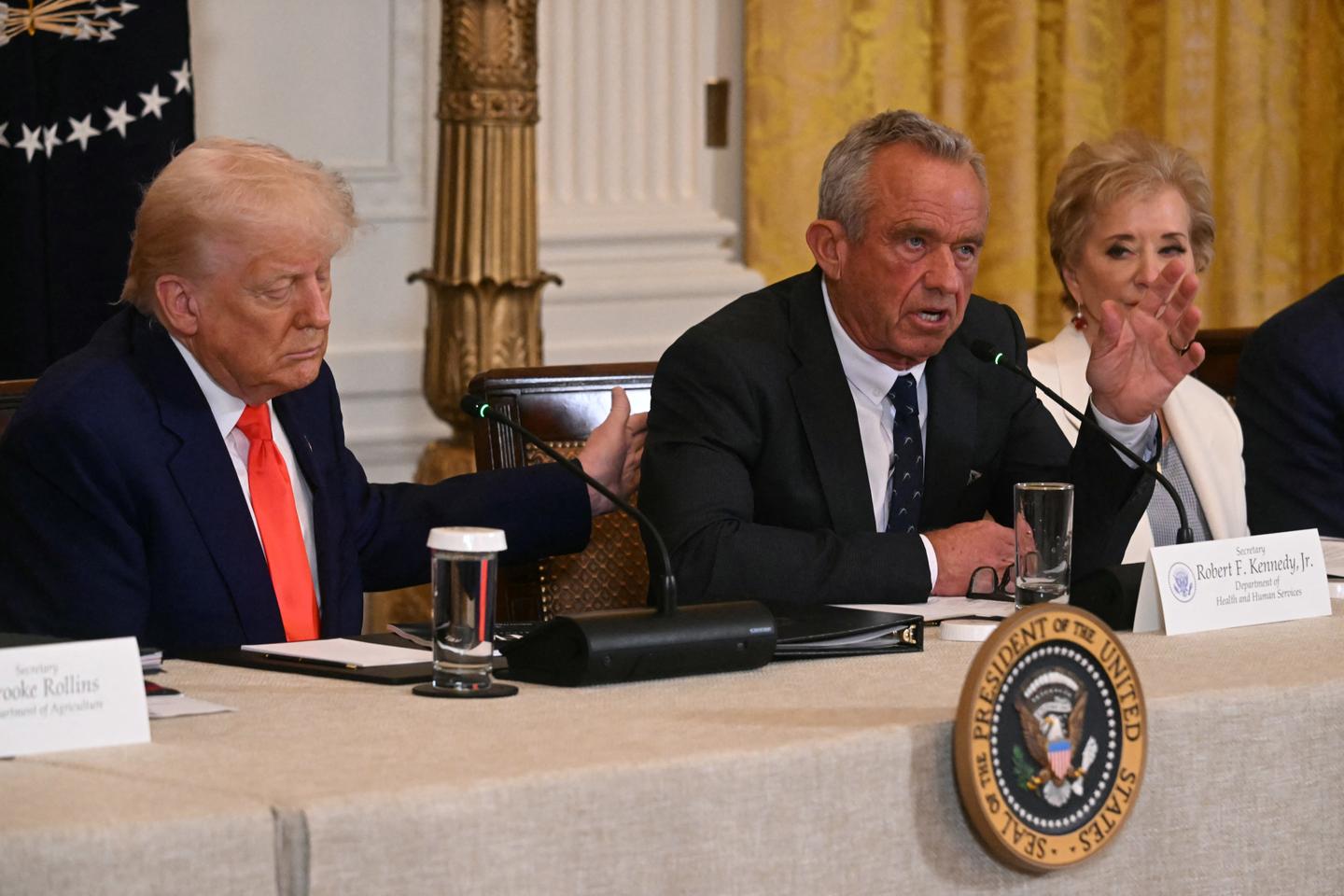Effets d’annonces, mauvaise volonté politique… Le chemin vers l’interdiction des polluants éternels, ces composants toxiques et persistants détectés dans l’intégralité de la population presque partout dans le monde, est semé d’embûches. La publication, mardi 9 septembre, de l’un des décrets d’application de la loi adoptée en France en février « visant à protéger la population des risques liés aux substances per- et polyfluoroalkylées », les PFAS, en est une nouvelle preuve.
Selon ce décret, les installations industrielles qui rejettent des PFAS dans l’eau doivent diminuer leurs émissions de 70 % d’ici à février 2028, pour atteindre 100 % en 2030. Mais le texte, laconique, « ne fixe aucune modalité de contrôle de ces rejets, ne précise pas si ces objectifs doivent être atteints à l’échelle de chaque installation industrielle, et ne décline qu’une seule étape », déplorent les ONG Générations futures et Notre affaire à tous.
Quelques jours plus tôt, à Bruxelles, la publication de la nouvelle feuille de route de l’Agence chimique européenne (ECHA) sur le projet d’interdiction des PFAS dans l’Union européenne (UE), qui a pour objectif de stopper les émissions de 10 000 de ces substances, avait suscité la consternation et la colère des ONG, des scientifiques et des riverains des sites pollués. Cette feuille de route contraste fortement avec la tonalité qu’avait voulu donner la présidence danoise de l’UE à son mandat début juillet. « Il est crucial de prendre dès maintenant des mesures énergiques contre la pollution par les PFAS dès maintenant », avait affirmé le ministre de l’environnement du Danemark, Magnus Heunicke.
Il vous reste 76.56% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.