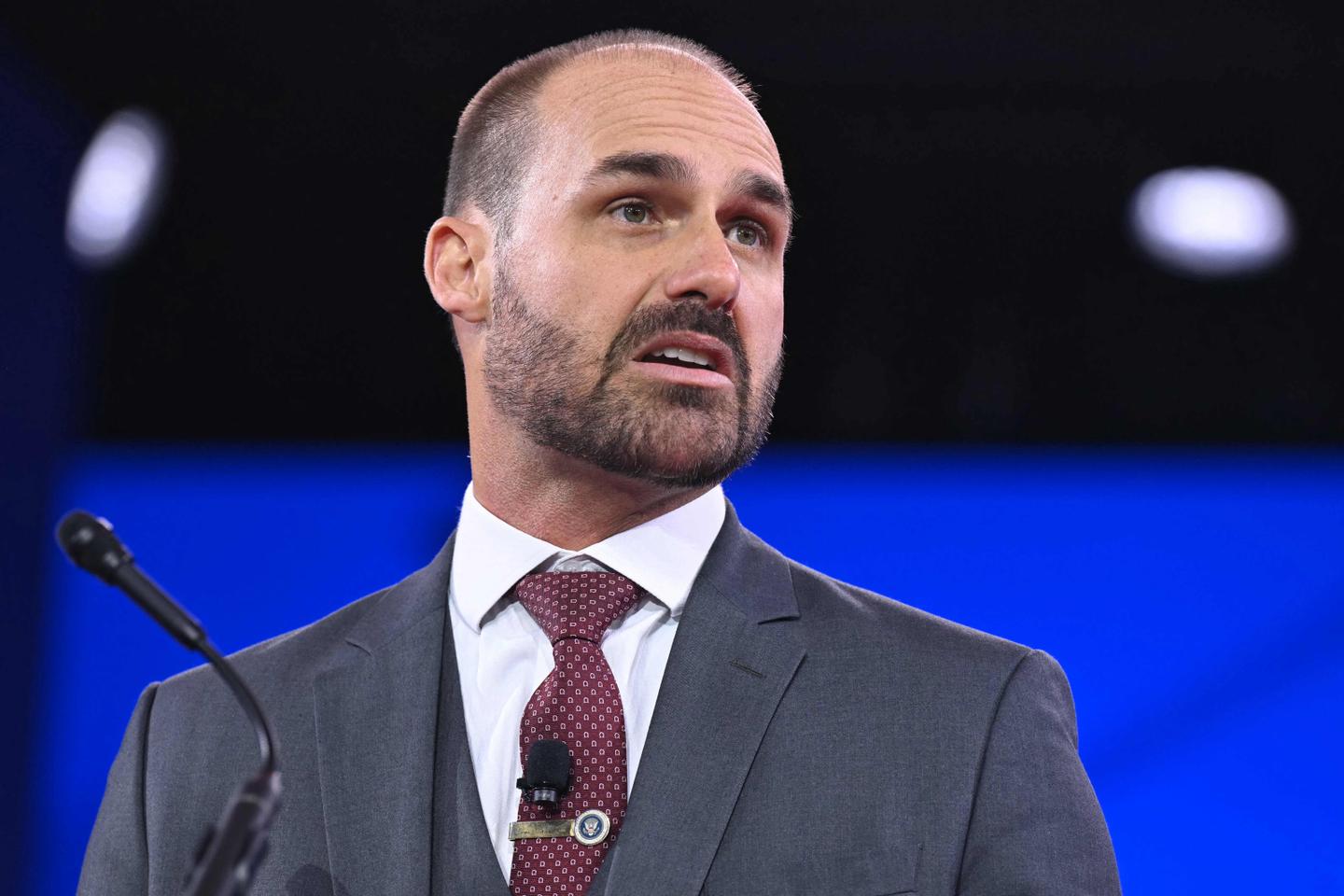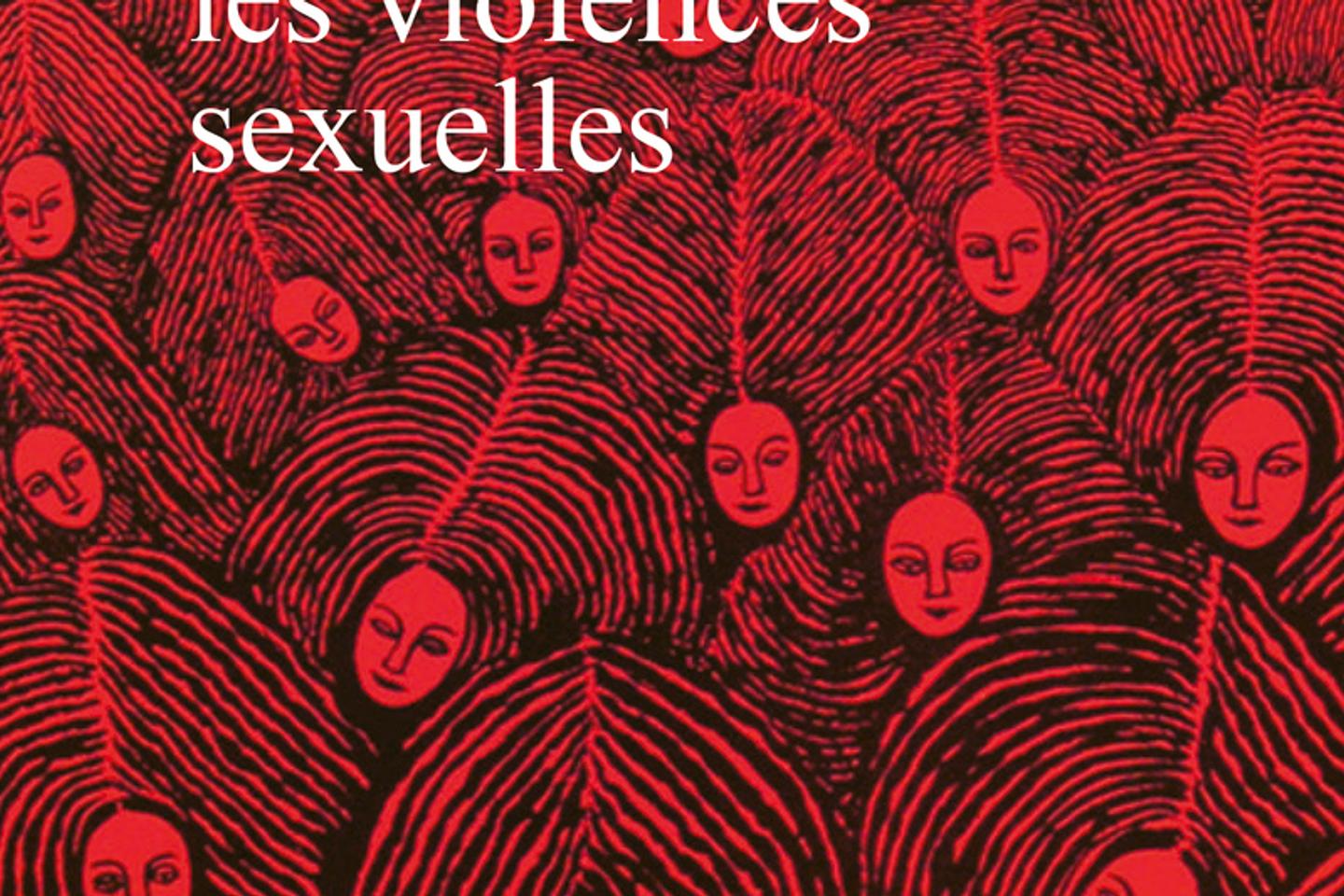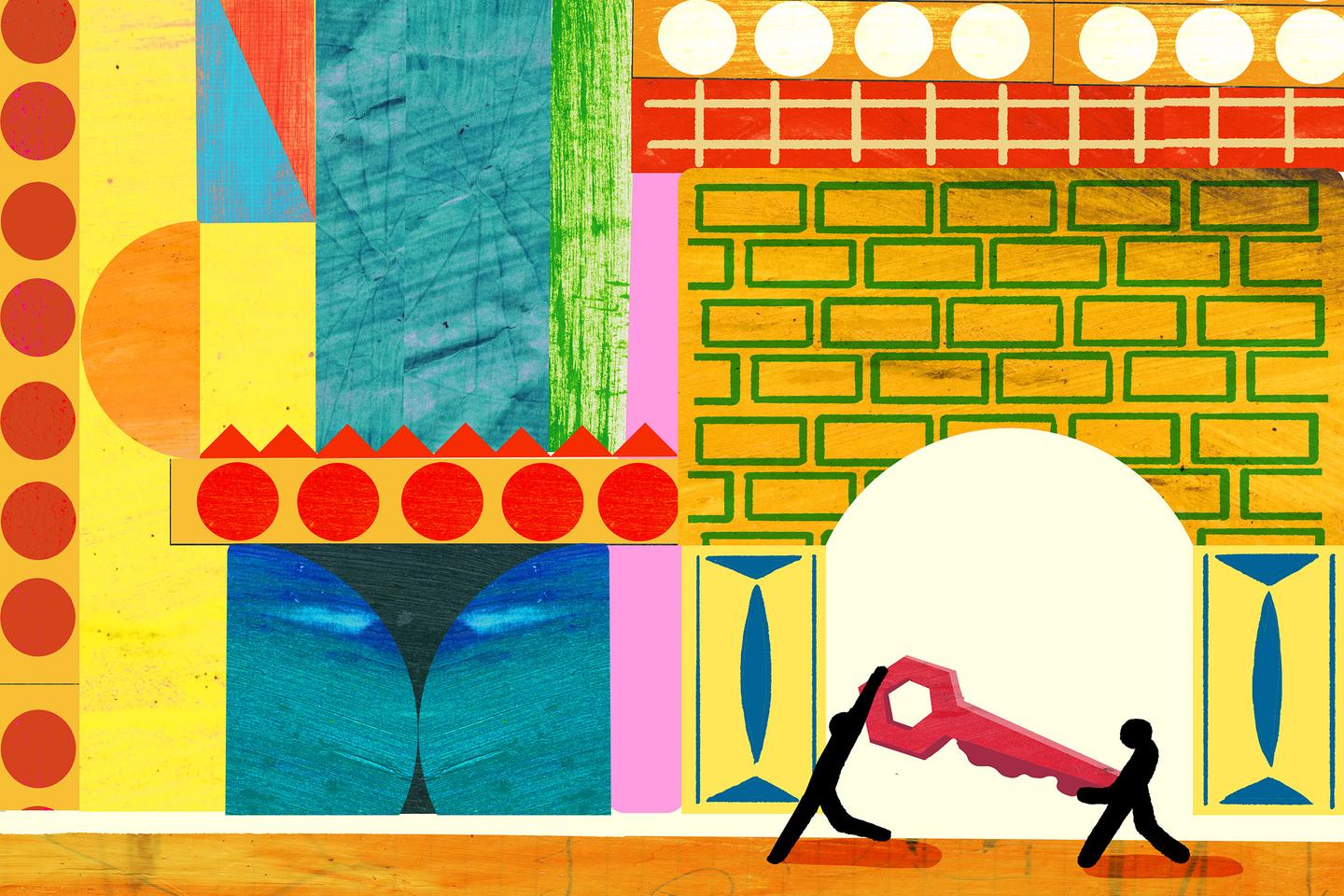Livre. « N’y a-t-il donc rien à penser dans ces trous noirs de nos vies ? » Les unes après les autres, les enquêtes le révèlent : les violences sexuelles sont un phénomène massif qui prospère à l’ombre des couples, des familles, des institutions, des entreprises, des sociétés – et dont la perpétuation est loin d’être enrayée, malgré la lumière crue jetée sur le sujet par #MeToo. Cette ubiquité aurait dû attirer l’attention de la philosophie politique qui, pourtant, ne s’est que peu saisie de cet objet. C’est à ce manquement que Marie Chartron entend remédier avec Penser les violences sexuelles (La Découverte, 342 pages, 22 euros), ouvrage issu de sa thèse de doctorat.
L’un des tout premiers gestes philosophiques de l’autrice sera, pour contrer un fatalisme encore trop répandu, de réaffirmer que les violences sexuelles ne sont pas « naturelles » et inéluctables, mais des phénomènes sociaux et politiques. En tant qu’« injustices sociales », celles-ci induisent une « responsabilité individuelle et collective, une nécessité éthique et politique » : il faut donc refondre les représentations et les organisations sociales pour mieux les prendre en charge et, ultimement, les faire cesser.
Mais pour remédier au mal, encore faut-il le comprendre. Protéiformes, les violences sexuelles doivent-elles être définies par leurs auteurs (en immense majorité des hommes), par leurs victimes (en grande majorité des femmes), par les actes perpétrés et leur localisation physique (pénétration, acte bucco-génital), ou par le contexte dans lequel elles interviennent (couple hétérosexuel, liens de parenté) ? Il s’agit, pour Marie Chartron, de relever le défi de « construire une pensée des violences sexuelles qui les tienne ensemble » – et ne laisse personne sur le carreau.
L’exercice est infiniment plus délicat qu’il n’y paraît, et embarque le lecteur dans une enquête philosophique exigeante prenant son point de départ dans les premières théorisations des violences sexuelles par les féministes des années 1960 et 1970. A cette époque, aux Etats-Unis puis en France, au sein de groupes de parole, les femmes mettent en commun leurs expériences, et prennent conscience du fait que les violences sexuelles qu’elles subissent ne sont pas des exceptions isolées mais une réalité commune.
Il vous reste 56.36% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.