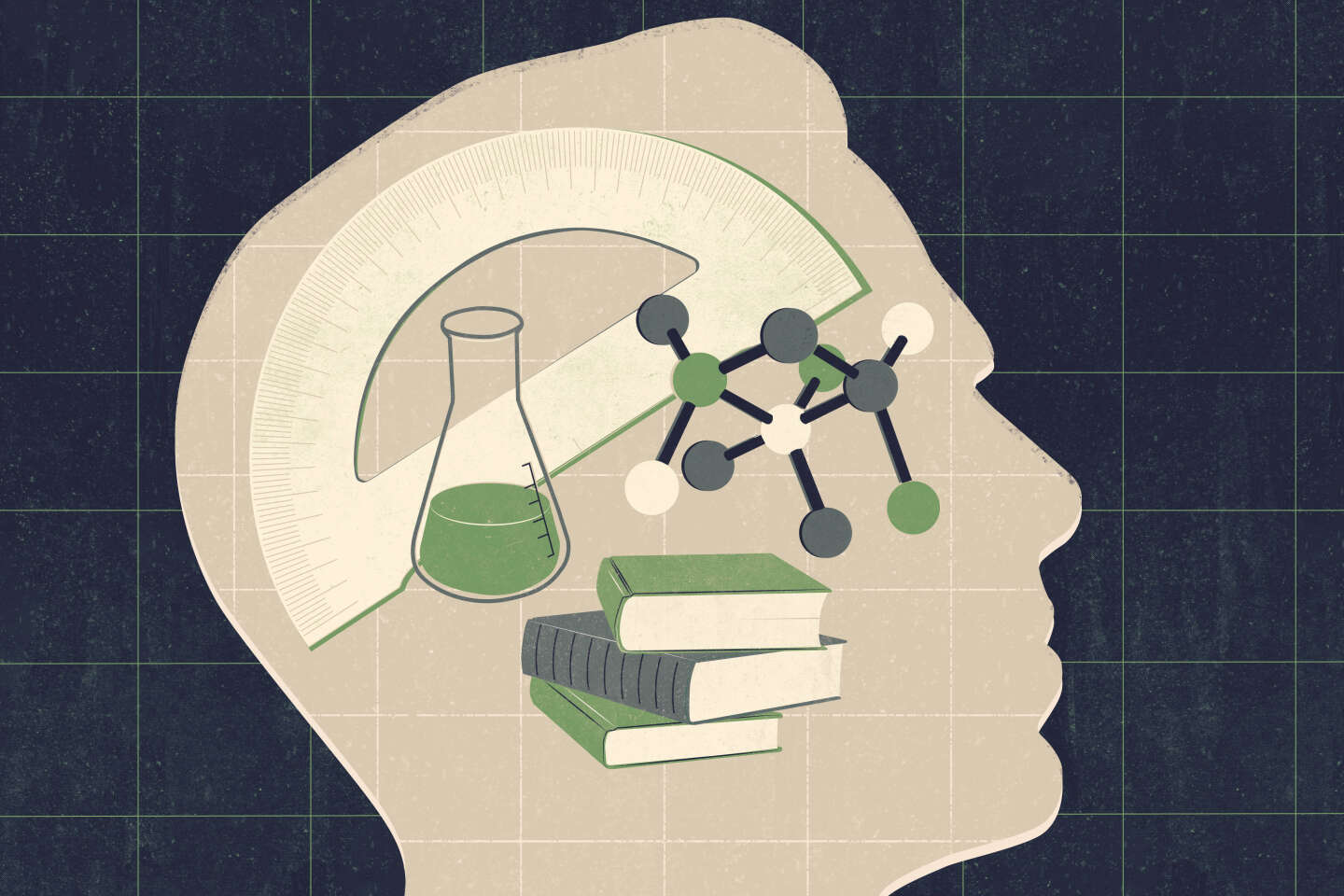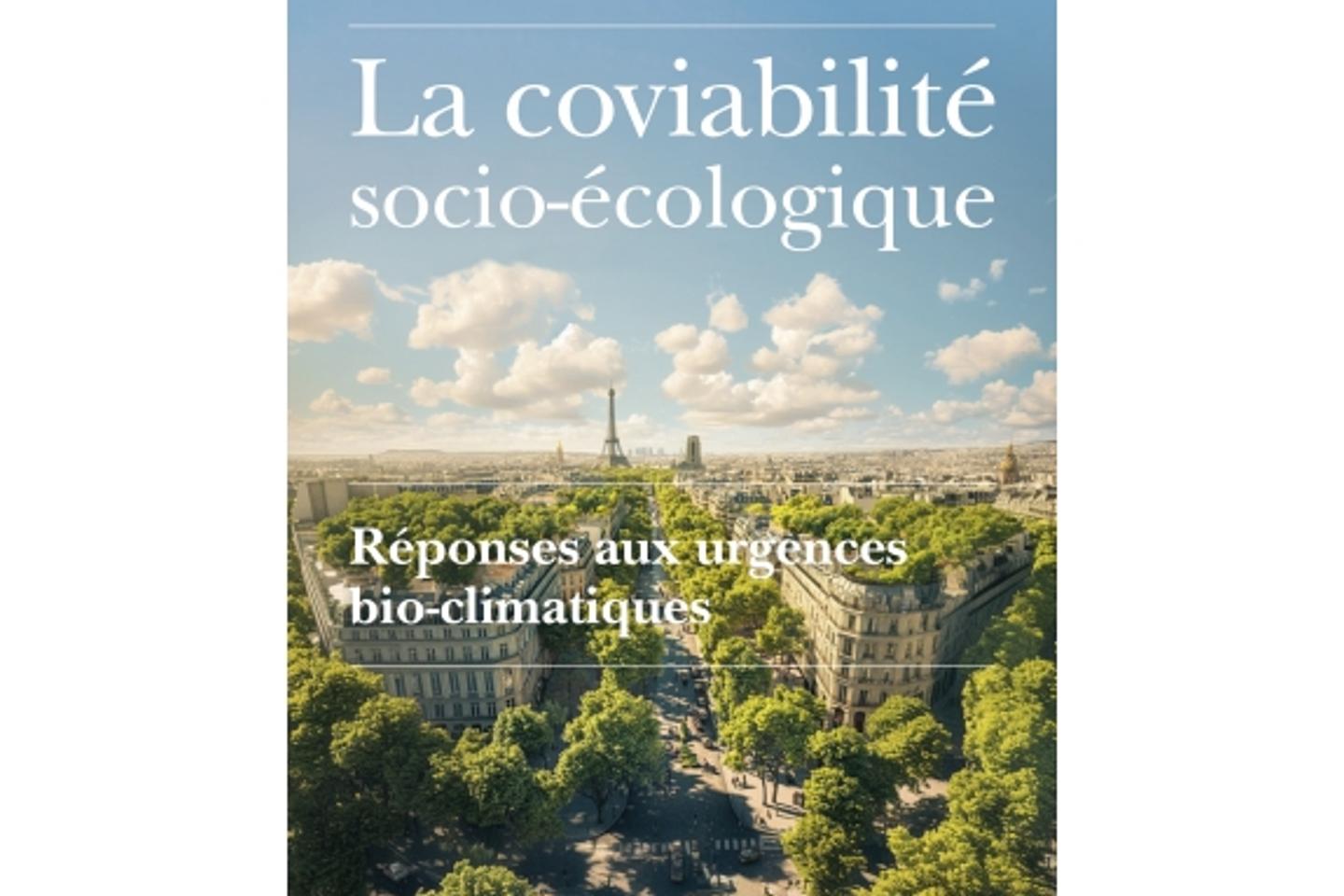Il a beau avoir oublié, cet après-midi, de glisser ses bottes en caoutchouc dans son coffre, Brice Mouras s’avance dans son champ, bottines de ville aux pieds. « Je vais pouvoir tester en direct la qualité du sol », lance l’agriculteur, faisant visiter ses parcelles à Banogne-Recouvrance, dans les Ardennes. Sous une épaisse purée de pois et malgré la forte humidité hivernale, les pieds ne s’enfoncent pas. « On voit que le sol ne colle pas, l’eau s’infiltre directement », constate, satisfait, l’exploitant de 47 ans, qui cultive sur les 155 hectares de la ferme familiale blé, orge, colza, lentilles, pois, seigle, sarrazin, soja et miscanthus.
Depuis plusieurs années, le céréalier, qui cultive aussi 20 % de ses surfaces en bio, s’attache à maintenir des couverts végétaux et à ne plus labourer ses champs. « J’ai baissé de plusieurs dizaines d’unités mon utilisation d’engrais, détaille-t-il. Je consomme deux fois moins de carburant pour mon tracteur et mon poste phytosanitaires a lui aussi fortement baissé : – 70 % sur les insecticides. » Seule substance qui reste, aux yeux de M. Mouras, indispensable à son activité : le glyphosate, qui lui permet de désherber ses parcelles avant de resemer – une substance active controversée, classée cancérogène probable par le Centre international de recherche sur le cancer.
Il vous reste 88.73% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.