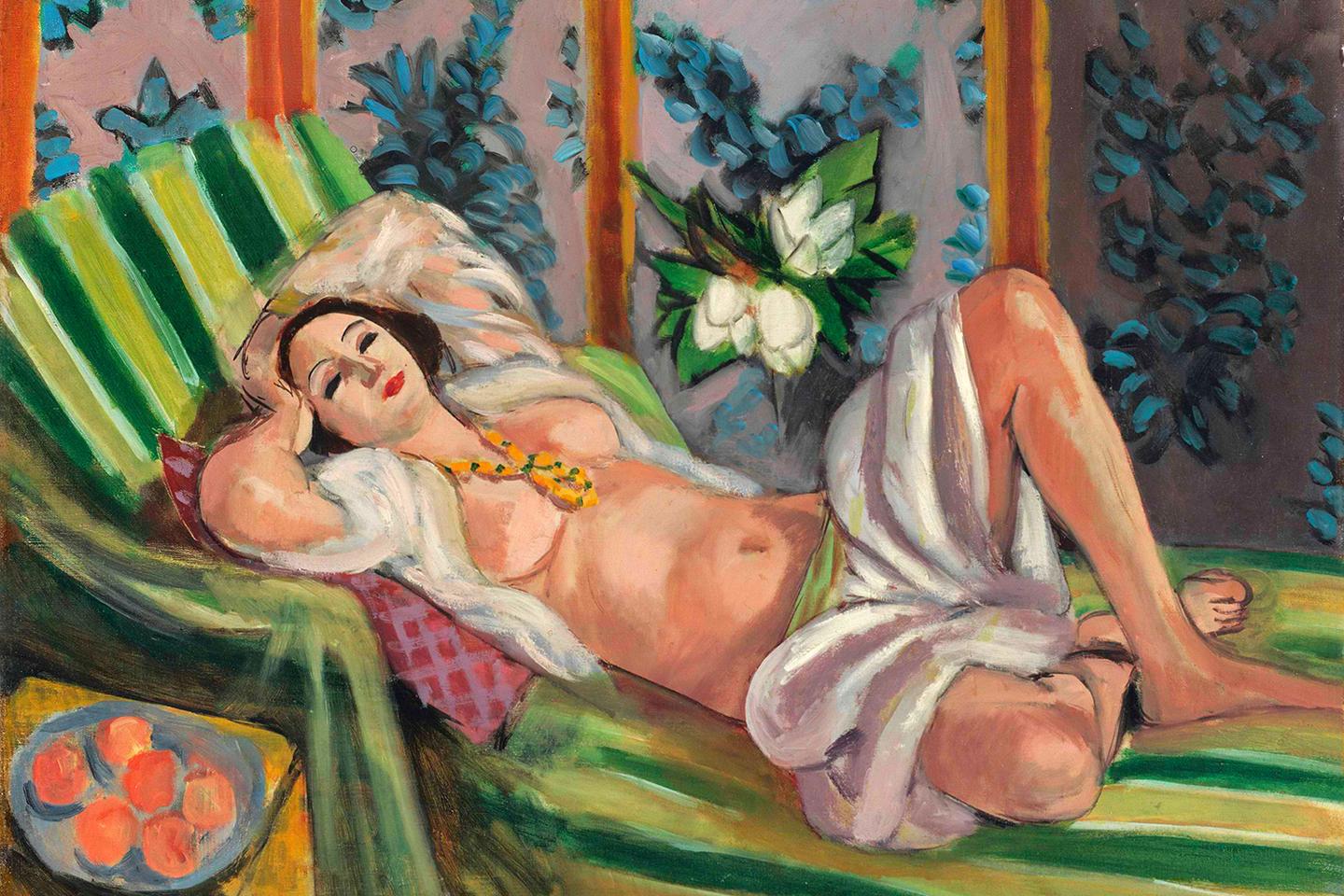Ana Maria Jeremias avait 9 ans quand elle a quitté la ferme familiale de Vila Nova do Seles, en Angola, pour le Portugal. C’est écrit sur un vieux document, daté du 19 juin 1975, signé de la main de son père. Elle s’appelait encore Utima, « cœur » en umbundu, la langue la plus parlée dans l’ancienne colonie portugaise. Confiée à une famille portugaise, elle est arrivée à Coimbra, sur les rives du Mondego, il y a quarante ans, et elle n’a, depuis, jamais cessé d’essuyer, de récurer, frotter, balayer, lessiver, décrasser. Ce sont ses mots à elle : « J’ai passé ma vie à nettoyer. »
Employée domestique et aide-soignante, Ana Maria Jeremias est, comme des milliers d’autres, l’une de ces femmes noires que l’on ne voit plus dans les rues et les bus des grandes villes européennes. Celles qui attendent les enfants devant l’école, qui tiennent la main d’une grand-mère esseulée dans une chambre d’hôpital, qui arrivent, balais et torchons à la main, quand les bureaux se vident.
Ce sont leurs vies que la photographe Maria Abranches, 33 ans, a voulu raconter à travers celle d’Ana Maria, des destins « communs à d’innombrables femmes, dont la contribution silencieuse a construit, façonné notre monde », et dont elle veut amplifier les voix. Ses tirages montrent Ana Maria, 60 ans aujourd’hui, dans le salon d’une patiente, écroulée de fatigue dans les transports, chez elle, dans la maison qu’elle a réussi à acheter avec son mari, à Rio de Mouro, en banlieue, d’où elle part encore chaque jour vers le centre-ville de Lisbonne. Ce projet, « Maria », plusieurs fois récompensé, a été primé par le World Press Photo en avril 2025.
« Les cicatrices du colonialisme »
Il vous reste 65.38% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.