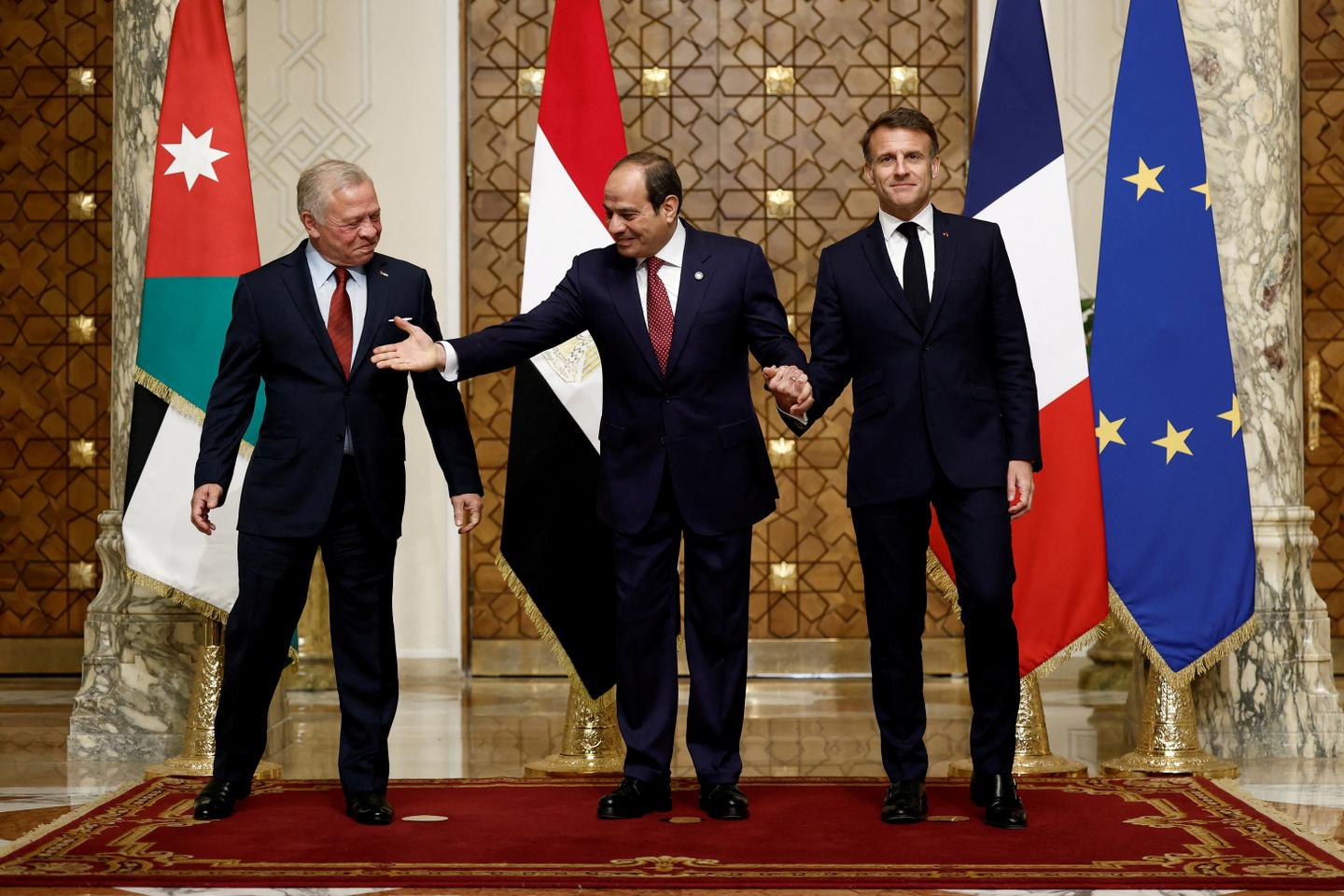« Leurs mots à eux » (Milim bamakom milim), de Rachel Shalita, traduit de l’hébreu par Gilles Rozier, L’Antilope, 324 p., 23 €, numérique 15 €.
Dans Histoire d’une vie (L’Olivier, 2004), Aharon Appelfeld écrit : « Sans langue maternelle, l’homme est infirme. » C’est à cette phrase que l’on pense à la lecture du troisième roman de Rachel Shalita, Leurs mots à eux. Dans ce livre autobiographique, la narratrice est Tzipi, une fille née en Israël en 1949, que ses parents, arrivés de Lituanie en Palestine à la veille de la seconde guerre mondiale, élèvent exclusivement en hébreu. Impensable, pour ce couple d’enseignants nés en Pologne, de transmettre à leur unique enfant le yiddish de la vieille Europe centrale qu’ils ont laissée derrière eux. Il faut avant tout œuvrer à la concrétisation du projet sioniste en se fondant dans une société et une langue nouvelles.
Mais les époux emploient le « jargon » dans leurs échanges entre eux, et il infuse leur quotidien. N’est-il pas présent dans ce prénom, Tzipi, l’équivalent hébreu de feyguélé (« petit oiseau »), que l’enfant porte en mémoire d’unetante assassinée pendant la Shoah ? Ne s’échappe-t-il pas des moindres conversations du foyer ? Dans la famille, on marche en effet « borvès » plutôt que « pieds nus », on traque les « infektiès » causées par les blessures et on veille à avoir une bonne « diktsiè » quand on lit un texte à haute voix. Pour autant, comment s’inscrire pleinement dans une lignée familiale quand l’accès à la langue des origines a été prohibé ?
Il vous reste 58.09% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.