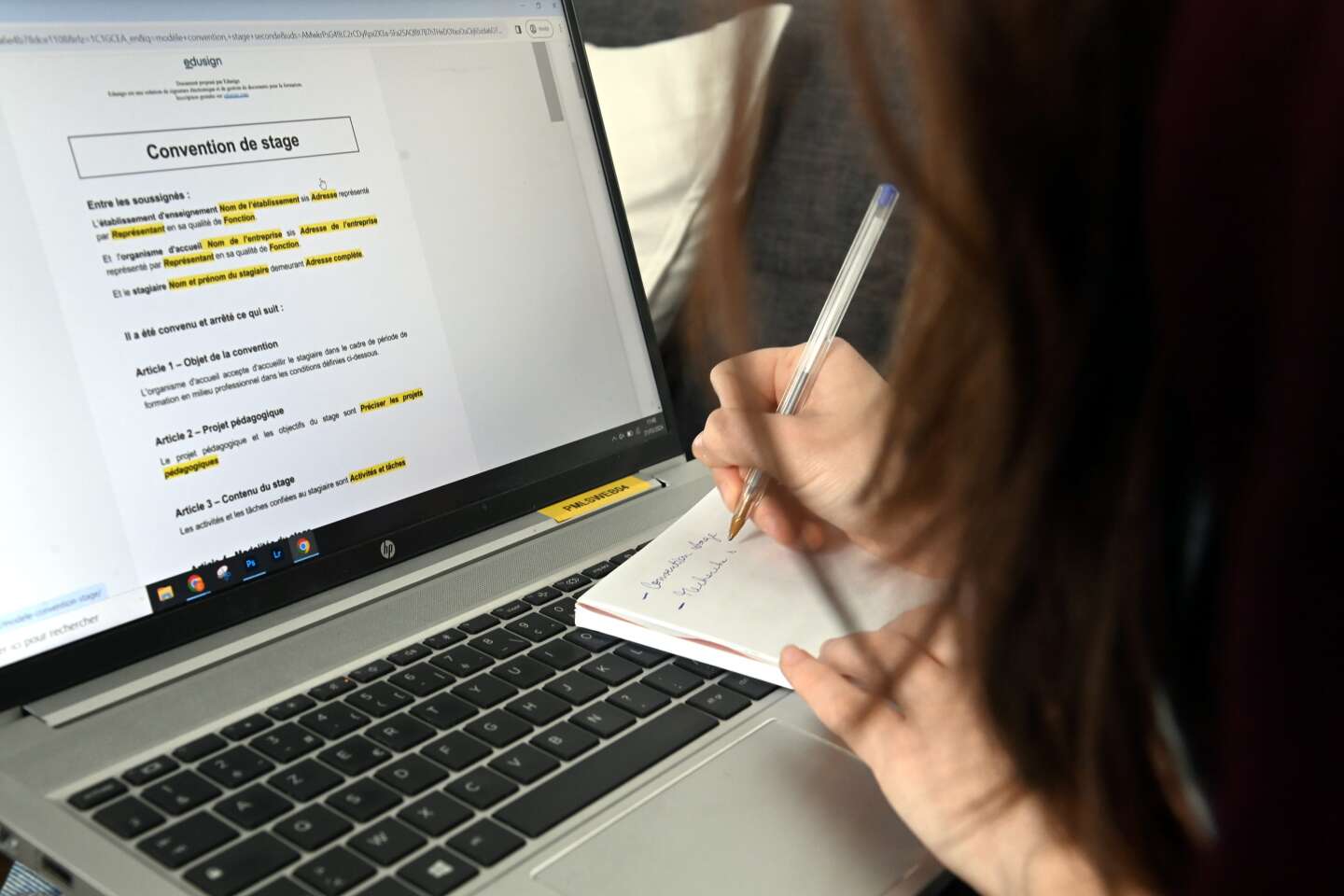Cette tribune paraît dans « Le Monde de l’éducation ». Si vous êtes abonné au Monde, vous pouvez vous inscrire à cette lettre hebdomadaire en suivant ce lien.
Le constat d’inégalités entre universités conduit parfois à une affirmation : la France, de Napoléon Ier à la fin de la IVe République, aurait installé un service public universitaire égalitaire, assumant une certaine uniformité ; les actuelles inégalités seraient la conséquence de décisions des quinze ou trente dernières années (voir notamment une tribune publiée dans Le Monde le 13 mai 2024).
Le système napoléonien, soumis à une centralisation hostile à l’autonomie et à la liberté académique, est moins homogène qu’on ne le croit. Ainsi, les facultés de lettres et de sciences ne sont pas construites sur le modèle de celles de médecine et de droit, héritières d’écoles créées sous le Directoire et le Consulat.
Paris et Strasbourg sont les deux seules villes avec cinq facultés, d’autres n’en ayant qu’une ou deux. Les professeurs de Paris sont payés 25 % de plus que ceux de province (ce sera le cas jusqu’en 1960). Des écoles de santé, peu financées, ouvrent à côté des trois facultés de médecine, et les étudiants de droit et de médecine paient des frais d’inscription plus importants que ceux de lettres et de sciences.
« Concours entre villes académiques »
A partir de 1876, les républicains encouragent l’autonomie et la diversité des facultés (puis des universités, recréées en 1896). En 1885, René Goblet, ministre de l’instruction publique, constate que l’on « a reproché, non sans raison, à nos facultés de se ressembler trop les unes aux autres », et veut que « chaque groupe de facultés ait une physionomie propre, et qu’avec des organes semblables, répondant à des fonctions communes, elles aient chacune des organes spéciaux, adaptés aux ressources et aux besoins de chaque ville et de chaque région ».
Le décret qu’il signe dote les facultés de la personnalité morale et leur permet de recevoir des dons et legs privés ainsi que des subventions des municipalités. Il s’agit de leur donner « plus de sécurité, plus de dignité, plus d’indépendance et (…) d’initiative ». En 1922 encore, une circulaire, menaçante, signale que l’autonomie dont « jouissent les universités n’ayant pas que des partisans », ces dernières doivent faire « appel au concours financier des villes, des départements, des chambres de commerce, comme à la largesse des particuliers ».
L’immobilier (Sorbonne, palais universitaires) est cofinancé par les villes, et des chaires sont créées sur fonds privés ou municipaux. En 1896, l’historien et mandarin parisien Ernest Lavisse se dit heureux que le ministre ait « ouvert une sorte de concours entre les villes académiques françaises », ajoutant que, « pour gagner la palme », il faudra que « le corps professoral et les corps électifs, municipalités et conseils généraux, s’accordent pour produire le milieu favorable à la naissance et à la croissance d’une université ».
Il vous reste 60.75% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.