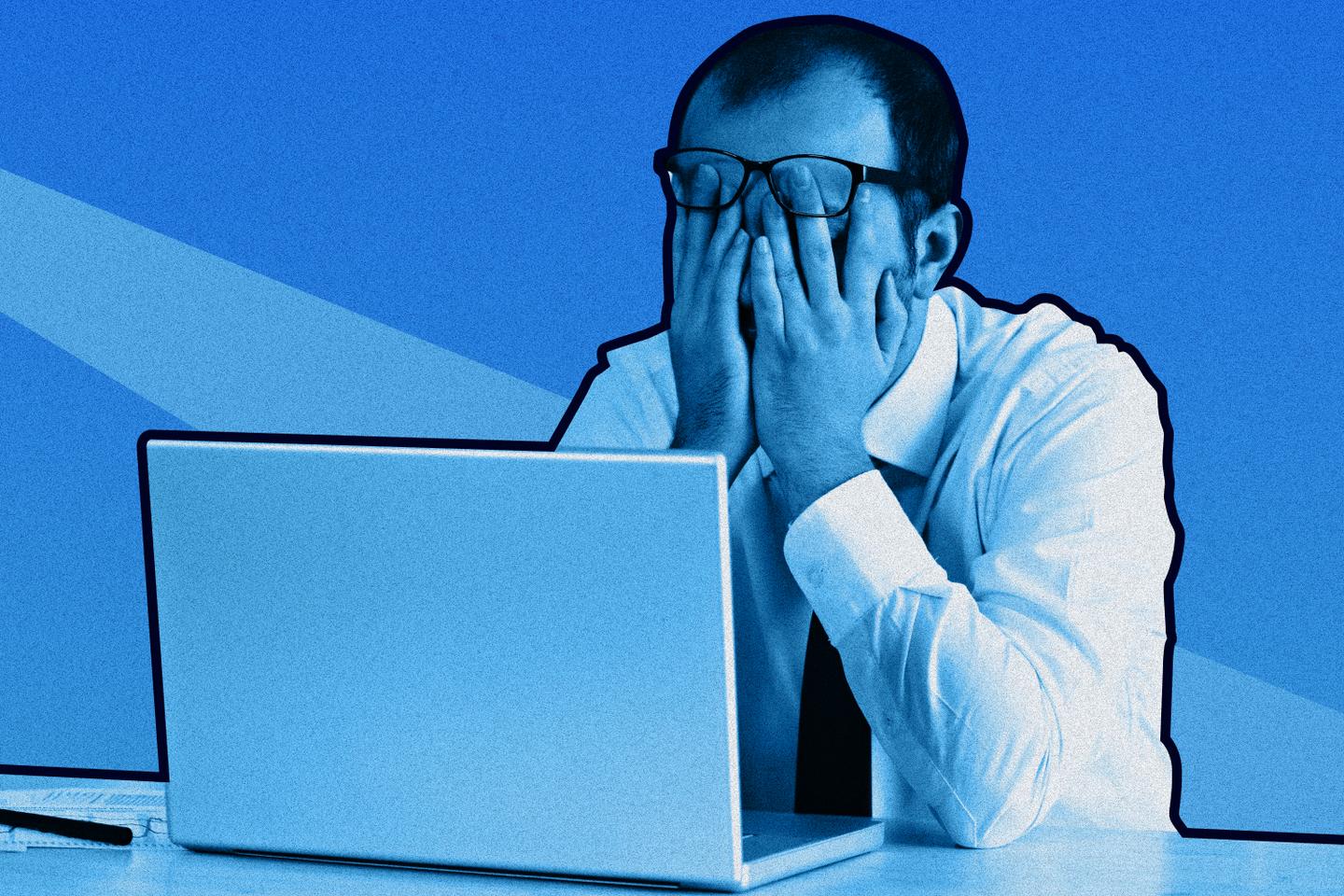La question du profil populaire ou bourgeois des différents votes suscite depuis toujours de nombreuses controverses. Avec Julia Cagé, nous avons développé, dans Une histoire du conflit politique (Seuil, 864 p., 27 €), une méthode permettant d’établir un certain nombre de faits et d’évolutions. Nous avons commencé par rassembler les résultats électoraux au niveau communal pour l’ensemble des scrutins législatifs et présidentiels, de 1848 à 2022, ainsi que pour les référendums les plus significatifs, de 1793 à 2005. Puis nous classons les quelque 36 000 communes en fonction de leur richesse moyenne, depuis les 1 % des communes les plus pauvres jusqu’aux 1 % des communes les plus riches, et nous observons la façon dont évolue le score obtenu par les différents candidats et courants politiques en proportion de leur score moyen national. Nous utilisons plusieurs indicateurs de richesse, en particulier le revenu moyen par commune. Nous obtenons les mêmes résultats avec d’autres indicateurs comme la valeur moyenne des logements.
S’agissant du vote Macron ou Ensemble lors des derniers scrutins, on observe une pente exceptionnellement forte. On trouve parfois des votes de droite qui sont encore plus bourgeois que Macron, par exemple Madelin en 2002 ou Zemmour en 2022 (preuve s’il en est que le vote anti-immigrés n’est en aucune façon l’apanage des classes populaires), mais ce sont des votes plus restreints en termes de taille d’électorat. Pour des votes d’importance comparable (mettons autour de 20-30 % des voix ou davantage au premier tour), donc si on le compare aux votes Giscard, Chirac, Balladur, de Gaulle ou RPR-UDF dans le passé, alors le vote Macron ou Ensemble apparaît comme plus bourgeois, au sens où il a approximativement la même pente que les votes de droite du passé dans le haut de la distribution (au sein des communes les plus riches), mais une pente plus marquée dans le bas de la distribution (au sein des communes les plus pauvres). Autrement dit, alors que la droite traditionnelle parvenait à capturer une partie du vote des communes les plus modestes, en particulier dans le monde rural, ce n’est pas le cas du vote Macron.
Evolution bourgeoise-sarkozyste
Précisons que c’est une évolution qui a commencé avant Macron. Par exemple, le vote Sarkozy en 2007 ou en 2012 est plus pentu que les votes Giscard ou Chirac du passé, en particulier dans le bas de la distribution, car une partie de l’électorat populaire rural votant pour la droite a déjà commencé sa transition vers le FN-RN, en particulier du fait de la déception consécutive au référendum de 2005 et à la ratification parlementaire du traité d’Amsterdam. Ce qui montre au passage que le vote FN-RN des bourgs et des villages est avant tout un vote socio-économique inquiet face à la désindustrialisation et à l’intégration commerciale internationale, et non un vote identitaire que l’on peut attraper à grands coups de rhétorique facile sur le « Kärcher » ou la « racaille ». Macron ne fait dans le fond que prolonger et amplifier cette évolution bourgeoise-sarkozyste.
Il vous reste 48.78% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.