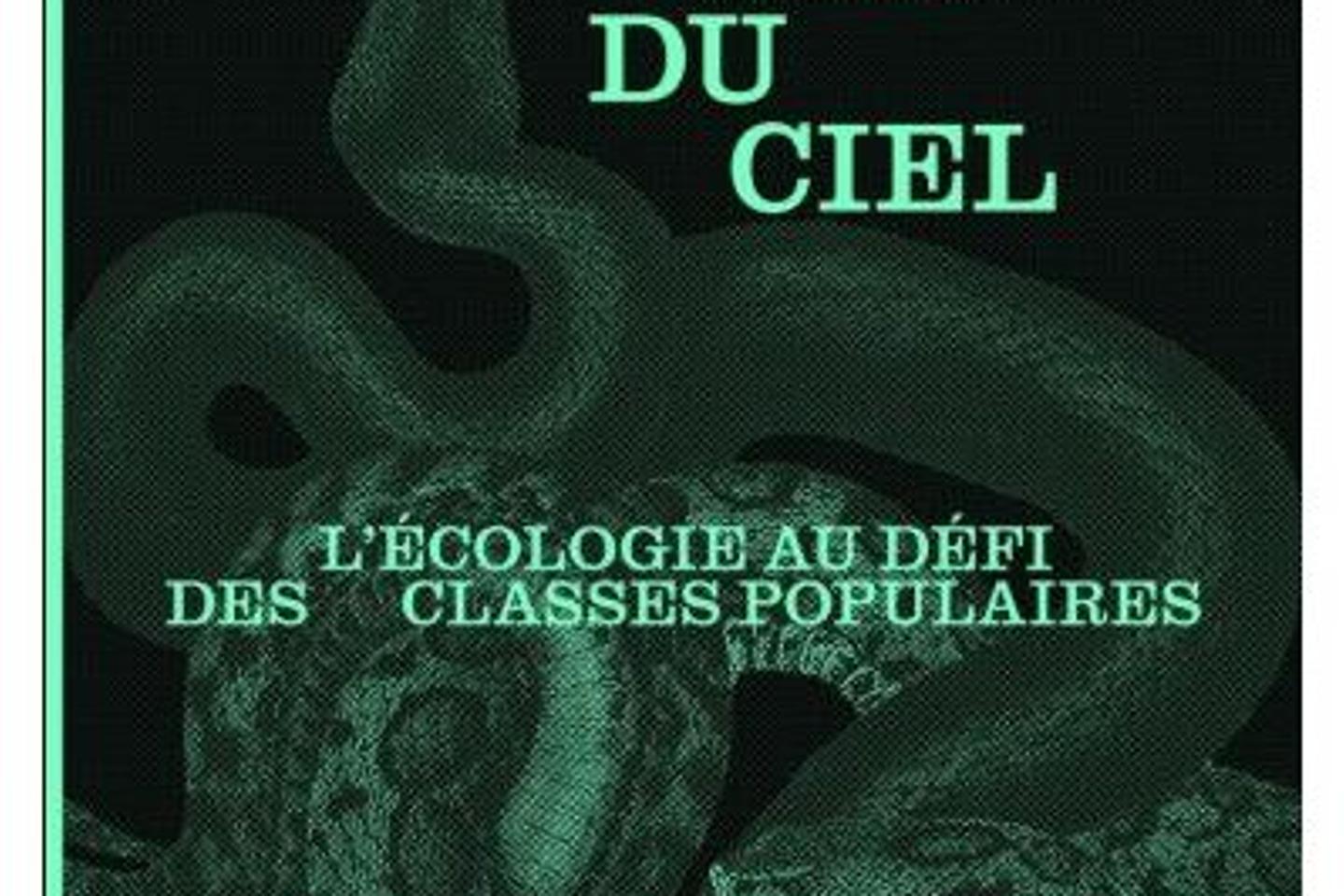Depuis qu’elle a compris l’ampleur de la crise écologique en entrant en école d’ingénieurs en 2017, Lou (son prénom a été modifié à sa demande) estime avoir fait sa part. « Je suis devenue quasi végétarienne, j’ai arrêté de prendre l’avion, je me suis engagée dans des assos, j’ai fait des marches pour le climat, j’ai essayé de convaincre mes proches… », égrène cette ingénieure hydrologue de 29 ans.
Oui mais voilà, huit ans plus tard, « la crise écologique n’a fait que s’aggraver », selon elle. Et après « les crises de larmes et d’angoisse (…), la frustration, la déception et la colère », la fatigue s’est installée. Résultat : « J’ai fini par réduire mon engagement pour préserver ma santé mentale, je reprends parfois l’avion, j’ai lâché du lest sur l’alimentation… », souffle Lou, consciente que son défaitisme « aurait sans doute agacé » la jeune femme pleine d’espoir qu’elle était il y a quelques années.
Son témoignage fait écho à celui de dizaines d’autres jeunes adultes qui ont raconté au Monde pourquoi ils avaient baissé les bras face à l’urgence écologique, et comment le pessimisme, voire le catastrophisme, s’était progressivement fait une place dans leur esprit.
Une dose de résignation
S’ils résidaient outre-Atlantique, ces derniers se retrouveraient sans doute affublés d’un « OK doomer ». Cette expression, équivalente du « OK boomer » moquant les discours des baby-boomeurs, raille le pessimisme écologique de certains jeunes (doom, en anglais, pouvant se traduire par « destin tragique »). Or, ce phénomène, difficile à quantifier mais qui prend de plus en plus de place sur les réseaux sociaux américains, n’est pas anodin : dans une étude parue en 2020, l’université de Cambridge (Royaume-Uni) classait le climate doomism parmi les 12 discours participant à retarder l’action climatique.
Il vous reste 80.86% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.