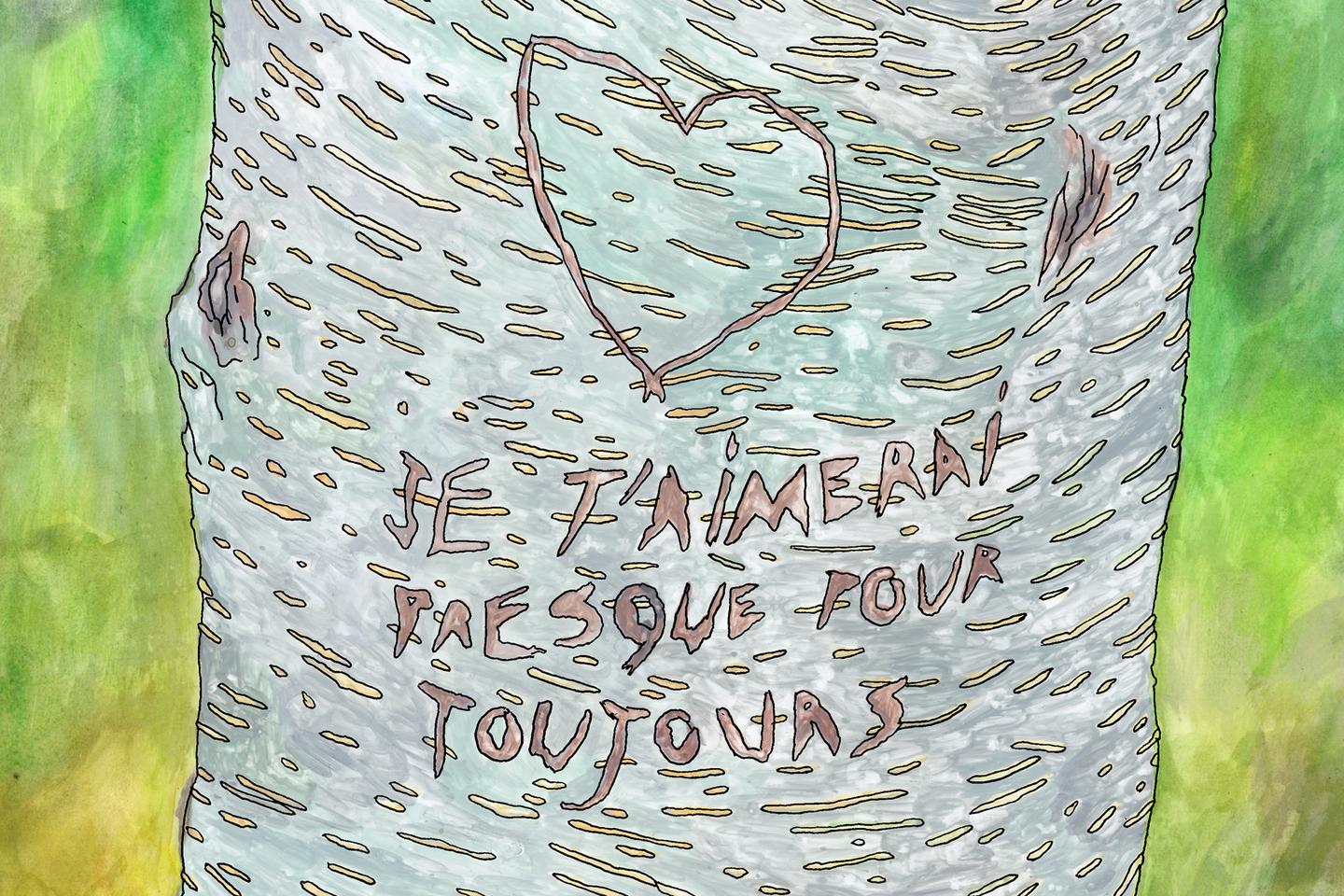Jeudi 20 février, Emmanuel Macron a reçu une douzaine de chefs de parti et de groupe parlementaire pour leur exposer la situation en Ukraine, alors que Donald Trump entend lancer des pourparlers de paix avec Vladimir Poutine, marginalisant le principal intéressé, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qu’il a, dans un renversement sidérant, qualifié de « dictateur », et l’Europe tout entière. En sortant de l’Elysée, les responsables politiques présents – certains chefs de parti (Rassemblement national, RN, Les Républicains, LR) s’étaient fait représenter – ont insisté sur la nécessité pour la France de faire entendre sa voix dans la nouvelle configuration mondiale. Mais ils sont restés divisés sur le message à porter, ainsi que sur l’éventuel envoi de troupes en Ukraine.
Face aux bouleversements du monde, accentués depuis l’élection de Trump, aux Etats-Unis, les politiques français apparaissent tétanisés, en deçà. Vendredi 14 février, à Munich, le vice-président américain, J. D. Vance, remet en question l’alliance transatlantique, avant de pourfendre les démocraties libérales européennes, accusées d’étouffer la « liberté d’expression ». Cette violente diatribe a été assortie d’un soutien à l’extrême droite allemande, avant les élections législatives outre-Rhin du 23 février. Un discours jugé « insupportable » par le ministre de la défense allemand, Boris Pistorius, mais assez peu commenté à Paris, compte tenu de la gravité du propos et de la rupture épistémologique qu’il induit.
Il vous reste 84.83% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.