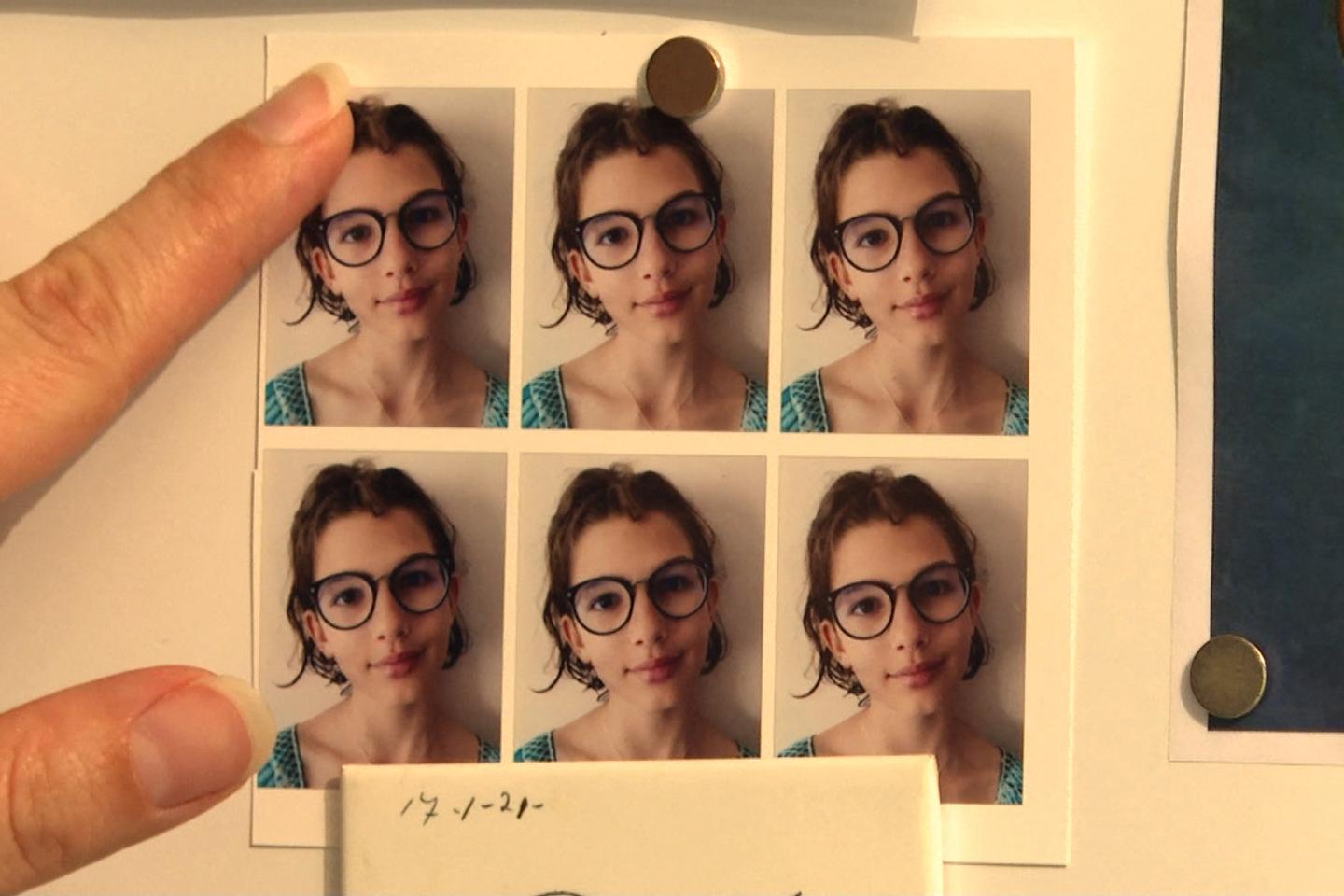Depuis le début des années 1990, le législateur est attentif à la question du financement des campagnes électorales et des partis politiques. Pendant trop longtemps, une forme d’indifférence et d’insouciance a entouré la question de l’argent en politique. Au gré des grandes affaires politico-financières qui ont concerné divers partis, le Parlement n’a cessé de préciser les règles et de durcir les sanctions en cas de manquement.
De la loi Rocard de 1990 à la loi sur la « confiance dans l’action publique de septembre 2017 », en passant par la première loi Sapin de 1993, la loi Séguin de 1995, la mise en place de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, la création du Parquet national financier (PNF) en 2013 et enfin la loi Sapin 2 de 2016, les législateurs successifs n’ont eu de cesse d’affirmer leur volonté d’exemplarité et de sévérité.
Aucun de ces textes n’a été voté contre ou pour un parti politique ; tous ont été adoptés par de très larges majorités, rassemblant tous les bancs et toutes les sensibilités. Il ne s’agissait pas de régler des comptes ou de voter des lois d’exception ; mais d’agir contre le sentiment profondément répandu d’une classe politique indélicate lorsqu’il s’agit de financer ses activités et puisant indûment dans les caisses publiques pour faire face aux dépenses de campagne.
Il vous reste 79.96% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.