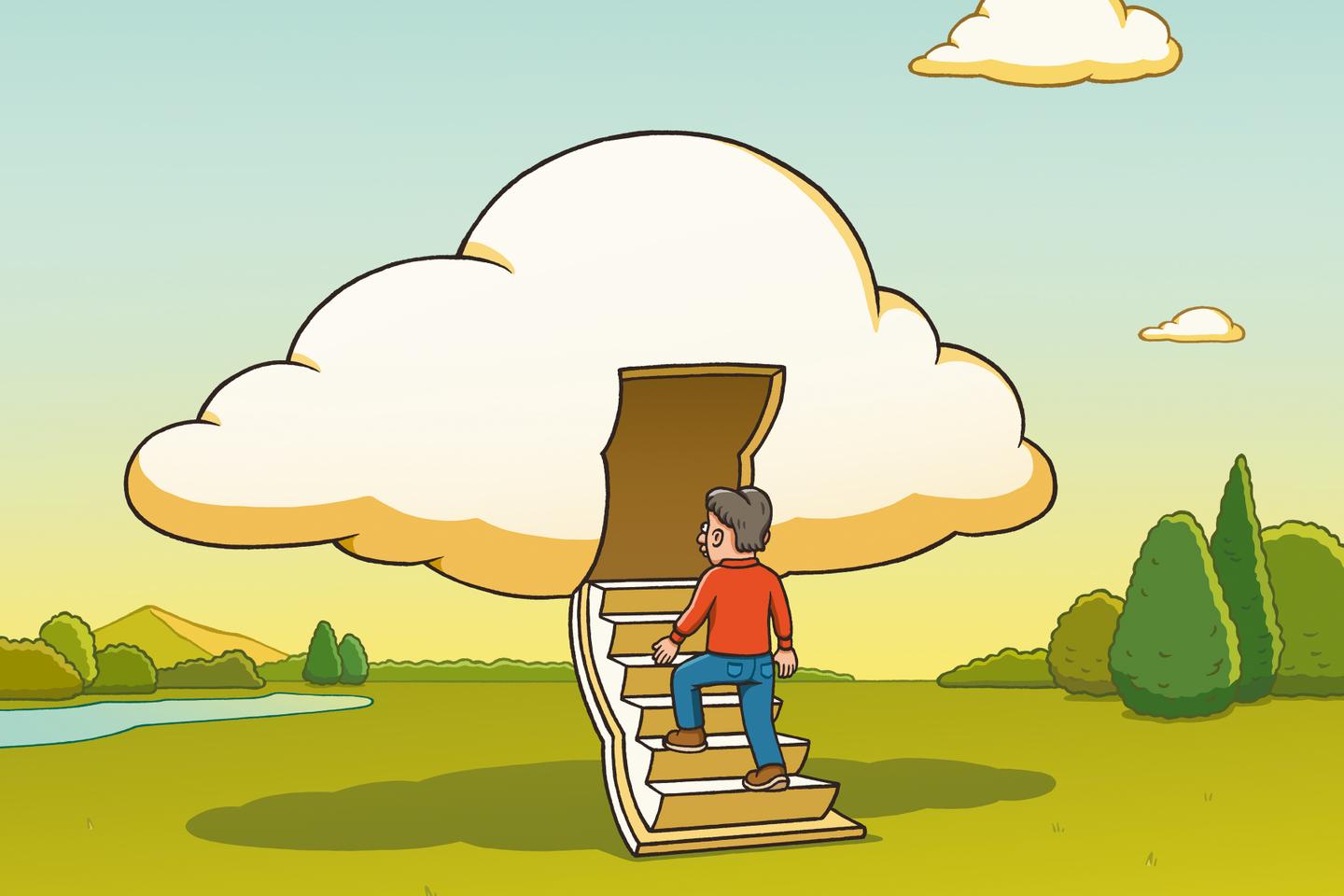Quand on discute avec le Hongrois Laszlo Krasznahorkai, même par l’intermédiaire d’un ordinateur et en anglais, on ne peut qu’être frappé par un contraste. Contraste entre l’univers ténébreux et pessimiste que cultive ce romancier parmi les plus importants d’aujourd’hui, figurant en bonne place dans la liste des possibles Nobel de littérature, et l’homme modeste et chaleureux, père de trois enfants, pétri de culture classique, qui avoue que l’horizon d’une telle distinction, si elle lui était accordée, lui ferait d’abord « peur ». Qualifié par l’intellectuelle américaine Susan Sontag (1933-2004) de « maître de l’apocalypse » en 1999, il ne se retrouve pas dans cet éloge souvent cité à son propos. « La formule de Susan est formidable, dit-il avec sa douce ironie, je suis très fier qu’elle me l’ait appliquée, mais je ne me reconnais pas du tout comme un “maître”. » Il se considère plutôt comme participant à une conversation d’égal à égal avec son lecteur.
Né en 1954 à Gyula, non loin de la frontière roumaine, en Transylvanie, dans une famille de juristes mal vue des autorités communistes, Laszlo Krasznahorkai n’a quitté la Hongrie qu’en 1987, pour Berlin. Ses souvenirs d’enfance et de jeunesse renvoient au monde d’en deçà du rideau de fer, dont rien ne pouvait laisser penser qu’il disparaîtrait un jour : « J’ai grandi dans une petite ville éloignée de Budapest, dans une atmosphère bourgeoise. Les enfants devaient faire de la musique classique, toutes les familles disposaient d’une belle bibliothèque à domicile, la lecture était notre pratique favorite. Mais tout a fini avec mon service militaire obligatoire : j’y suis entré petit garçon et j’en suis sorti adulte. Sans espoir. »
« Le temps uniforme »
L’absence de perspective et de changement plombait le climat dans lequel baignait la jeunesse de Krasznahorkai. « Dans cette situation – et je ne parle pas seulement de la politique, précise-t-il –, celle de la Hongrie des années 1960, 1970 et 1980, tout le monde pensait que nous devrions toujours vivre avec ce régime, avec une armée soviétique cachée mais présente [il était interdit aux soldats soviétiques d’entrer en contact avec la population]. Nous nous imaginions que la réalité de ce monde était éternelle et éternellement sans espoir. Le temps s’écoulait uniforme, on n’avait nul besoin de faire la différence entre les semaines, les jours, les heures. C’était la vie, et elle était ainsi. Nous n’avions pas une image réelle du “monde libre”, mais nous en rêvions. Tout ce qui provenait d’Occident était fascinant. Les sacs en plastique, par exemple. Ma mère les collectionnait et mon père, les paquets de cigarettes, et nous, les disques beat ou punk en Bakélite. » Il affirme n’avoir alors pas désiré suivre la voie de sa famille, qu’il a quittée pour rejoindre la partie « la plus humiliée de la société hongroise » et vivre de petits jobs, mû par un refus de devenir adulte.
Il vous reste 72.53% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.