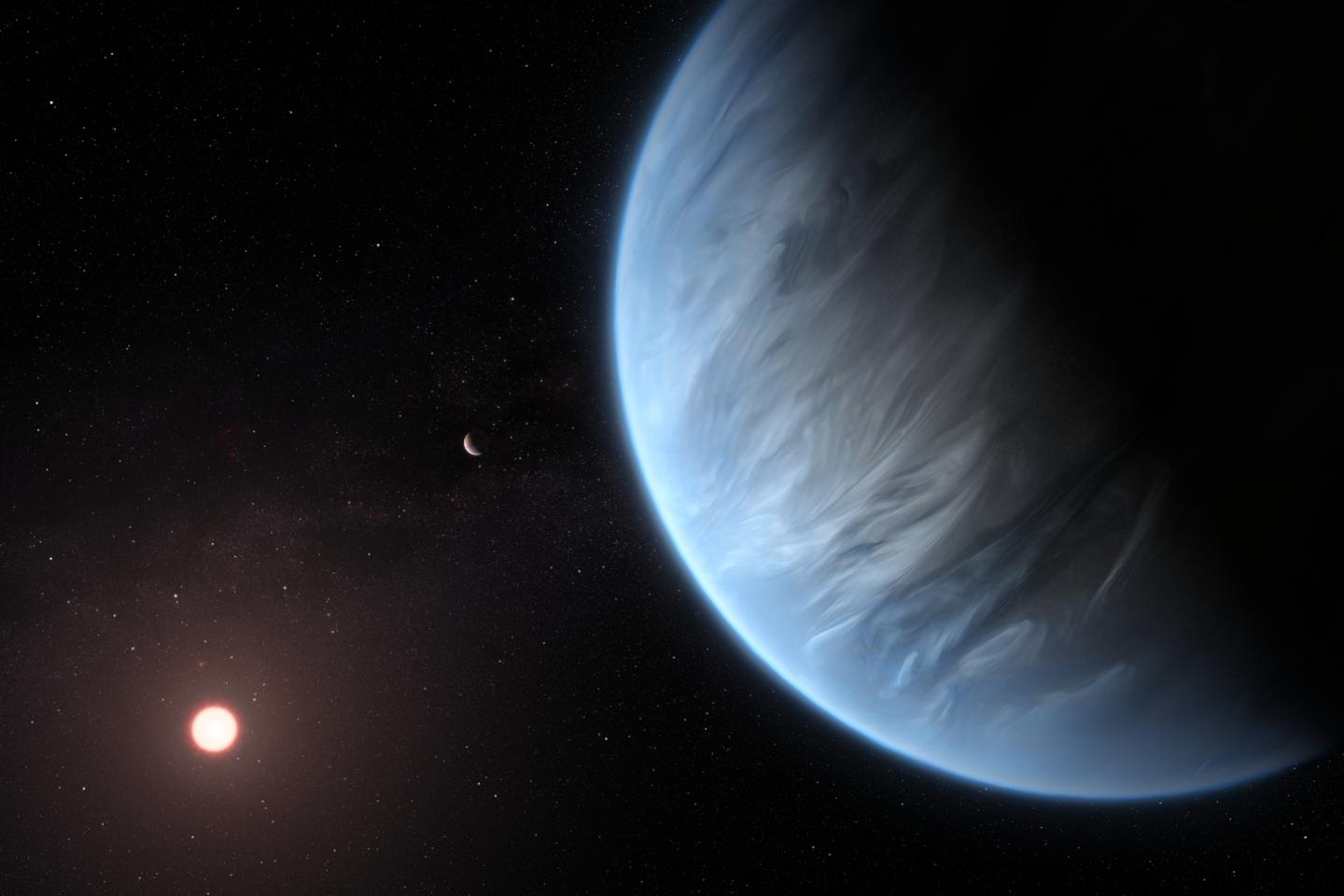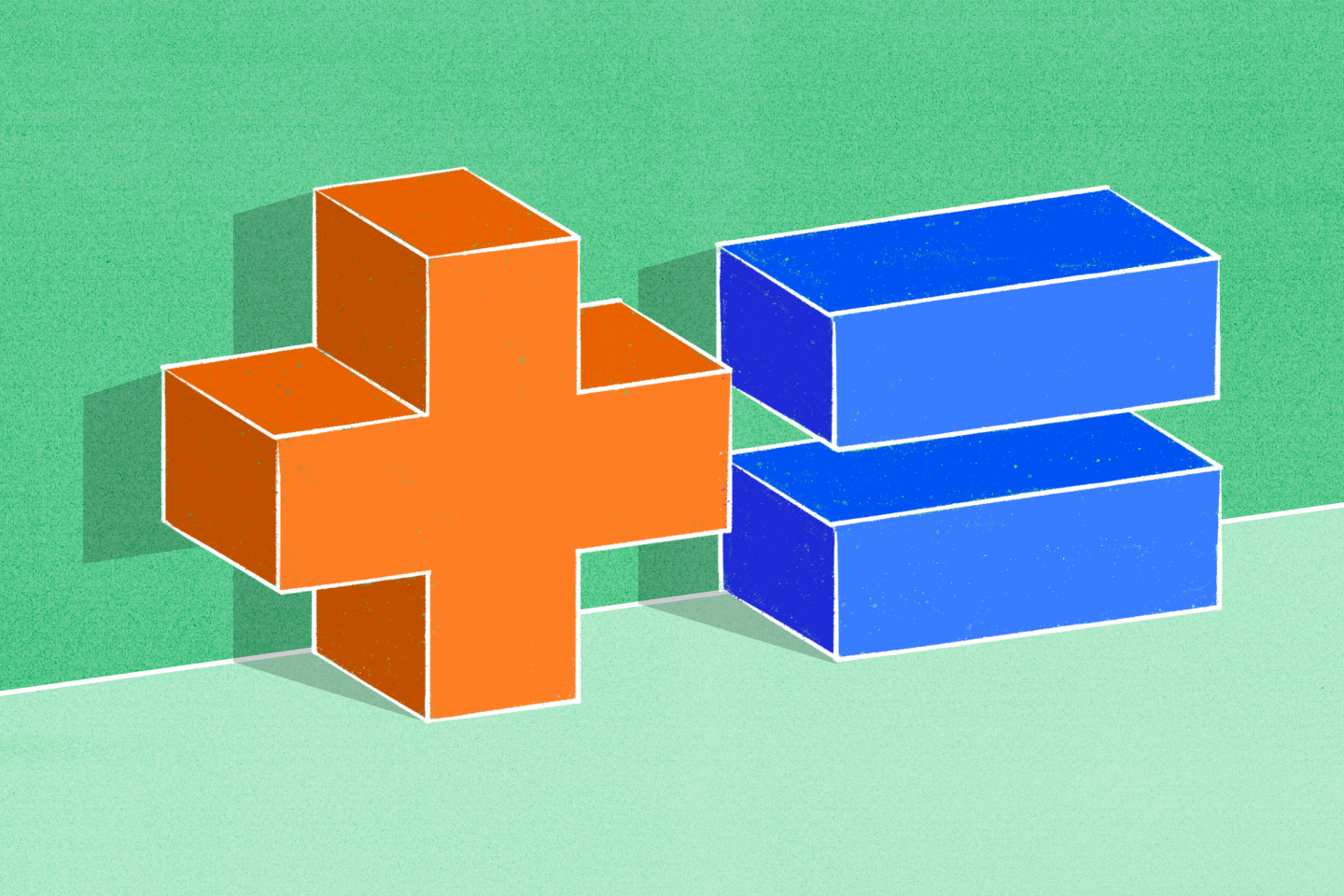Le chimiste Bernard Meunier a récemment proposé d’exclure les sciences de l’homme du périmètre d’activité du CNRS pour réduire sa masse salariale et rehausser son attractivité. La part de budget ainsi libérée permettrait, selon lui, de mieux valoriser les carrières des chercheurs les plus méritants.
Que certains jugent l’apport des sciences humaines superflu n’a rien d’étonnant, tant elles font l’objet de préjugés négatifs de la part des praticiens des sciences « dures ». Selon eux, les seules sciences exactes sont celles qui produisent des paradigmes et des « faits » de validité universelle, riches en applications technologiques, grâce à des concepts précis et à la mise en œuvre d’expérimentations rigoureuses. En marge de celles-ci se développeraient des disciplines qui butent sur la complexité de l’humain, multiplient les méthodes sans produire de résultats, ainsi que l’affirmait Henri Poincaré (dans Science et méthode, Flammarion, 1908), et dont les interprétations seraient prisonnières des ambiguïtés du langage ordinaire, tout en souffrant de biais subjectifs et idéologiques.
Or un examen approfondi des modalités concrètes de la recherche remet en cause l’écart qualitatif entre les sciences naturelles et les sciences de l’homme. En effet, les premières œuvrent certes sur des objets non humains, mais, focalisées sur la production et la valorisation de résultats, elles tendent à oblitérer les processus intersubjectifs, donc sociaux, qui conditionnent leurs découvertes. Les sociologues Bruno Latour et Steve Woolgar ont montré (dans La Vie de laboratoire. La production des faits scientifiques, La Découverte, 1979) qu’au sein des laboratoires de sciences « dures » la recherche se fait en équipes, au sein d’un champ spécialisé dont l’activité est contrainte par des rapports de pouvoir, des considérations économiques, des facteurs politiques, des rivalités et des enjeux de prestige. Si autant de controverses sur la validité du savoir scientifique se font jour, du fait de la confrontation médiatique des savoirs experts autour d’enjeux sanitaires, environnementaux et climatiques, c’est précisément parce que ces savoirs sont liés à des postures dans le champ du pouvoir politico-économique. Le nier, c’est entretenir le mythe d’un savoir éthéré, miraculeusement exempt des passions humaines.
Il vous reste 54.73% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.