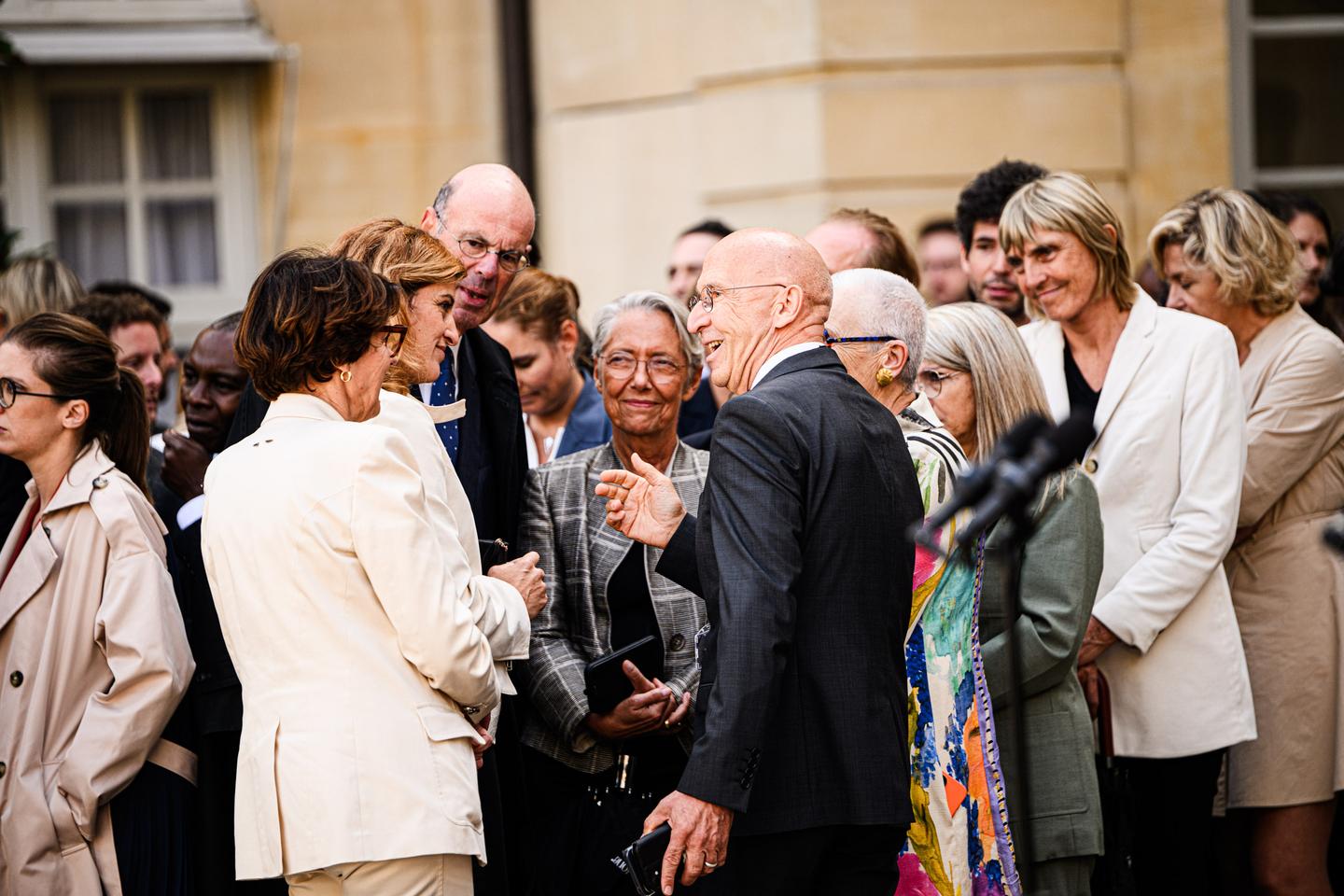Une note d’une agence statistique américaine (le Census Bureau) annonçait cet été une révolution : la dynamique de construction de bureaux va être dépassée par celle des data centers. Cette tendance marque la métamorphose profonde de nos organisations. Elle confirme l’emprise technologique, la poussée de l’intelligence artificielle (IA) et l’évolution des modes de travail sur les morphologies urbaines.
Dans une thèse publiée récemment, j’alerte sur la crise mondiale des quartiers d’affaires : les espaces transactionnels ne sont plus synonymes de tours, ni de cols blancs, ni de mégapoles. Ils se reconfigurent sur d’autres codes : de transactions virtuelles, d’un côté, et d’espaces de convivialité, de l’autre.
Cette évolution ouvre une perspective de déconcentration. Elle est connue des historiens : Fernand Braudel (1902-1985) ou Immanuel Wallerstein (1930-2019) avaient analysé les déterminants socio-économiques et l’impact de l’innovation sur le cycle des économies capitalistes. Nos économies alternent des mouvements de concentration et de dispersion au rythme de l’évolution des modes de transaction.
L’hybridation des usages
Dès 1973, dans un document intitulé « Schéma général d’aménagement de la France. Paris, ville internationale », les auteurs introduisaient la notion de créativité culturelle comme vecteur d’attractivité économique des quartiers d’affaires. Ils mettaient en garde contre le « puritanisme économiciste » et les risques d’une approche purement tertiaire de ces quartiers. C’est pourtant la voie qui a été empruntée. Elle pourrait expliquer leur crise structurelle : une densité de bureaux n’implique plus une intensité d’échanges.
A l’inverse, c’est dans l’hybridation des usages que se révèlent la qualité, la créativité et l’intensité des échanges. André Malraux (1901-1976) avait anticipé ce risque. En 1964, aux prémices de la construction de la Défense (Hauts-de-Seine), le ministre de la culture confiait aux architectes Le Corbusier (1887-1965) et André Wogenscky (1916-2004) l’installation d’un grand musée d’art moderne et de différents établissements d’enseignement artistique sur une surface de 45 hectares au cœur de la Défense.
Il vous reste 64.96% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.