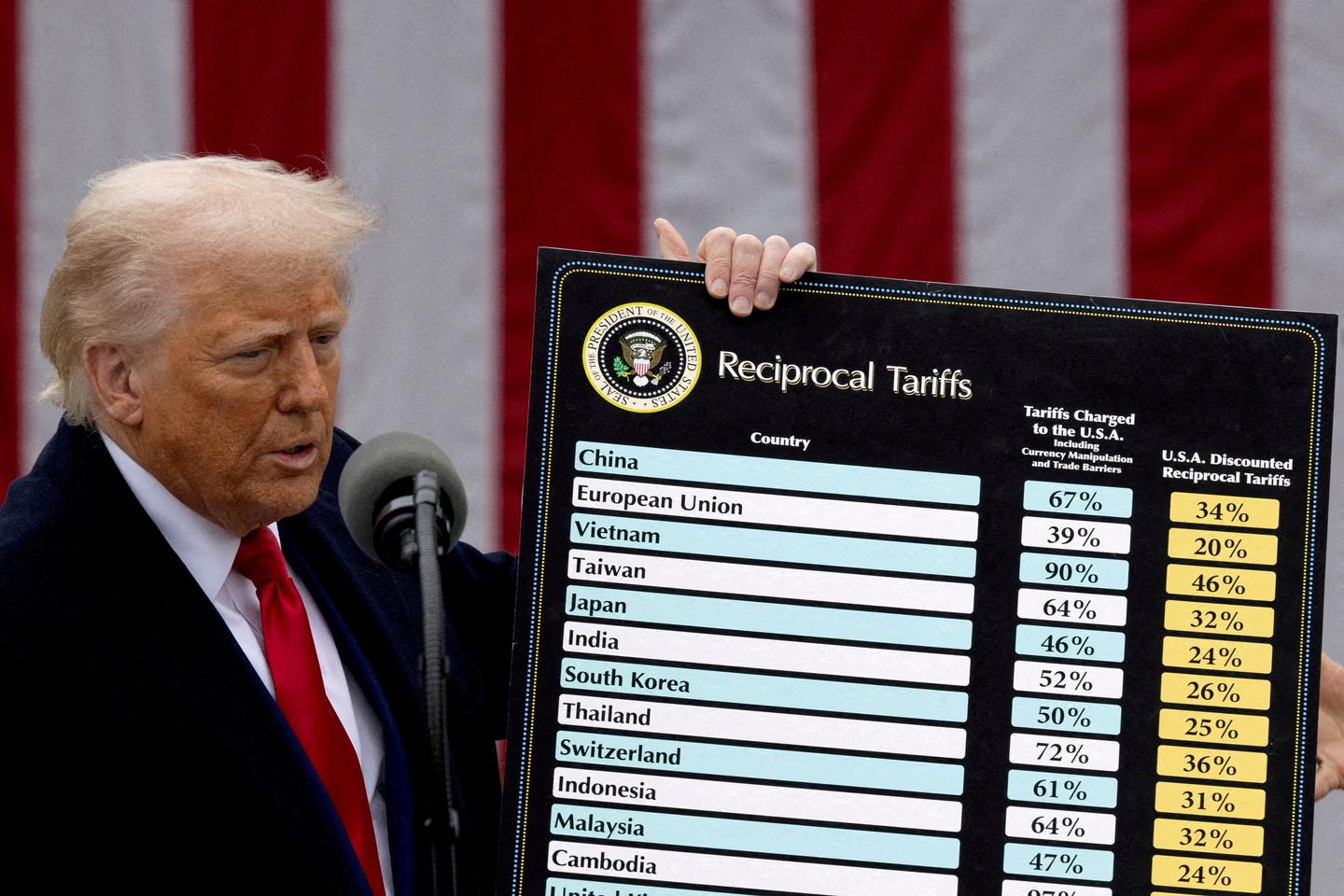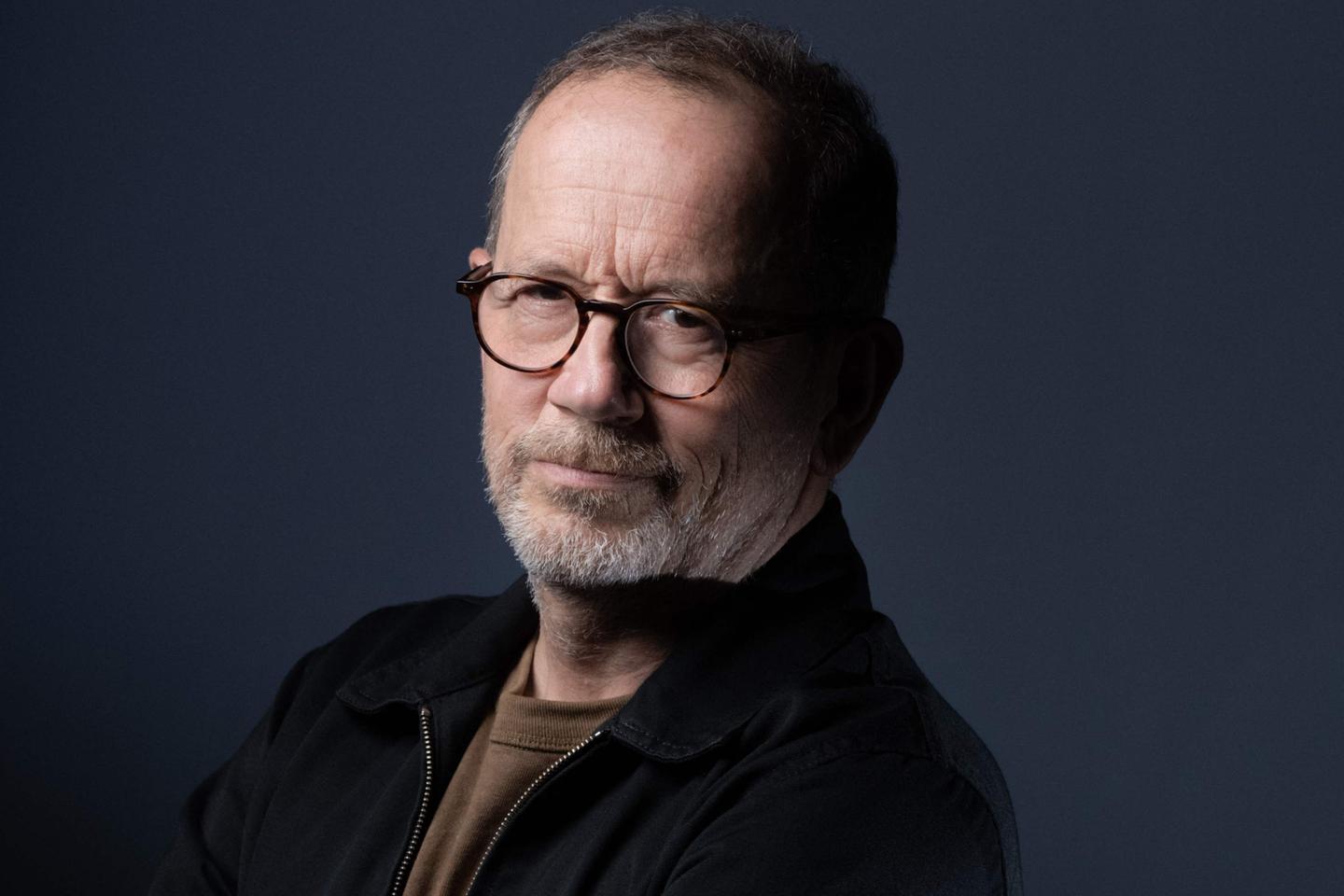Pour sortir de l’impasse politique, nombre d’experts et d’élus préconisent l’adoption de la représentation proportionnelle. Ce mode de scrutin est la règle dans tous les pays de l’Union européenne mais la France lui préfère, depuis l’instauration du suffrage universel masculin, en 1848, le « bon vieux » scrutin majoritaire, selon les mots de l’historien Gilles Le Béguec. Si l’on met de côté les rares parenthèses proportionnelles (1870-1875, 1885-1889, 1919-1927, 1946-1951 et 1986-1988), les sièges du Palais-Bourbon sont attribués, depuis plus d’un siècle, aux candidats arrivés en tête au second tour.
Parce qu’il accorde une prime significative aux vainqueurs, ce mode de scrutin a longtemps contribué à constituer des majorités absolues à l’Assemblée nationale mais il a l’immense inconvénient de – très – mal représenter les minorités. Dès 1894, le journaliste et historien Henri Avenel (1853-1908) démontre ainsi, dans un opuscule nourri de graphiques, que près des trois cinquièmes du corps électoral sont privés de représentants à la Chambre des députés. Ce mode de scrutin, résume Bastien François, professeur de science politique à l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne, est un « instrument de réduction du pluralisme qui condamne la représentation nationale à être sans prise sur la société ».
La représentation proportionnelle aspire, au contraire, à faire de l’Assemblée un « miroir » de la nation. Au lieu de désigner un vainqueur – et un seul – dans chacune des circonscriptions, elle partage équitablement les sièges entre les candidats : les mandats sont répartis en fonction du nombre de suffrages recueillis par chacune des listes. Il existe mille et une versions de la proportionnelle – avec ou sans prime majoritaire, au plus fort reste ou à la plus forte moyenne, avec ou sans panachage –, mais toutes tentent de faire de l’Assemblée le « calque du pays à une échelle réduite », selon le mot, en 1896, du linguiste Raoul de La Grasserie.
Il vous reste 48.87% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.