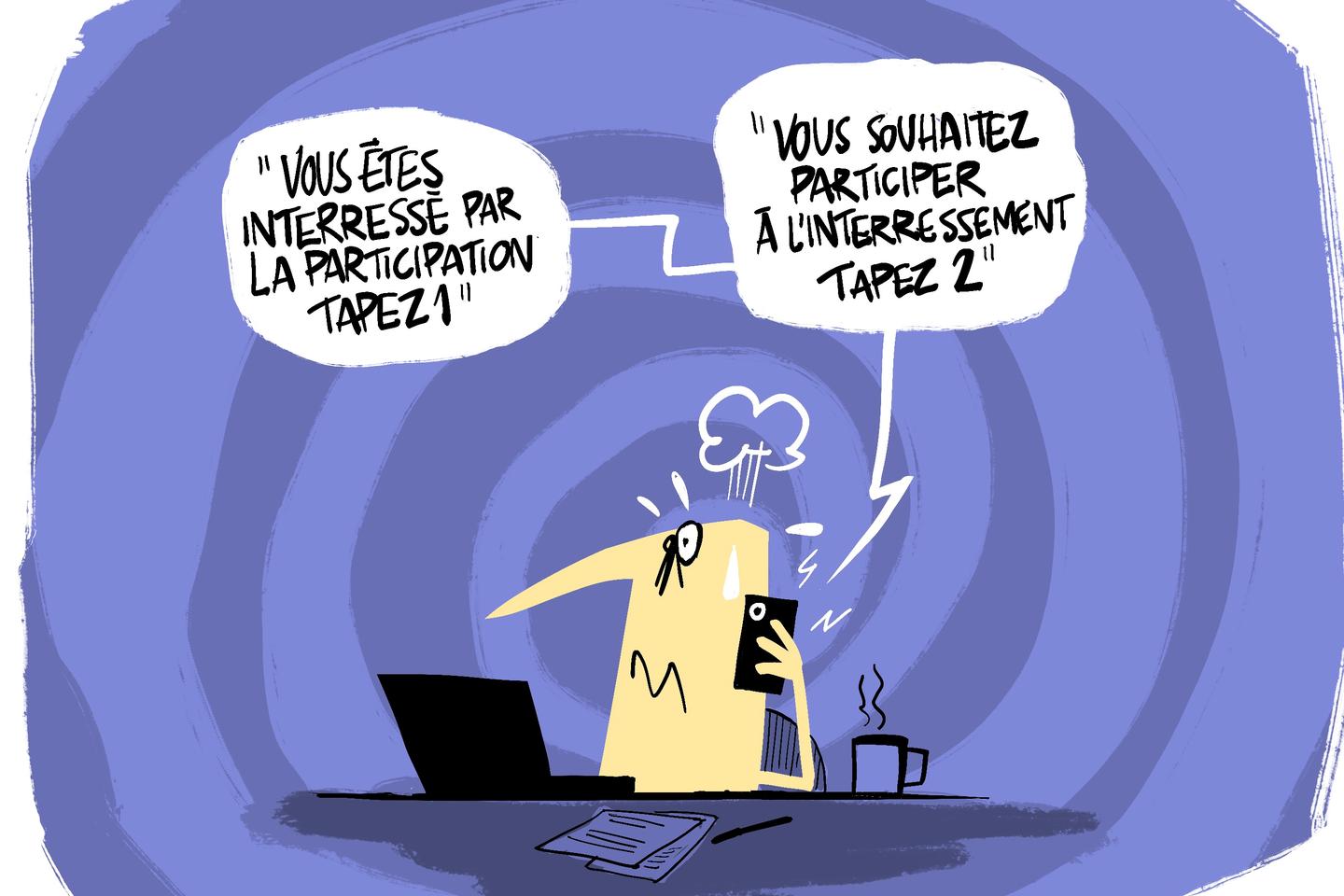« La Poésie de Madagascar », anthologie de Dominique Ranaivoson, Seghers, 368 p., 23 €, numérique 16 €.
A Madagascar, l’« île aux syllabes de flamme », selon les mots de l’écrivain malgache Jacques Rabemananjara (1913-2005), la poésie est une passion collective. On la diffuse sur les ondes de la radio nationale. On la déclame en famille pour célébrer les grands moments de la vie. On l’écoute au théâtre, dans les rues de la capitale, Antananarivo, dans des tournois de slam où de jeunes poètes perpétuent la tradition d’une poésie orale indissociable de la vie sociale. Comme celle du « kabary », une forme de discours poétisé dont l’origine remonte au XVe siècle, inscrite désormais par l’Unesco sur la liste du Patrimoine immatériel de l’humanité. Sur l’île, la poésie s’écrit et se déclame autant en malgache qu’en français – legs de la période coloniale (1896-1946), au cours de laquelle la France imposa sa langue, sans pour autant interdire l’usage du malgache. Plus qu’un genre littéraire populaire, la poésie représente un enjeu identitaire puissant. « La vie matérielle, culturelle et psychique du Malgache baigne dans la poésie, si elle n’est pas elle-même poésie », écrivait le poète Flavien Ranaivo (1914-1999).
Cette effervescence, Dominique Ranaivoson y est attentive depuis presque trente ans. Spécialiste des « littératures des Suds », elle enseigne la littérature comparée à l’université de Lorraine et réside à Madagascar une partie de l’année. Cette passion est à l’origine de l’anthologie La Poésie de Madagascar, qu’elle définit, explique-t-elle au « Monde des livres », « comme une promenade dans un imaginaire tantôt proche, voire commun, tantôt lointain ».
Il vous reste 78.48% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.