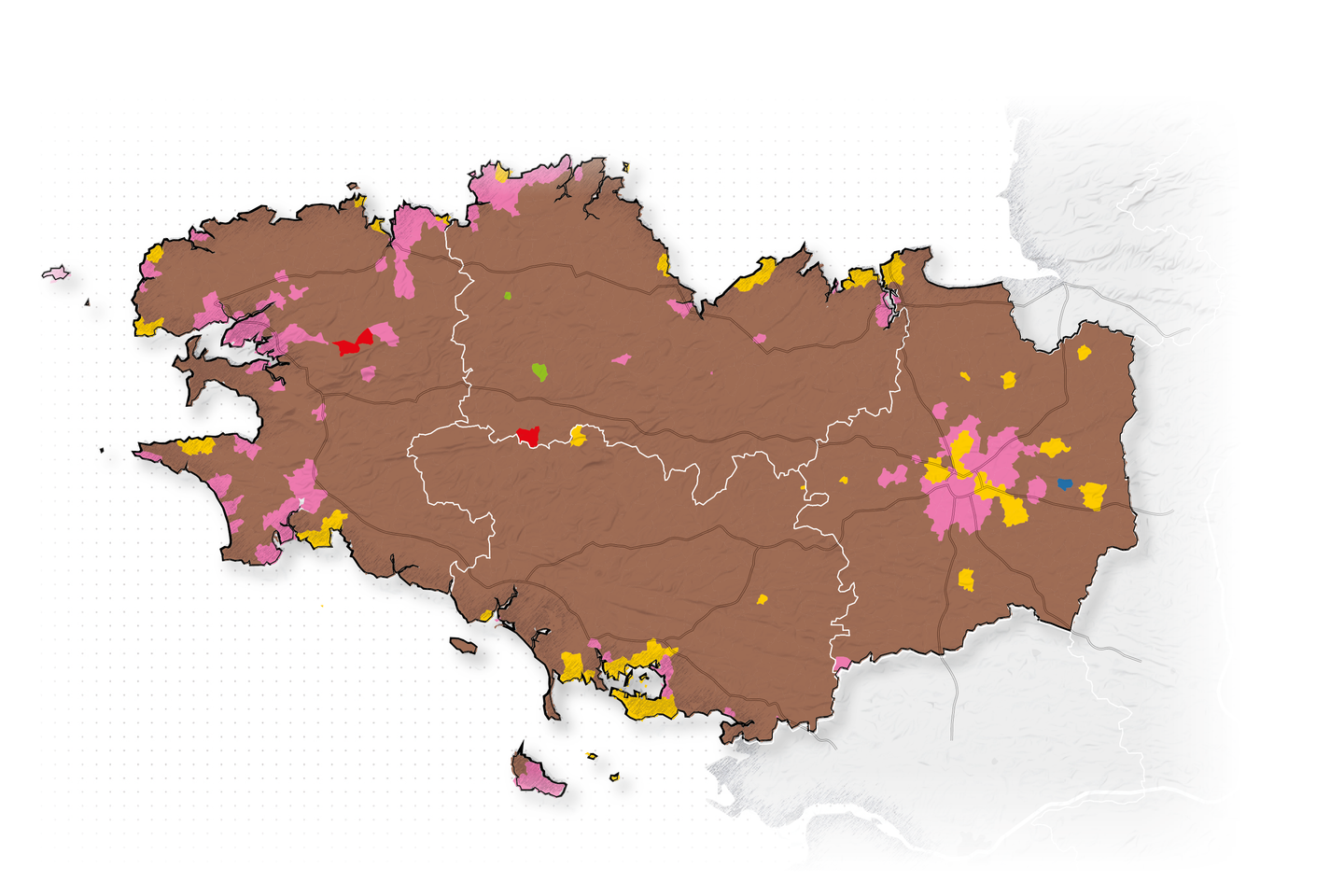Le Conseil constitutionnel est-il une institution de premier rang de notre République, destinée à accueillir en son sein les profils les plus qualifiés, ou bien est-ce au contraire une institution subalterne, appelée à accueillir des profils sans légitimité, nommés au gré des circonstances politiques ? La nomination envisagée de Richard Ferrand à la présidence du Conseil constitutionnel par le président de la République donne à cette question une actualité particulière et éclaire le peu de considération d’une partie de notre classe politique à l’égard de cette institution, dont le rôle est pourtant prépondérant.
Avec les deux autres cours suprêmes que sont le Conseil d’Etat et la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel est un garant de l’Etat de droit et de la protection des libertés fondamentales. Il vérifie de la conformité de la loi à la Constitution avant son vote, mais aussi après sa promulgation, par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité, instituée en 2008. Il décide aussi de la constitutionnalité de l’usage et du champ d’application du référendum, est juge des élections nationales et des comptes de campagne, est consulté sur l’emploi de l’article 16 [en période de crise, il donne des pouvoirs étendus au président], etc.
Autant de matières qui ont fait, ou feront peut-être, l’actualité politique et constitutionnelle. A la tête du Conseil, le rôle du président est considérable : en cas de partage des voix, la sienne est prépondérante ; il représente l’institution ; il dirige ses services ; il joue un rôle de représentation essentiel auprès des autres cours suprêmes en France, mais aussi des barreaux, et entretient ainsi des contacts avec les cours constitutionnelles européennes et la Cour européenne des droits de l’homme.
Critère politique
L’image d’impartialité, tant objective que subjective, de l’institution, comme l’exige la Cour européenne des droits de l’homme, doit être intacte et ses membres insoupçonnables et irréprochables. A rebours des autres cours constitutionnelles européennes, nées souvent au lendemain de la seconde guerre mondiale pour protéger l’Etat de droit contre des parlements à la dérive, il n’existe cependant chez nous aucune exigence de compétence juridique reconnue, ni a fortiori d’intégrité morale. Si, chez les autres pays européens, l’orientation politique ou philosophique est un critère de choix second, il devient bel et bien premier en France si l’on en juge par les nominations des dernières années.
Il vous reste 63.87% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.