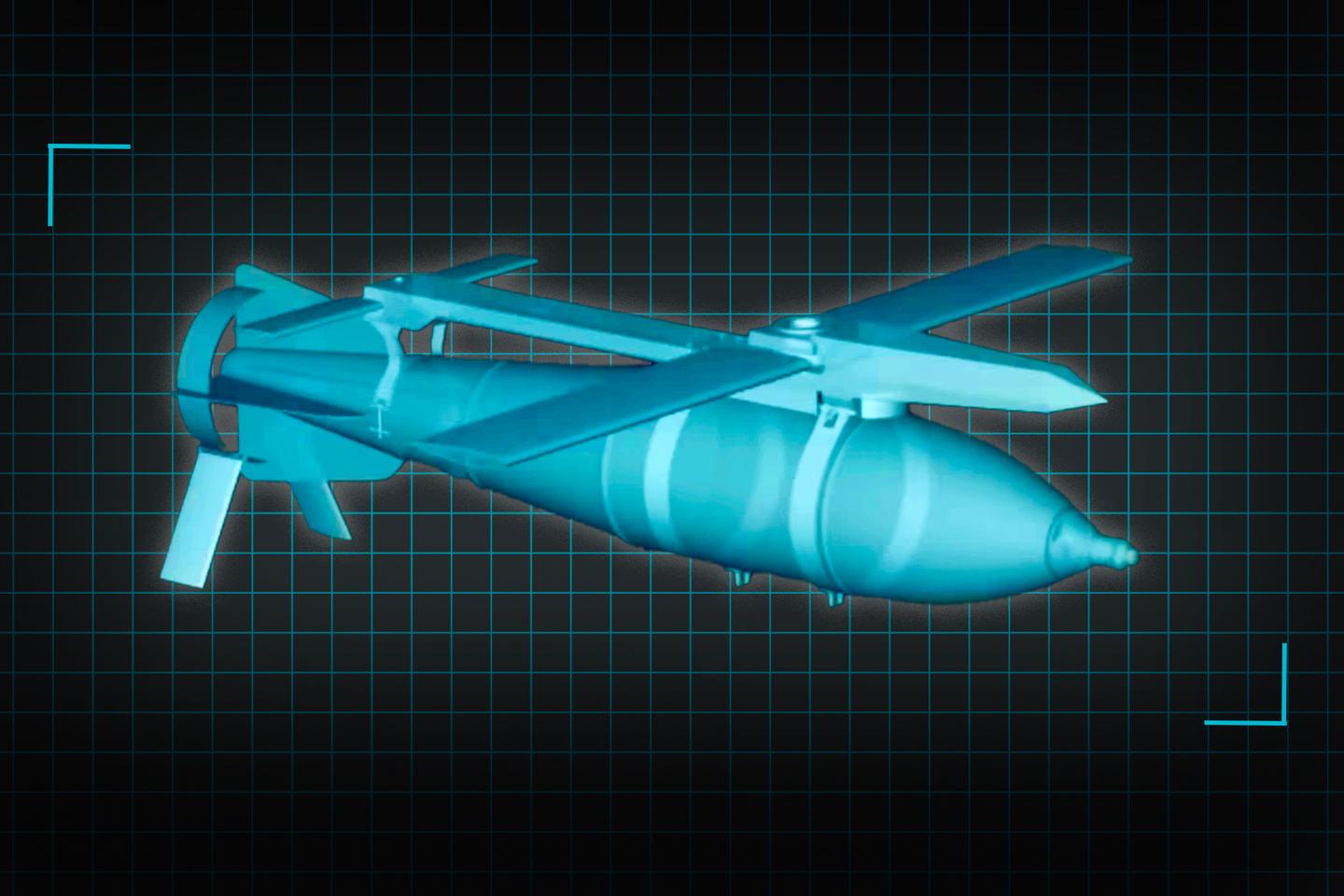Parmi les nombreux commentaires qui ont accompagné le décès du pape François, auquel a succédé Léon XIV, l’un est revenu de manière récurrente : ce pape réformateur, critique de la centralisation romaine et du pouvoir de la curie, aurait gouverné lui-même de manière centralisatrice, voire autoritaire, pour imposer ses vues. On a dénoncé alors la contradiction entre les principes proclamés – collégialité, décentralisation, synodalité – et une pratique de gouvernement qui a concentré les décisions importantes dans les mains du pape.
Ce paradoxe n’est pourtant ni inédit ni propre à François. Il est bien connu des sciences sociales, et il a été formulé dès les origines de la sociologie historique par Max Weber (Economie et société, 1921). Toute transformation profonde d’une société ou d’une organisation – qu’elle repose sur des logiques traditionnelles ou modernes et bureaucratiques – exige l’autorité d’un leader charismatique.
Il serait en effet naïf de croire que les élites en place peuvent modifier les routines organisationnelles, non seulement parce qu’elles n’y ont vraisemblablement pas intérêt, mais aussi – et peut-être surtout – parce qu’elles manquent des catégories culturelles ou cognitives qui leur permettraient de les mettre en cause. D’où ce constat, chez Weber, que toute révolution commence ou s’achève avec un leader charismatique fort, dont l’autorité centralisatrice amorce ou confirme la rupture.
Culture du soupçon
Cette thèse a longtemps été jugée suspecte dans les démocraties libérales, car l’expérience des régimes totalitaires, dans la première moitié du XXe siècle, a déprécié durablement toute forme d’exercice du pouvoir personnel d’un « chef ». La figure du leader charismatique a été associée à l’oppression autocratique. Seul a échappé à la critique le leader communiste ou postcolonial. Mais les dérives autoritaires de ces figures ont fini par les délégitimer à leur tour. Dans les sociétés occidentales, une culture du soupçon s’est ainsi imposée à l’égard de toute incarnation de l’autorité par une personne charismatique, autant dans les institutions politiques ou religieuses que dans les entreprises.
Il vous reste 39.35% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.