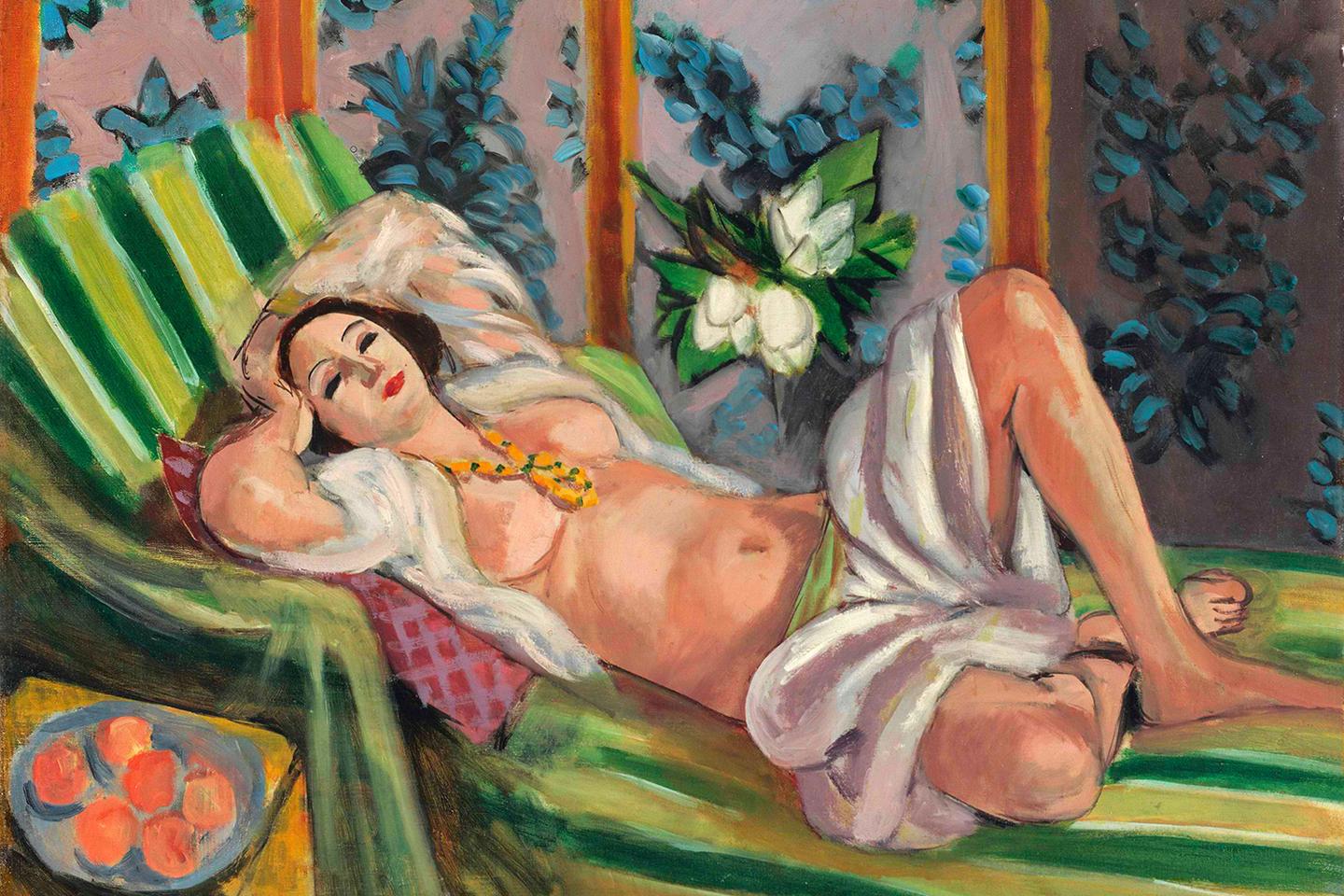Sur le toit-terrasse d’un hôtel de la Croisette, l’équipe d’Alpha, de Julia Ducournau, affrontait une journée marathon d’interviews, lundi 19 mai, avant la montée des marches, à 22 heures. A 43 ans, la réalisatrice et scénariste est déjà une star du film de genre, après la Palme d’or remportée en 2021, avec Titane. La voici de retour à Cannes, de nouveau en compétition, avec son troisième long-métrage, Alpha. L’histoire d’un trio, confronté à l’irruption d’une étrange maladie – le sida, même si le virus n’est pas nommé : soit une femme médecin (Golshifteh Farahani), son frère contaminé (Tahar Rahim), et sa fille Alpha (Mélissa Boros). A l’approche de la mort, les corps deviennent des statues de marbre.
Pourquoi avez-vous éprouvé le besoin de revenir sur l’époque du sida ?
Mon film raconte cette violence absolue qui a été faite aux malades du sida, dans les années 1980-1990. Le miroir qui nous a été renvoyé de la société, stigmatisant les malades, est un traumatisme dont il est impossible de faire le deuil. Bien sûr, la pandémie récente du Covid-19 a été horrible. Mais il n’y a pas eu un tel pointage d’une frange particulière de la population – homosexuels, toxicomanes – comme ce fut le cas au moment du sida. On a pu entendre que c’était de leur faute, qu’ils étaient des pécheurs et qu’ils méritaient ce qui leur arrivait. Mon film parle de cette contamination de la peur, qui a été le réel traumatisme pour moi. Ces morts, on en a fait des tabous. Le film est d’ailleurs rempli de dialogues et d’injonctions, du type « Ne dis rien », ou « Chut, tu parles trop fort ». Ces non-dits font que ça macère, ça moisit, et le cycle de violence ne peut que recommencer.
Il vous reste 62.25% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.