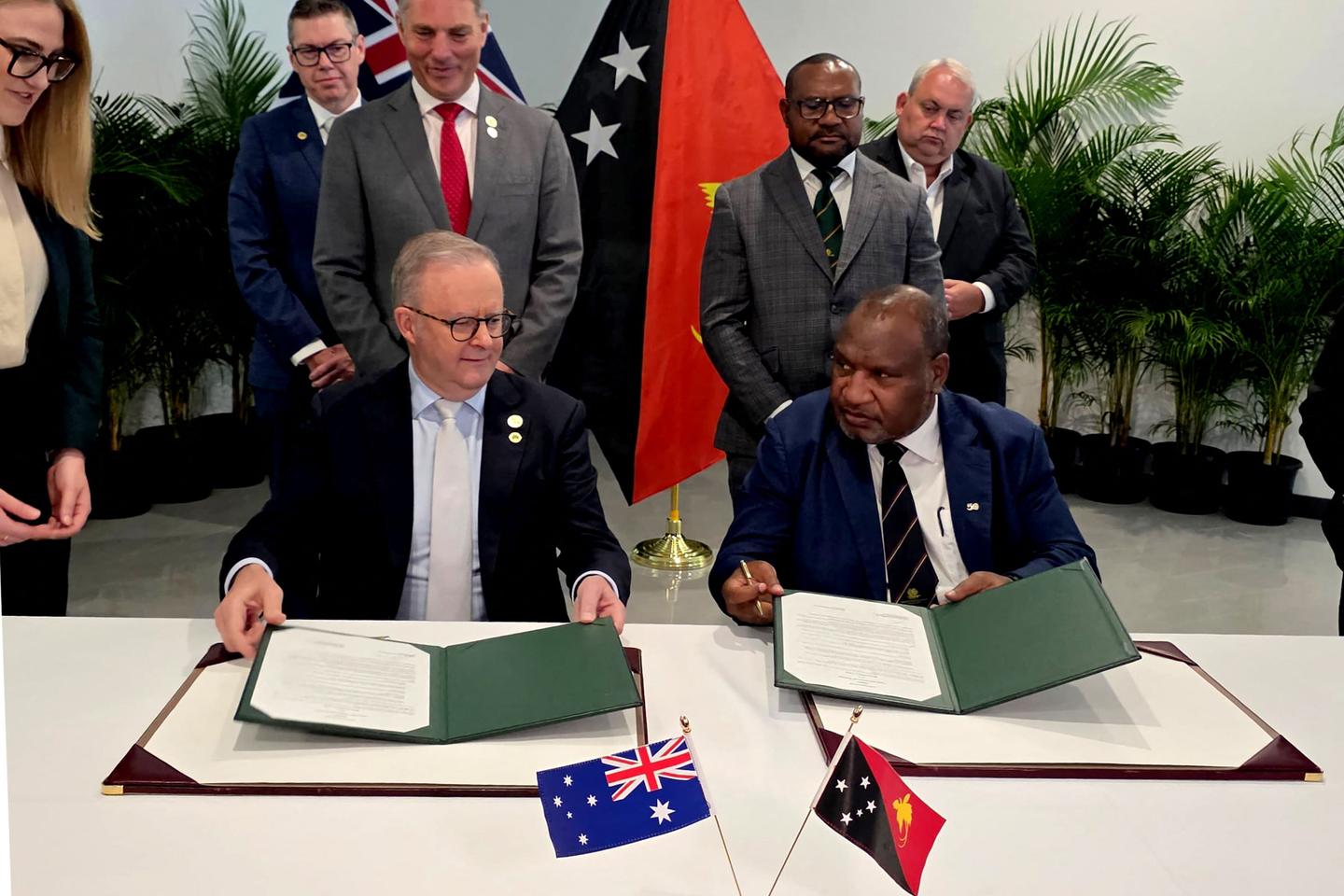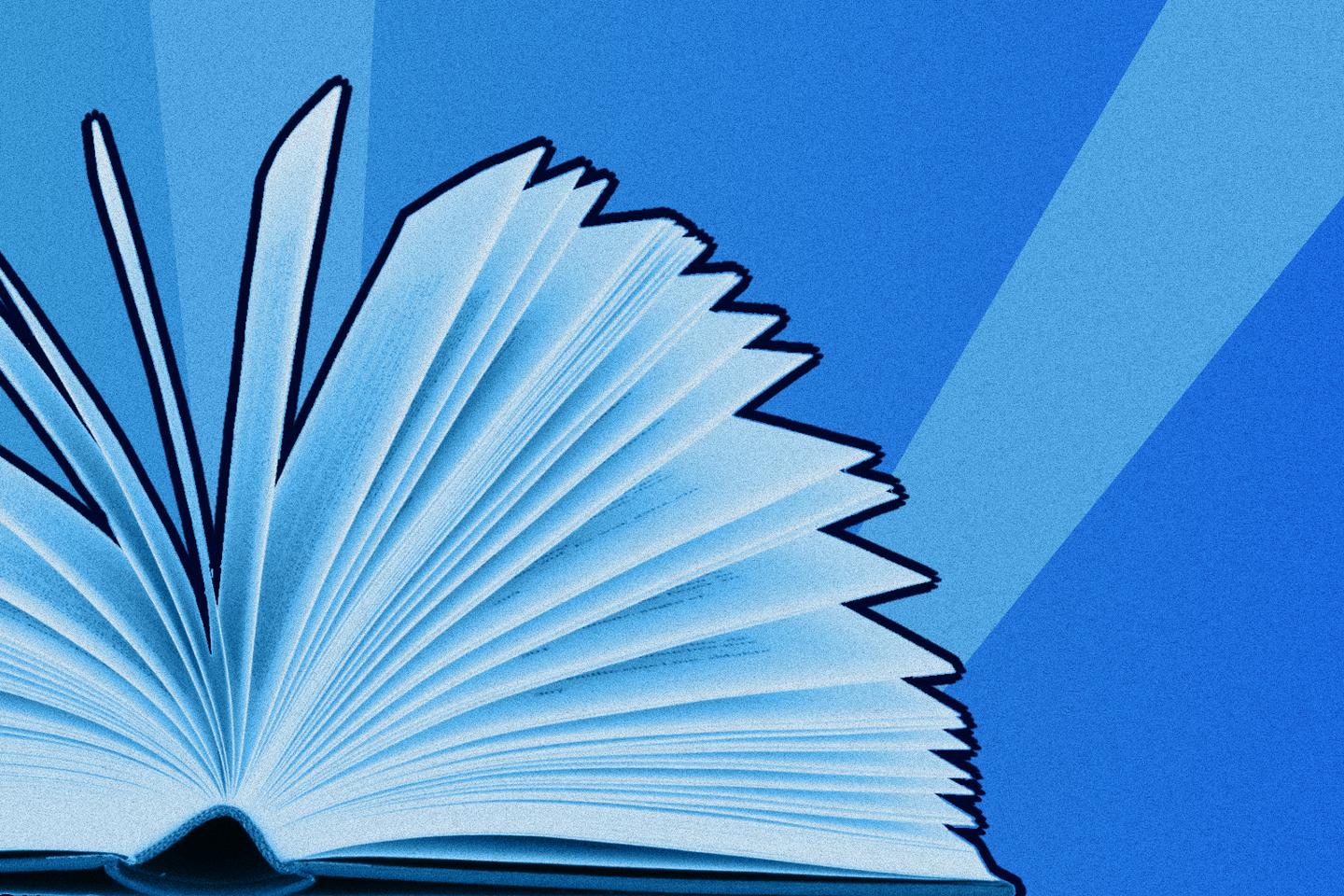Il a contribué à donner ses lettres de noblesse à la religion des faits au sein d’une presse française qui, historiquement, préférait le commentaire et le style. Au Monde, où il est resté quatorze ans, le nom de James Sarazin, décédé le 5 août à l’âge de 82 ans, reste attaché à un tournant en matière de traitement des affaires de police et du grand banditisme.
Son caractère ne le prédisposait guère à la chronique docile du discours officiel. Il s’est appliqué dans nos colonnes, puis dans celles du magazine L’Express, à opposer au pouvoir établi une information scrupuleuse et indépendante. Enquêteur dans l’âme, il a, dans le même temps, résisté aux sirènes du militantisme au cours d’une période pourtant très politique.
Né le 23 janvier 1943 à Nogentel (Aisne), village où il demeurait toujours au terme de sa vie, James Sarazin n’a pas commencé sa carrière comme journaliste. Il a d’abord enseigné le français et les mathématiques au collège d’enseignement technique des Chesneaux, à Château-Thierry, puis l’histoire-géographie au lycée agricole de Crézancy. Des débuts qui l’ont sans doute prémuni d’une forme de mythification de ce métier et du goût de l’entre-soi. En 1963, il intègre le Centre de formation des journalistes (CFJ), rue du Louvre, à Paris, avant de faire ses classes à L’Est républicain, au Parisien libéré, à Europe 1 et à l’Agence centrale de presse.
Il vous reste 73.19% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.