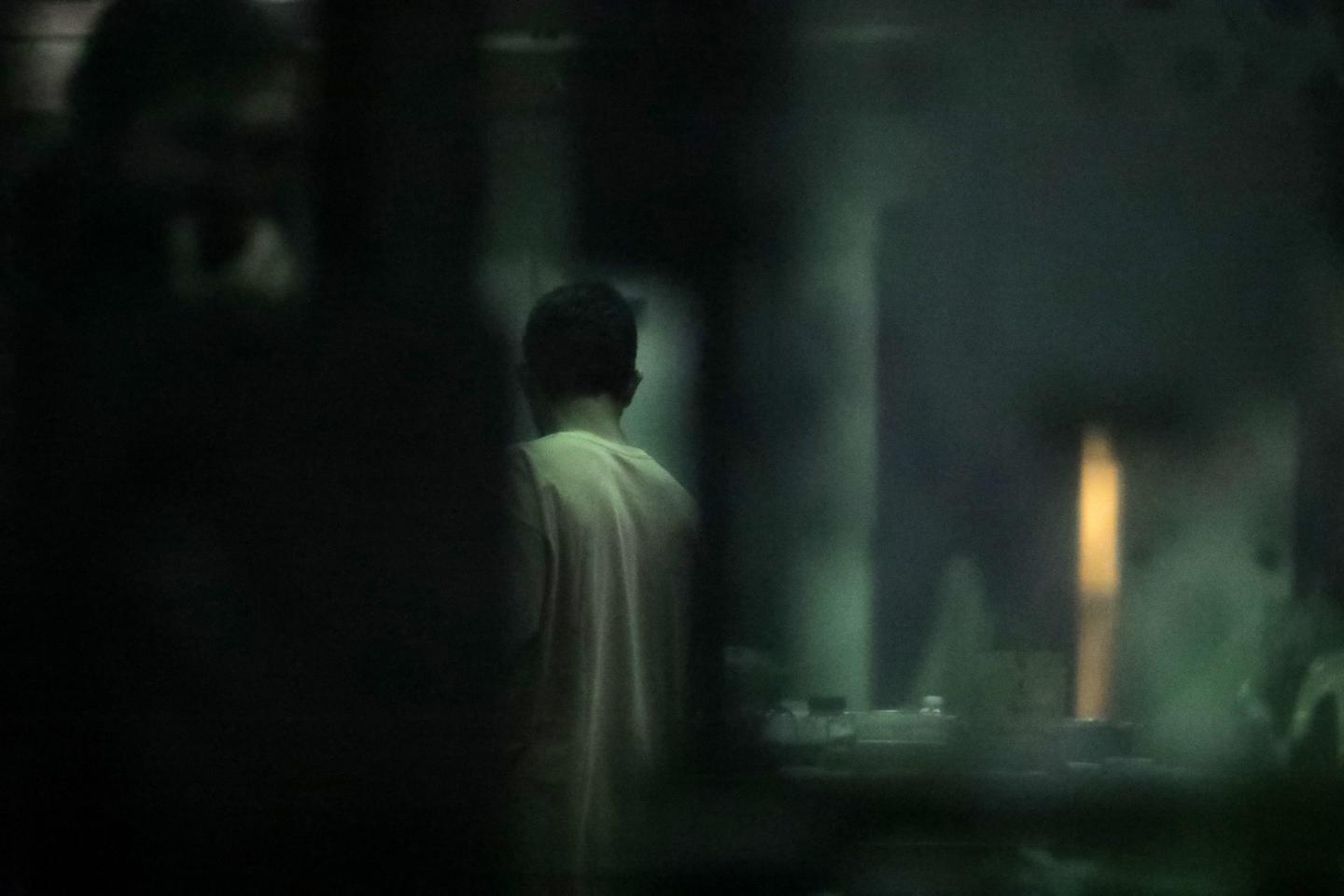La liste des joueurs internationaux de rugby qui prennent leur retraite prématurément s’allonge. Lundi 15 septembre, Paul Willemse a annoncé à son tour officiellement remiser les crampons, sur son compte Instagram. L’ancien deuxième-ligne du Montpellier Hérault Rugby (MHR) et du XV de France, avec qui il avait signé un grand chelem en 2022 dans le Tournoi des six nations, victime de « plusieurs commotions », a estimé qu’il était temps pour lui de « tourner la page ».
« Arrêter après plusieurs commotions a été une décision très difficile », concède le rugueux deuxième-ligne d’origine sud-africaine, 32 ans seulement et sans club depuis l’annonce de son départ, au début de juin, du MHR, avec qui il avait disputé sa dernière rencontre, le 5 octobre 2024.
Le colosse montpelliérain a subi six commotions en moins de deux ans, dont une dernière, lors de la 5e journée du Top 14 2024-2025, sur la pelouse du Stade français, après un choc en apparence anodin avec le deuxième-ligne sud-africain Juan John van der Mescht qui avait à nouveau touché son cerveau.
« J’ai longtemps essayé de continuer, parce que quand on n’a vécu que pour une seule chose, c’est effrayant d’imaginer la vie sans. Mais aujourd’hui j’ai trouvé la paix avec cette décision », ajoute le natif de Pretoria, arrivé en France en 2014 et qui avait finalement choisi de représenter le XV de France, dont il a porté le maillot à 32 reprises. Champion du monde des moins de 20 ans avec l’Afrique du Sud en 2012, Willemse s’était révélé à Montpellier en 2014, où il était devenu un des hommes de base du pack de l’équipe, alors, dirigée alors par son compatriote Jake White.
Procès et recours en justice
Le cas de Willemse n’est pas isolé. Avant lui, son compatriote franco-sud-africain Bernard Le Roux – avec qui il a formé la deuxième ligne de l’équipe de France de Fabien Galthié – a été contraint de s’arrêter à la suite d’une commotion, subie en 2022. Et l’international gallois Ashley Smith avait été contraint de se retirer en 2015, le Néo-Zélandais Kane Hames en 2017, tous deux victimes de séquelles persistantes de commotions.
Traumatisme crânien « léger », les commotions cérébrales peuvent provoquer des troubles immédiats, comme des maux de tête, des vertiges, une confusion, ou une brève perte de conscience. Accumulés, ils peuvent ensuite conduire à des troubles neurologiques avec des pertes de mémoire sévères, des troubles de l’humeur ou encore occasionner des pathologies neurodégénératives de façon précoce. En avril, l’ancien international français Sébastien Chabal (62 sélections) avait remis en lumière ce fléau en témoignant n’avoir « aucun souvenir » des rencontres qu’il a disputées, dans un entretien sur la chaîne YouTube Legend.
Depuis une dizaine d’années, les témoignages se multiplient. L’ancien talonneur anglais Steve Thompson, champion du monde en 2003, a révélé souffrir de démence précoce et a engagé en décembre 2020 avec d’autres internationaux – plus d’une centaine, dont les Gallois Alix Popham et Ryan Jones, ou le Néo-Zélandais Carl Hayman – une action collective contre World Rugby et plusieurs fédérations, les accusant de n’avoir pas protégé les joueurs. Un procès doit avoir lieu en 2027. En France, une quinzaine de joueurs ont déposé en 2022 une série de recours administratifs pour manquement de la Fédération française de rugby (FFR) et de la Ligue nationale de rugby (LNR).
Ces joueurs réclament des mesures de prévention plus strictes, tant pour les joueurs et joueuses actifs, que pour les générations futures : temps de repos prolongés après une commotion, réduction des impacts répétés à la tête et suivi médical renforcé. Les instances mettent en avant les progrès accomplis, avec notamment la présence de médecins au sein de son comité médical chargés de suivre la question des commotions cérébrales, l’instauration du carton bleu – qui oblige un joueur suspecté de commotion à quitter immédiatement et définitivement le terrain, depuis 2019 – ou les protège-dents connectés, qui permettent de monitorer en direct les chocs reçus par les joueurs. Mais médecins et associations, comme Alerte Commotions, mettent en garde concernant une persistance des manquements, en particulier dans le rugby amateur.