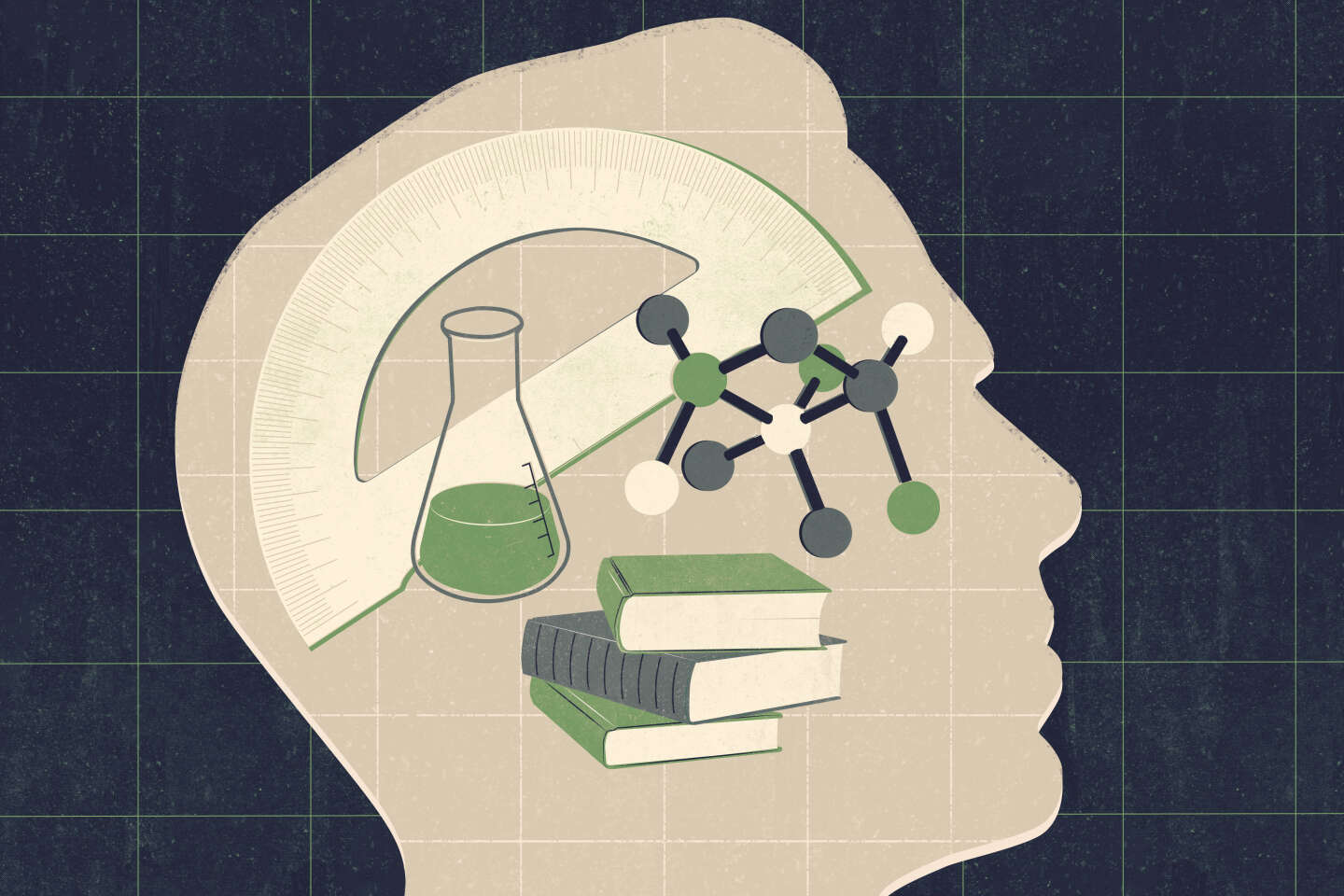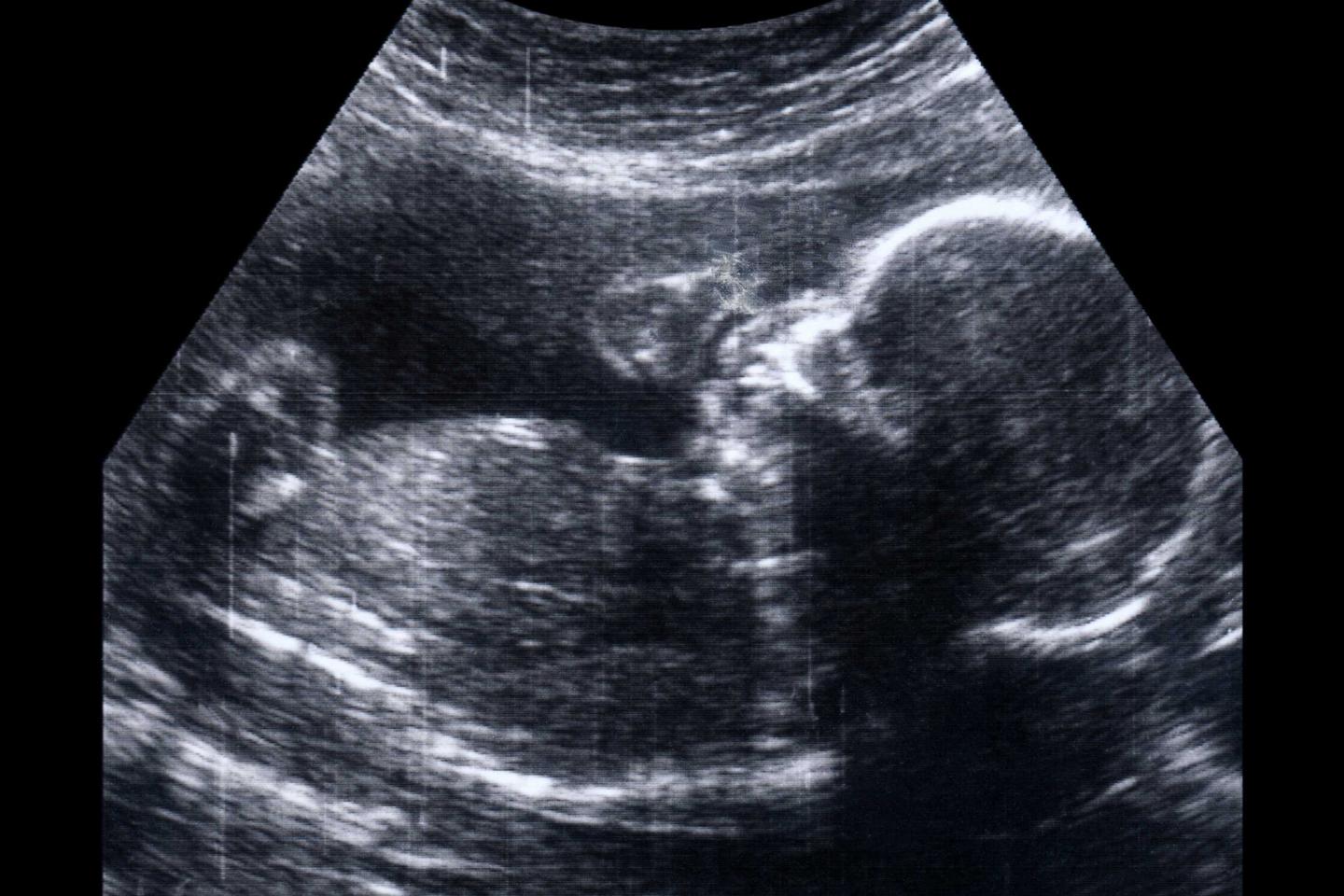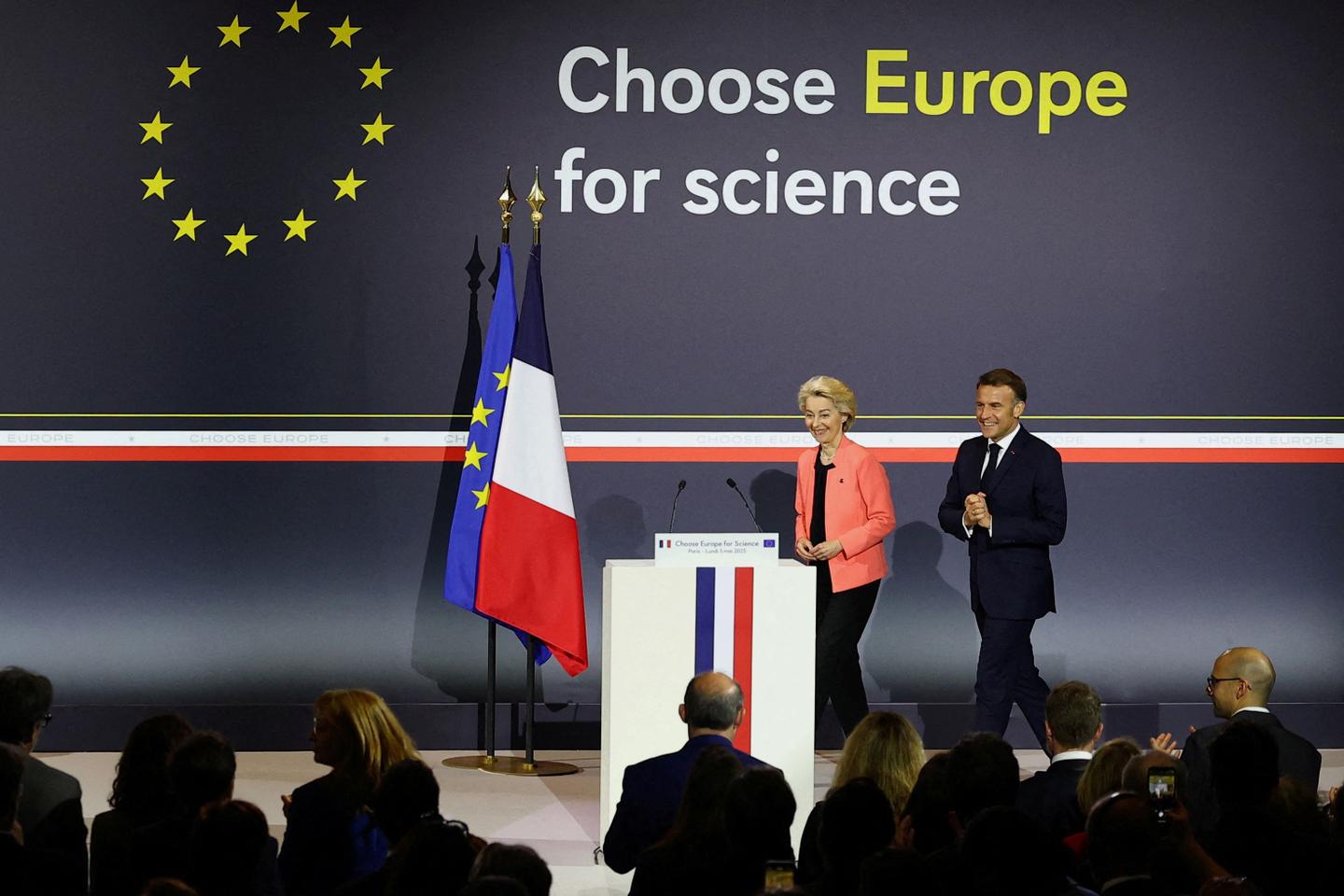C’est l’histoire d’une petite fille de quatre ans qui présente une accélération inexpliquée de son rythme cardiaque et la possibilité d’une aggravation de l’activité épileptique. La fillette souffre en effet d’hyperglycinémie sans cétose, une maladie génétique affectant le métabolisme d’un acide aminé, la glycine. Celle-ci se manifeste par un retard de développement et une épilepsie généralement modérée dans la petite enfance.
Les symptômes, plus ou moins sévères de cette pathologie rare, sont causés par l’accumulation de glycine dans les tissus, notamment dans le cerveau. Dans cette famille, deux autres enfants sont atteints de cette même maladie.
En conséquence, la petite fille présente un retard de vidange gastrique et une mauvaise motilité gastro-intestinale. Elle dépend, pour son alimentation, d’une sonde de gastrojéjunostomie, c’est-à-dire un tube qui pénètre dans le corps par l’abdomen et aboutit dans l’estomac pour délivrer des médicaments et dans l’intestin grêle (jéjunum) pour assurer la nutrition.
La fillette est hospitalisée dans un centre médical universitaire à Baltimore (Maryland, Etats-Unis). Les parents déclarent à l’équipe soignante qu’elle présente depuis quatre mois des symptômes intermittents, accompagnés de vomissements quasi-quotidiens à la maison, ce qui a entraîné plus d’une douzaine d’hospitalisations, survenant environ tous les huit jours. Ils indiquent avoir remarqué chez leur fillette une augmentation des mouvements des membres supérieurs et inférieurs, ainsi qu’une cambrure du dos, de même qu’une position anormale des mains et des pieds. Elle ne présente aucun autre signe de maladie, pas de fièvre et n’a pas voyagé récemment. Ses vaccins sont à jour.
Les examens biologiques sanguins révèlent la présence d’une rhabdomyolyse, syndrome témoignant d’une dégradation du tissu musculaire squelettique, qui entraîne le relargage dans le sang d’enzymes musculaires, dont la créatine kinase (CK), la myoglobine, et divers électrolytes.
Chez cette enfant, le taux de CK est de 101 400 unités/L, alors que le taux normal pour un enfant de moins de 10 ans est habituellement compris entre 20 et 120 U/L. Le taux de myoglobine est de 2 252 nanogrammes/mL (valeurs normales généralement entre 25 et 72 ng/mL). Il existe également une hypokaliémie, c’est-à-dire une diminution du taux sanguin de potassium. Celui-ci est de 2,7 mEq/L, alors que la concentration sérique du potassium est normalement supérieure à 3,5 mEq/L. L’électrocardiogramme (ECG) montre une fréquence cardiaque rapide à 192 battements par minute (tachycardie sinusale). Sa température corporelle est normale à 36,4 °C. Enfin, l’électroencéphalogramme (EEG) ne met pas en évidence de modifications de l’activité épileptique.
À l’examen clinique de la fillette, les médecins observent des mouvements continus des extrémités des membres supérieurs et inférieurs.
Au vu des données cliniques (mouvements anormaux) et biologiques (rhabdomyolyse et hypokaliémie), les médecins entreprennent de rechercher la prise de stimulants. C’est alors que les analyses de sang révèlent une concentration sérique de caféine supérieure à 60 microgrammes/mL. Il faut savoir que des décès peuvent survenir à des concentrations supérieures à 80 microgrammes/mL, la mortalité étant souvent observée en dessous de 200 microgrammes /mL. Les examens n’ont en revanche pas montré de traces de cocaïne et d’amphétamine dans le sang de l’enfant.
Dans un tel contexte, il importe de souligner que les nourrissons semblent présenter une meilleure tolérance à la toxicité de la caféine que les enfants plus âgés et les adultes. Les concentrations plasmatiques de caféine peuvent être mesurées dès 30 à 45 minutes après l’ingestion, avec un pic généralement observé environ deux heures plus tard.
Les analyses de laboratoire sont répétées et confirment que l’on est bien en présence d’une intoxication grave à la caféine. Le médecin traitant est aussitôt contacté afin de s’assurer qu’aucun autre enfant de la famille ne prend de médicaments contenant de la caféine. La pharmacie qui délivre habituellement les médicaments aux parents confirme l’absence d’erreur de délivrance. Le centre antipoison local est contacté pour plus d’informations sur la conduite à tenir chez un si jeune enfant victime d’une intoxication grave à la caféine.
Enfin, les services de protection de l’enfance sont mobilisés. Une enquête est menée pour rechercher la source de caféine chez cette très jeune patiente, les parents se montrant très coopératifs. Elle va révéler que l’apparition des premiers symptômes coïncide avec l’arrivée d’une nouvelle infirmière à domicile. L’intoxication est donc due à un acte de maltraitance commis par l’infirmière qui a délibérément provoqué une pathologie chez l’enfant dont elle avait la charge.
Les motivations dans cette affaire restent floues. Il est possible que l’infirmière ait souhaité faire hospitaliser l’enfant ou voulu voir ce que l’administration de caféine pouvait provoquer chez cette enfant.
La petite fille a été placée en observation en unité de soins intensifs pédiatriques jusqu’à disparition de la rhabdomyolyse, diminution des mouvements et disparition de l’hypokaliémie. La fillette a pu réintégrer le domicile familial et n’a plus présenté les symptômes qui l’avaient conduite à être hospitalisée.
Il est rare d’observer chez des enfants qui ne parlent pas encore, ou qui commencent tout juste à parler, une consommation de caféine atteignant des concentrations suffisantes pour provoquer des signes de surdosage sévère. Par ailleurs, la survenue d’une rhabdomyolyse lors d’une intoxication à la caféine est également rare.
Il n’existe pas d’antidote spécifique de la caféine. En cas d’intoxication, le traitement est symptomatique et repose sur un ensemble de mesures : charbon activé pour adsorber la caféine, antiémétiques pour lutter contre les vomissements, réhydratation pour lutter contre l’hypotension, bêtabloquants pour traiter la tachycardie. En cas de convulsions, l’emploi de benzodiazépines est approprié. Lorsqu’existe une hypokaliémie, l’administration de potassium est justifiée en surveillant étroitement et fréquemment les taux sanguins.
Dans certains cas, une hémodialyse est indiquée. Cette technique consiste à épurer le sang à l’aide d’un rein artificiel. Elle est plus facilement disponible que l’hémoperfusion, méthode d’épuration sanguine dont le principe consiste à faire passer le sang directement au contact d’un adsorbant contenu dans une cartouche, le plus souvent du charbon activé.
Quand un adolescent avale le café de son père
On recense plusieurs cas pédiatriques d’intoxication accidentelle ou volontaire à la caféine dans la littérature médicale.
En 2023, des médecins nigérians ont rapporté dans les Annals of African Medicine le cas d’un garçon de 12 ans dont les parents avaient évidemment refusé qu’il boive du café à son âge. Un jour, il a bu en cachette celui de son père, ingérant alors 51 mg de caféine, soit environ 1,5 mg par kilo de poids corporel.
La dose ingérée a provoqué de nombreux symptômes inquiétants. Le jeune garçon a présenté un discours incohérent, un comportement agressif ainsi que des hallucinations visuelles et auditives. De plus, il souffrait de fortes douleurs abdominales, vomissait à de multiples reprises. Son rythme cardiaque était rapide (140 battements par minute). D’autres anomalies biologiques étaient présentes, notamment une hypokaliémie. Il a bien répondu au traitement qui comprenait notamment réhydratation, benzodiazépine et potassium.
Grave erreur médicale dans un service de réanimation néonatale
En 1999, dans la revue Anaesthesia and Intensive Care, des pédiatres néo-zélandais ont décrit le cas d’un bébé prématuré, né à la 31e semaine de grossesse et pesant 1,8 kg. Cette petite fille souffrait d’apnée et sa saturation en oxygène était dangereusement descendue à 70 %. Elle avait reçu par erreur une dose toxique de caféine. Il faut savoir que la caféine est en effet un stimulant utilisé pour traiter l’apnée chez les prématurés et qu’elle réduit les épisodes où le taux d’oxygène dans le sang chute rapidement.
Une dose de 25 mg/kg, soit 46 mg au total, avait initialement été prescrite. Mais une erreur administrative – d’un facteur dix – s’est produite et une perfusion de 460 mg de caféine a été mise en route et délivrée sur une durée d’une heure.
Le nouveau-né a rapidement présenté des signes évocateurs d’une toxicité à la caféine : irritabilité, nervosité, hypertonie, sueurs, tachycardie. Sa fonction respiratoire s’est détériorée sous l’effet combiné d’un syndrome de détresse respiratoire et d’une insuffisance cardiaque. Il a été admis en unité de soins intensifs néonatals pour une ventilation mécanique. Un œdème pulmonaire a été constaté. L’insuffisance cardiaque a été prise en charge par un traitement diurétique.
La fonction respiratoire s’est progressivement améliorée et l’extubation a été possible au cinquième jour, suivie d’une ventilation au masque jusqu’au septième jour. Le quatrième jour, une élévation marquée de l’enzyme musculaire créatine kinase a atteint 907 U/L, témoignant d’une rhabdomyolyse. Le nourrisson s’est heureusement rétabli et aucune séquelle n’a été détectée lors des six mois suivants.
Un bébé avale des gélules amincissantes à la caféine
En 1990, des médecins américains ont décrit dans la revue Pediatric Emergency Care le cas d’une petite fille âgée d’un an qui a ingéré les gélules amincissantes de sa mère, à base de caféine, soit entre 2 et 3 g de caféine. Quatre heures plus tard, son taux sanguin de caféine culminait à 385 microgrammes/mL, un chiffre alarmant.
La situation s’est rapidement détériorée, avec survenue d’anomalies du rythme cardiaque (arythmie ventriculaire), convulsions violentes, troubles métaboliques et œdème pulmonaire. Malgré la gravité de l’intoxication et un taux sanguin de caféine parmi les plus élevés jamais rapportés chez un patent survivant, la petite fille s’en est sortie sans séquelles à long terme.
Un cas tragique chez un bébé de cinq semaines
Deux autres cas se rapprochent de celui raconté en première partie de ce billet : l’un, rapporté en 1987 dans le Journal of Forensic Sciences, à propos d’un enfant de 14 mois décédé d’une intoxication et de maltraitance physique, et un second, décrit dans la revue Pediatrics en 1997, qui concerne un nourrisson de cinq semaines, victime d’un empoisonnement intentionnel à la caféine et de maltraitance physique.
Ce dernier cas relate l’histoire d’un bébé adressé à l’hôpital pour évaluation d’une tachycardie persistante. Le jour de l’admission, il est sous la garde de son père pendant que sa mère est partie travailler. À son retour à la maison, la mère constate que son bébé est agité et irritable. Sa fréquence cardiaque oscille entre 205 et 237 battements par minute. Il est agité, pleure et agite vigoureusement les bras et les jambes.
Un premier dépistage de drogues revient négatif, mais un dépistage plus complet effectué par chromatographie en phase gazeuse et spectrométrie de masse révèle la présence de caféine. Le taux sérique est de 117 mg/mL, alors qu’à cet âge les valeurs sont comprises entre 5 et 12 mg/mL lorsque la caféine est utilisée à des fins thérapeutiques.
L’état clinique de l’enfant s’améliore progressivement durant l’hospitalisation. L’irritabilité et la tachycardie cessent au bout de 36 heures. On ignore alors l’origine de son intoxication à la caféine. Cependant, les taux sont bien trop élevés pour être compatibles avec un transfert de la mère à l’enfant via le lait maternel.
Un signalement est fait aux services de protection de l’enfance. L’enfant est retiré du domicile familial et confié à sa grand-mère, tandis que le père n’est plus autorisé à entrer en contact avec lui. Peu de temps après, la mère récupère son bébé.
Trois semaines après sa sortie de l’hôpital, l’enfant est de nouveau admis en réanimation suite à un arrêt cardiorespiratoire prolongé. Sa mère déclare avoir laissé l’enfant sous la garde de son père pendant une heure. À son retour, elle le met au lit et le découvre en arrêt respiratoire quinze minutes plus tard lorsqu’elle vérifie s’il dort bien. Elle entreprend une réanimation cardio-pulmonaire et appelle les secours.
Dès son admission en soins intensifs, les médecins constatent des hémorragies rétiniennes. Le scanner cérébral révèle des hémorragies sous-arachnoïdiennes. Ces deux types d’hémorragies, intraoculaires et cérébrales, sont des signes évocateurs de maltraitance physique.
Il est malheureusement déjà trop tard pour ce bébé. Une défaillance multiviscérale s’installe. Il se produit parallèlement une grave perturbation du débit sanguin cérébral (encéphalopathie hypoxique-ischémique sévère), ce qui finit par entraîner la mort cérébrale.
Le père est inculpé pour le décès de son enfant. Il a avoué lui avoir donné des comprimés de caféine (200 mg par comprimé) « pour voir ce que cela faisait ». Il avait dissous un comprimé dans le lait de l’enfant et en avait placé deux autres sous sa langue.
Pour en savoir plus :
Stephanos K, Hayes BD. Caffeine overdose resulting in seizure-like activity and rhabdomyolysis in a child : a case report. J Emerg Med. Available online 21 March 2025. doi : 10.1016/j.jemermed.2025.03.006
Adeleye QA, Attama CM, Egbeobauwaye O, Angela O. Psychosis following caffeine consumption in a young adolescent : Review of case and literature. Ann Afr Med. 2023 Jul-Sep ;22(3) :392-394. doi : 10.4103/aam.aam_28_22
Anderson BJ, Gunn TR, Holford NH, Johnson R. Caffeine overdose in a premature infant : clinical course and pharmacokinetics. Anaesth Intensive Care. 1999 Jun ;27(3) :307-11. doi : 10.1177/0310057X9902700316
Rivenes SM, Bakerman PR, Miller MB. Intentional caffeine poisoning in an infant. Pediatrics. 1997 May ;99(5) :736-8. doi : 10.1542/peds.99.5.736
Dietrich AM, Mortensen ME. Presentation and management of an acute caffeine overdose. Pediatr Emerg Care. 1990 Dec ;6(4) :296-8. doi : 10.1097/00006565-199012000-00012
Walsh I, Wasserman GS, Mestad P, Lanman RC. Near-fatal caffeine intoxication treated with peritoneal dialysis. Pediatr Emerg Care. 1987 Dec ;3(4) :244-9. doi : 10.1097/00006565-198712000-00007
Morrow PL. Caffeine toxicity : a case of child abuse by drug ingestion. J Forensic Sci. 1987 Nov ;32(6):1801-5. PMID : 3323412.