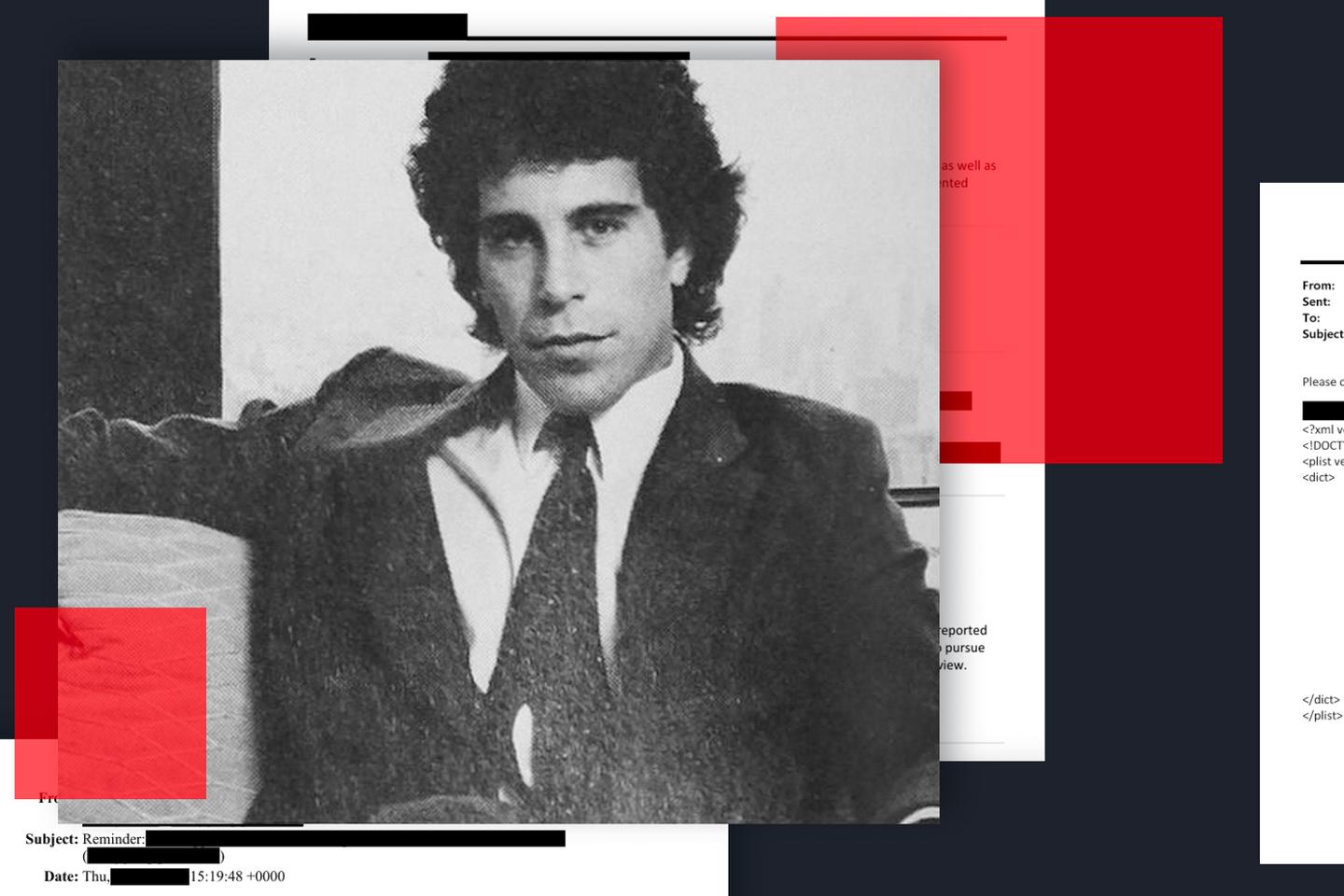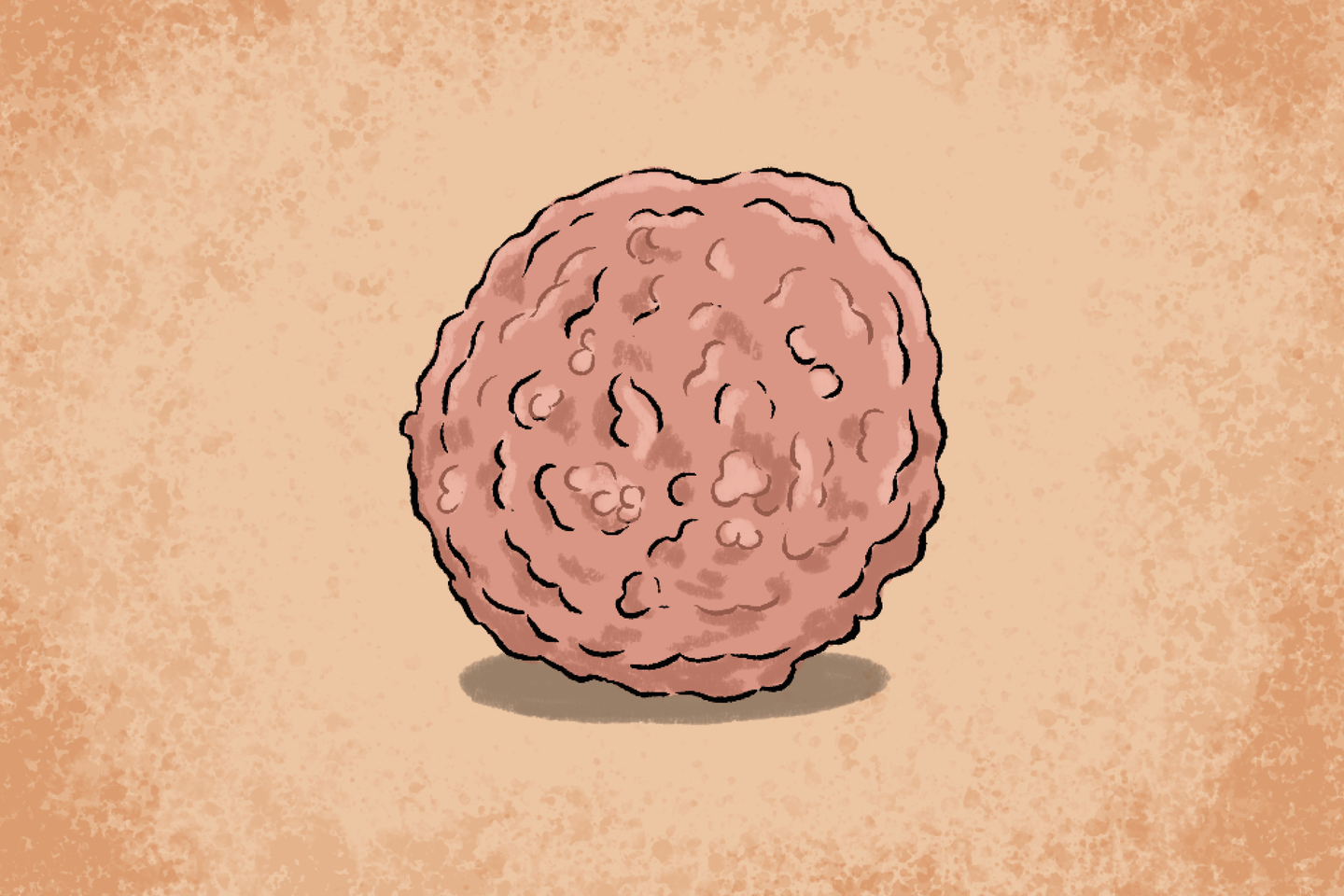La Convention citoyenne sur les temps de l’enfant s’appuie sur un constat : les élèves sont « plus fatigables » (devant l’effort scolaire) qu’avant ? Est-ce vrai ? Mais surtout pourquoi ?
Stéphane Bonnery : À ma connaissance, il n’y a pas de recherches publiées qui le démontreraient avec des mesures comparées dans le temps. Mais c’est un constat partagé par les enseignants et par des associations de parents. Je prends au sérieux ce constat, même si, cela ne peut surprendre un scientifique, les constats empiriques pointent souvent un phénomène réel sans avoir les moyens d’en comprendre les causes. En l’occurrence, les organisateurs de la Convention ont privé les citoyens tirés au sort d’éléments de compréhension du phénomène.

Comme expliqué dans Temps de l’enfant et rythmes scolaires : vraies questions et faux débats (1), un aspect central du débat a été biaisé. Dans leurs temps de vie, nos enfants ne sont pas confrontés aux mêmes situations selon leurs appartenances sociales. Dans la plupart des familles populaires, on vit les situations, on les résout, mais il n’y a pas de socialisation à étudier en permanence la situation que l’on vit. Les sorties au parc ne sont pas l’occasion d’identifier la forme triangle dans le montant de la balançoire. Quand un enfant aide à mettre la table, cela ne constitue pas une opportunité pour l’exercer au dénombrement des fourchettes ou au repérage de la droite et de la gauche. Souvent, seuls les parents ayant bénéficié d’études longues ont converti leur regard en réflexe permanent d’étude et socialisent leurs enfants de cette manière. Pour la plupart des familles, c’est seulement à l’école que cette posture cognitive peut s’acquérir. Cela suppose une forme de concentration bien spécifique, très différente de la simple immersion dans un film par exemple. Pour un enfant, se former à cette capacité de concentration en étudiant des savoirs, cela fatigue. C’est d’ailleurs une bonne fatigue, parce que l’on a fait travailler son cerveau.

Un problème majeur et souvent inaperçu ou sous-estimé, c’est que les élèves ont énormément perdu d’heures de classes depuis vingt ans. En prétextant leur fatigabilité, les politiques conduites ont fortement réduit les temps d’enseignement. Résultat : ces élèves sont moins exercés à se concentrer. Il est donc peu étonnant que les enseignants constatent qu’ils se fatiguent plus vite.
La Convention citoyenne sur les temps de l’enfant, comme les gouvernements l’ont fait depuis 50 ans, pointe ce constat en l’attribuant faussement à une caractéristique intrinsèque des enfants d’aujourd’hui. Sans chercher à l’expliquer, comme une sorte de fatalité face à laquelle on ne pourrait que céder en réduisant encore le temps de classe Ce qui va, sans aucun doute, aggraver le problème que l’on prétend résoudre, en réduisant encore le temps de concentration sur les apprentissages de savoirs, et donc en accroissant la fatigabilité des élèves.
Vous affirmez que les élèves ont moins de cours qu’avant. Avant, c’était quand ? Et peut-on quantifier cette baisse depuis, disons les années 1950 ?
Stéphane Bonnery : Comme j’en ai fait l’analyse et le décompte (2) la perte d’heures d’enseignement est énorme sur l’ensemble de la scolarité.
Pour l’école primaire (maternelle et élémentaire), de fin du XIXe siècle jusqu’à 1969, les écoliers avaient classe 6 heures par jour, du lundi au samedi inclus, sauf le jeudi. Cela représentait 30 heures hebdomadaires. Depuis 1969, ce temps scolaire hebdomadaire avait été ramené à 27 heures de classe par semaine, soit 4 journées pleines (6 heures) auxquelles s’ajoutaient les 3 heures du samedi matin. En 1972 la demi-journée vaquée a glissé du jeudi après-midi au mercredi. En 1969, l’année comprenait donc 35,5 semaines de 27 heures hebdomadaires, soit 958,5 heures. Cette situation est restée stable pendant 20 ans. Une première suppression équivalant à une heure hebdomadaire (un samedi matin sur trois vaqué) survient en 1989, pour favoriser les réunions pédagogiques sur 36 semaines désormais, soit 936 heures annuelles.
En 2008, une nouvelle réforme des rythmes scolaires est décidée par Nicolas Sarkozy et son ministre Xavier Darcos. Le temps d’enseignement a été réduit à 24 heures avec la suppression définitive du samedi matin. Le nombre annuel d’heures chute donc de 958,5 à 864, entre 1988 et 2008. Cette perte multipliée par 9 ans (de la toute petite section de maternelle au CM2) équivaut à 850,5 heures, soit presque le volume horaire d’une année scolaire actuelle !
La perte de temps scolaire en maternelle a-t-elle un impact ?
Stéphane Bonnery : En parallèle de la diminution du temps scolaire en primaire, on observe des fermetures massives des classes de Toute petite section de maternelle qui accueillaient les enfants dès deux ans. L’âge où, pour les enfants issus des milieux populaires, s’opère une rencontre décisive. Celle d’une langue différente du français ordinaire de leur famille : la langue « savante » des apprentissages. Cette langue qui permet, outre la compréhension, de changer de point de vue pour passer de « vivre une situation » à « l’étudier » grâce à des mots spécifiques des savoirs et des tournures de phrases réflexives. En 1998 (date pour laquelle le ministère a commencé à rendre disponibles les statistiques), la France scolarisait encore 35 % des enfants de l’âge de deux ans. En 2024, on était à peine à 9 %. Une réduction surtout réalisée dans les zones au public populaire, où les parents ont moins l’habitude de se mobiliser pour défendre les postes d’enseignants.
Et que s’est-il passé pour les années post-primaire ?
Stéphane Bonnery : À la rentrée 2016, une réforme du collège pilotée par Najat Vallaud-Belkacem se met en place. Si le volume global d’heures obligatoires augmente officiellement (+ 1 heure hebdomadaire en 6e, + 3 heures en 5e, horaire stable en 4e, – 2,5 heures en 3e), la réalité est différente. D’abord, le basculement d’heures en demi-groupes vers la classe entière réduit le nombre d’heures enseignantes, donc de postes. De même que la suppression des heures supplémentaires des zones d’éducation prioritaire (ZEP) pour du renforcement en mathématiques et en français. Les effets précis de ces mesures ne sont pas disponibles, il faudrait une commission d’enquête parlementaire pour mesurer l’ampleur des pertes. Ensuite, les options de latin et grec sont réduites, voire supprimées dans beaucoup de zones d’éducation prioritaire. Mais, surtout, au sein des heures que suivent les élèves au collège, survient une suppression drastique des heures d’enseignements disciplinaires puisque c’est sur elles que sont prises les nouvelles heures obligatoires dites « d’aide » (en classe entière, on attend toujours une évaluation sérieuse de ce changement…). Trois heures en 6e, et encore trois heures hebdomadaires de la 5e à la 3e pour des Enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI). Or, des études montrent que les enseignements interdisciplinaires, s’ils se font avec moins d’heures disciplinaires, creusent les inégalités sociales (3). Les élèves d’origine populaire sont enfermés dans le thème qu’ils étudient, avec trop peu de savoirs disponibles issus des disciplines pour changer de regard sur ce thème. En cumulé, la perte des horaires disciplinaires obligatoires se monte chaque semaine à deux heures en 6e, à une heure en 5e, quatre heures en 4e et 6 h 30 en 3e. Au total, 486 heures disciplinaires perdues, soit plus de la moitié d’une année scolaire !
Ajoutons la défaillance dans le remplacement des enseignants absents pour cause de maladies ou autre. Un rapport parlementaire évalue à une année d’heures de cours le temps perdu pour les élèves faute de professeurs remplaçants, surtout dans les établissements qui ont le public le plus populaire.
Ce n’est pas tout, si l’on s’intéresse à ce qui se passe après le collège. En 2009, les élèves de la voie professionnelle ont perdu une année complète de scolarité avec le baccalauréat professionnel en trois ans, remplaçant la possibilité de rejoindre ce cursus pour deux ans (1re et Terminale pro) après un BEP en deux ans. La progressivité pensée pour ce public généralement peu à l’aise avec la scolarité a été supprimée.
Pourquoi les gouvernements ont-ils conduit cette politique de diminution du temps scolaire ?
Stéphane Bonnery : La raison est à la fois démographique, économique, sociale et politique. De 1999 à 2011, le nombre de naissances est monté en flèche, à la faveur du fameux « baby-boom de l’an 2000 ». Des politiques ambitieuses auraient pu recruter des enseignants pour y faire face. Le choix fut de réduire les dépenses pour l’école publique. Pour accueillir la vague démographique à moindre coût, différentes stratégies ont été adoptées. D’abord, dans l’enseignement primaire, la fermeture des toutes petites sections de maternelle, et celle de la plupart des postes de RASED (réseaux d’aides spécialisés pour les élèves en difficulté). La suppression des RASED devait, selon le ministre Darcos, être compensée par trois heures que les professeurs des écoles devaient consacrer à des activités personnalisées. Mais ces activités n’ont quasiment pas été mises en place, notamment faute de compétences spécialisées. Simultanément, la fermeture de postes, massive dans le secondaire et le supérieur avant l’arrivée de la vague (en profitant des départs massifs à la retraite dans cette période), a permis de faire glisser une petite partie des moyens vers le primaire.
Quand la vague démographique est arrivée au collège, la réforme Vallaud-Belkacem a réduit les enseignements disciplinaires au profit d’activités confiées à des enseignants hors de leur discipline. Un tour de passe-passe qui a permis de compléter quelques services et d’éviter de trop recruter. Les regroupements disciplinaires (SVT, physique, technologie) permettent également des économies d’échelle en nombre de professeurs à payer, au détriment de l’enseignement scientifique. Et avec un probable effet négatif sur les vocations que l’école crée pour ces filières. De surcroît, la suppression du BEP a réduit les postes en lycée général et technologique, la réforme des filières et la réduction des heures en seconde ont limité les recrutements, conduisant à des classes surchargées.
Ces mesures se doublent d’un projet politique soigneusement masqué : réduire l’accès à l’enseignement supérieur pour les élèves issus des couches populaires. Cet accès moindre découle de l’ensemble de ces mesures qui affaiblissent les capacités du système scolaire à s’attaquer à l’écart entre les cultures familiales populaires et celle de l’école. Capacités qui demandent des dépenses autres qu’a minima.
Pendant toutes ces années, l’enseignement privé a été mieux financé que l’enseignement public. D’abord au niveau du nombre de postes payés par l’État, ensuite par des mesures qui ont obligé les collectivités à payer davantage le fonctionnement de ces établissements privés, alors que durant la phase ascendante des naissances, le privé a sur-sélectionné sa population, sur critères scolaires et sociaux (4).
Maintenant que le nombre de naissances est redescendu aussi brutalement qu’il était monté, les propositions soufflées à la Convention citoyennes semblent de nature à favoriser encore davantage le recrutement d’élèves par le privé. Quand les journées sont raccourcies, les écoles privées proposent une garde complète englobant la périscolaire, où seul ce dernier est à la charge des familles. Du moins pour l’instant puisque l’extrême-droite et la droite proposent que l’État verse aux familles un « chèque éducation » pour leur permettre de payer l’école privée… avec l’argent qui devrait aller à l’école publique.
N’y a-t-il pas aussi une responsabilité des enseignants, des parents, une sorte d’acceptation tacite de cette politique ?
Stéphane Bonnery : En partie, mais il faut comprendre ce qui les pousse à cette acceptation. Comme les conditions de travail des professeurs des écoles primaires confrontés à la suppression des samedis matin en 2008. Dans les trois années qui ont précédé, des contenus de savoir ont été ajoutés : anglais dès le CE1, histoire de l’art, éducation à la santé, à l’environnement, à la sécurité routière, à l’égalité sexuée, etc. Un changement de programme est survenu, avec une dénomination trompeuse. Ce qui est désormais appelé « socle commun » n’est en fait qu’une partie, restée obligatoire, des programmes précédents. Les gouvernants ont officialisé à demi-mot que les enseignants ne devaient plus viser le même objectif pour les élèves de toutes les origines sociales, au motif qu’il fallait « s’adapter » à chacun. Et les classes devaient en outre accueillir des enfants handicapés qui ne peuvent pas apprendre en même temps que les autres. Ces enfants peuvent mobiliser une énergie et un temps d’attention tels de la part des enseignants que cela peut mettre en cause le fonctionnement de la classe entière. De plus, cela exige un temps de concertation avec les professionnels du soin non prévu. Derrière le prétexte d’une « inclusion », souvent ratée, comment ne pas voir que cela provient d’une volonté d’économiser sur les structures spécialisées nécessaires pour l’accueil de ces enfants ?
Les professeurs des écoles primaires ont ainsi été empêchés de bien travailler par les politiques conduites. L’obligation de remédiations, pour laquelle ils n’ont pas la formation d’enseignant spécialisé, s’est ajoutée à la place des samedis matin. Ce problème n’a pas été suffisamment porté. Mais l’acceptation de la réduction des heures devant les élèves a souvent été une manière de ne pas craquer pour les professeurs des écoles.
Du côté des parents, quelques lobbies ont poussé pour cette réduction du temps scolaire. Souvent ceux qui ont les moyens de payer des cours privés, des séjours linguistiques, etc. Mais les familles populaires ont un intérêt à ce que l’école se fasse à l’école, dans le cadre commun et public. Plutôt que de devoir payer pour maintenir le niveau d’enseignement, de courir d’un endroit à l’autre entre les écoles de danse, d’arts plastiques ou de judo. D’autant plus que dans les pays comme l’Allemagne, le Japon, ou la Grande-Bretagne, ces après-midi scolaires écourtées conduisent le plus souvent les femmes à sacrifier leurs carrières professionnelles.
Ces conditions ont poussé les enseignants et les parents à accepter cette politique. Également des débats biaisés, avec des faux arguments répétés en boucle dans les médias. L’organisation de la Convention citoyenne sur les temps de l’enfant a privé les personnes tirées au sort des arguments indispensables pour la réflexion. Je ne veux pas disqualifier le principe des Conventions citoyennes. Celles sur le climat et sur la fin de vie ont permis la controverse entre spécialités de recherche, permettant de faire entendre une diversité d’arguments afin d’éclairer les réflexions politiques. Leur travail a été d’une telle qualité, à rebours de la vision unilatérale que voulait imposer le pouvoir politique, que le Président de la République n’en a rien fait jusqu’ici. Cela s’est passé différemment pour la Convention sur les temps de l’enfant. Calendrier précipité, réunions en plein été, documents d’information indigents, choix très partial des intervenants par les organisateurs, limitation à de très courtes interventions de certains chercheurs, des syndicats. Même l’avis de la commission du CESE n’a été présenté qu’après que les conclusions de la Convention ont été décidées, plusieurs citoyens participants l’ont regretté. Cette mauvaise conduite affaiblit la démocratie participative. Et cela affaiblit la science quand elle est instrumentalisée politiquement pour ne faire entendre qu’une partie des résultats de recherche. En l’occurrence, certains arguments des chronobiologistes. Mais pas tous leurs arguments, par exemple quand ils disent que les « pics d’attention » remontent en fin de journée ce qui n’aurait pas poussé pour réduire les après-midi. Les recherches en sciences sociales ont été largement ignorées. La science, c’est un accord provisoire sur la synthèse des connaissances établies, ouverte à de nouveaux arguments issus des recherches. Sa réduction aux arguments que les pouvoirs en place souhaitent entendre n’est pas acceptable.
Peut-on mesurer les effets de cette politique de diminution du temps scolaire sur l’inégalité sociale face à l’école ?
Stéphane Bonnery : Il est difficile de parler d’effet au sens où cela serait une cause unique. Mais assurément, cela limite la lutte contre les inégalités sociales de réussite scolaire quand les élèves qui n’ont que l’école pour apprendre les savoirs scolaires ont été privés du temps nécessaire. Cela enferme chacun davantage dans les déterminismes sociaux et culturels, puisque avec moins de temps, il est plus difficile de faire découvrir de nouveaux centres d’intérêt et de susciter des vocations non crées par les socialisations familiales (les filles vers les sciences, ou les enfants de familles populaires vers des disciplines moins techniques).
On entend parfois que la quantité importe moins que la qualité, c’est faire comme si les deux étaient totalement disjoints. Ce que les élèves ont perdu, c’est beaucoup de temps d’écriture, de rédaction, d’exercices en maths. Les professeurs, pour tenir la pendule, suppriment ce qui est chronophage, pour aller vers le cours magistral. Mais alors, les élèves développent moins d’habitudes dans ces activités de rédaction, de démonstration, etc. C’est une perte de qualité quand on les fait moins composer, qu’on leur rend moins de corrections pour s’améliorer.
Les conséquences pèsent aussi sur les enseignants. La réduction des temps d’apprentissages les pousse à choisir entre ne s’adresser qu’à la tête de classe pour avancer dans le peu de temps disponible, ou s’adresser à ceux qui n’ont que l’école pour apprendre dans un temps insuffisant. C’est leur métier d’enseignant qui se trouve empêché.
L’organisation du temps, avec les arrêts de 15 jours toutes les six semaines fait l’hypothèse que les enfants vont, lors de ces arrêts, bénéficier d’un temps de repos, voire d’approches non-scolaire des savoirs ou des activités physiques. Mais cette hypothèse est-elle vérifiée ?
Stéphane Bonnery : Dans mon dernier ouvrage, je fais la synthèse des recherches sur les activités de loisirs. En résumé : leur fréquentation selon les origines sociales des familles est encore plus inégalitaire que ne l’est l’école. En outre, les activités de loisirs n’ont pas la même vocation que l’école. Les animateurs ne sont pas des sous-enseignants, contrairement aux politiques qui veulent leur assigner la mission de réduire l’échec scolaire par des activités non scolaires. C’est une hypocrisie. L’animation peut apporter autre chose, non pas à la place de l’école mais en plus. Vivre des situations, ce n’est pas forcément adopter une posture d’étude de ces situations en les constituant en occasions d’apprentissage. Le temps de loisir est libre. La conception qu’en ont les catégories intellectualisées ne doit pas être la seule, sinon, les familles populaires ne fréquentent pas ces loisirs. Chacun son rôle. L’école doit se faire à l’école.
Que penser des propositions visant à diminuer le temps scolaire l’après-midi ?
Stéphane Bonnery : Si elles sont appliquées, elles vont amplifier les problèmes qu’elles prétendent résoudre. Une partie des enfants sera en errance ou devant les écrans à partir de 15 h 30. Les autres, dont les parents pourront payer, vont courir les cours privés pour maintenir le niveau scolaire en obligeant leurs mères à ne travailler qu’à temps partiel. Ou bien cela va pousser les familles à scolariser dans l’école privée, en renforçant le séparatisme social. Une réduction du temps d’enseignement fait planer le risque de suppression de l’EPS et des enseignements artistiques, de la technologie, voire des sciences, en tant que disciplines scolaires, pour les confier aux communes qui pourront payer, et plus probablement à des intervenants privés. Une telle réduction du cadre obligatoire affaiblirait la culture commune transmise à la future génération. C’est très inquiétant dans une société de plus en plus morcelée et communautarisée. Notre pays me semble en danger.
Quelle politique alternative pensez-vous nécessaire pour notre école ?
Stéphane Bonnery : Reprendre confiance dans l’école publique française, arrêter de la saborder, lui donner les moyens, en diminuant le nombre d’élèves par classe, en libérant du temps des enseignants hors de la présence des élèves pour améliorer la pédagogie. Aujourd’hui, avec la baisse démographique, se présente une opportunité historique, en maintenant les postes, de découpler le temps enseignant et le temps élève. Revenir à 4,5 jours hebdomadaires pour les élèves permettrait de regagner le temps dont les enfants ont été spoliés pour apprendre plus tranquillement, sans stress de la pendule. Cela ne peut se faire qu’en réduisant le temps que les maîtres passent avec les élèves, par exemple à 3,5 jours, en partageant la classe entre deux enseignants, pour que chacun d’eux soit hors de la présence des élèves une journée par semaine en vue d’améliorer la pédagogie : formation, préparation des séances, corrections formatives avec annotations pour permettre aux élèves de reprendre l’écrit, et concertation avec les autres professionnels qui prennent en charge les élèves. Cela passe par un investissement financier conséquent, mais qui peut donner un avenir à notre pays.
Propos recueillis par Sylvestre Huet
(1) Voir Réduction du temps scolaire : les logiques cachées, Stéphane Bonnery, La Pensée n° 422.
(2) Voir Temps de l’enfant, rythmes scolaires, vraies questions et faux débats, textes introduits et présentés par Stéphane Bonnery, éditions de la Fondation Gabriel Péri.
(3) Stéphane Vaquero. Affinités culturelles et dispositifs pédagogiques. La production de l’éclectisme culturel au sein des Travaux personnels encadrés (TPE) au lycée général. Sociologie, 2024, 15 (3), pp.291-308. ⟨hal-04996676⟩
(4) Voir Favoriser l’école privée ; 20 ans de politiques économiques, Stéphane Bonnery, La Pensée n° 419.