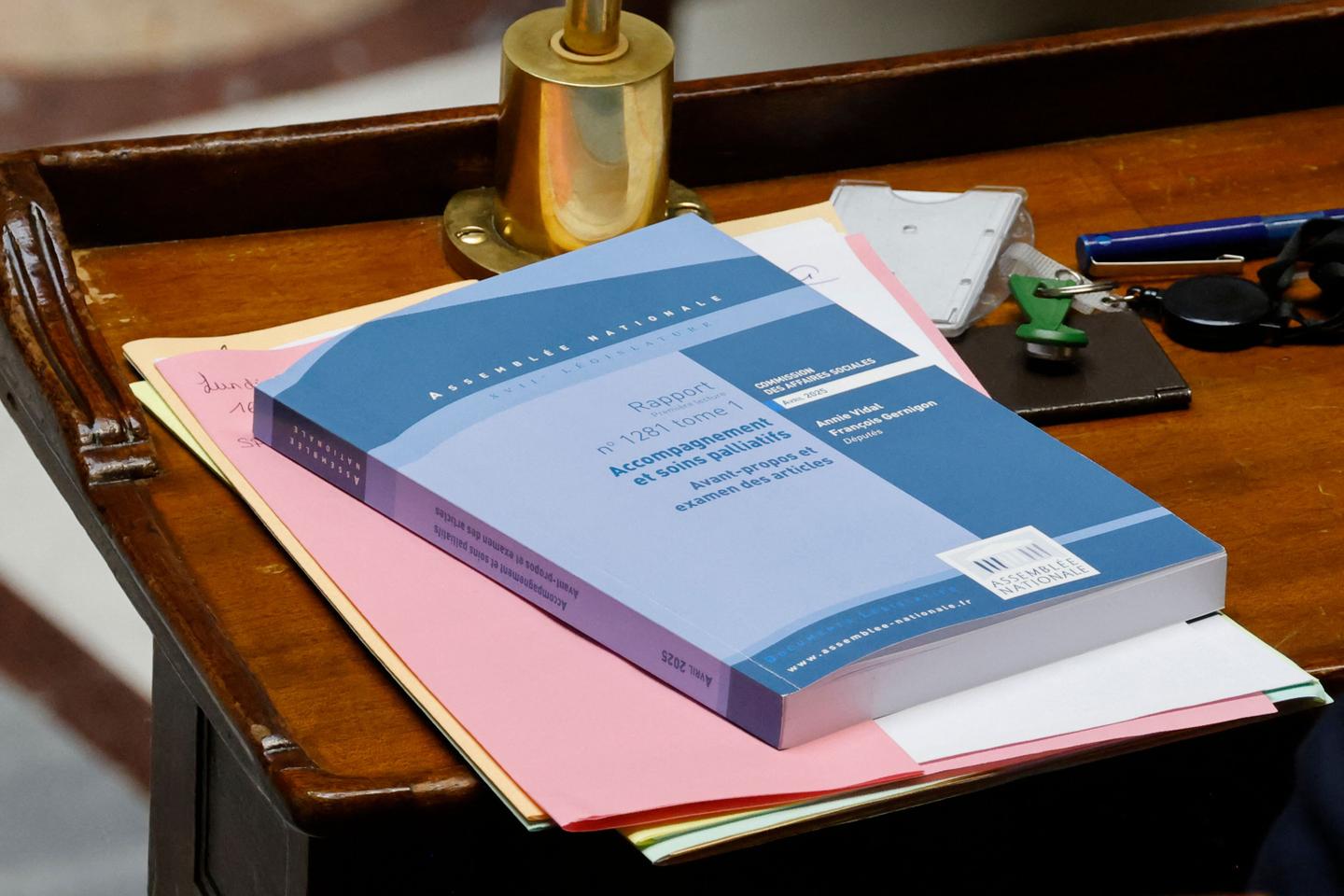Le 12 mai s’est ouvert à l’Assemblée nationale le débat sur la fin de vie et l’aide à mourir. Il y a quatre-vingts ans en France, la Sécurité sociale était créée et les femmes votaient pour la première fois. Bien sûr, il avait fallu des circonstances historiques exceptionnelles pour qu’une union nationale, fût-elle courte, inscrive dans le marbre deux avancées de société axées sur la justice et la solidarité. Aujourd’hui, c’est l’occasion unique qu’une telle concorde, allant hier des communistes aux gaullistes, traverse à nouveau l’Hémicycle, de sa gauche à sa droite.
Il y a cinquante ans entrait en vigueur la loi Veil sur l’avortement, et l’union – même partielle – avait, une nouvelle fois, fait la force, transcendant les clivages politiques. Pareille mobilisation transpartisane est à nouveau possible. Il y a vingt ans, la loi Leonetti s’inscrivait, avec l’interdiction d’obstination déraisonnable, dans le droit fil de la loi fondatrice du 4 mars 2002, qui avait sanctuarisé les droits des patients : être informés loyalement, consentir de façon éclairée, pouvoir refuser.
A son tour, 2025 saura intégrer dans le droit la demande ultime de certaines personnes malades, comme nous l’avions déjà envisagé en 2002, nouveau droit encadré par la sagesse du législateur et la déontologie des soignants. Le prix fort payé depuis les années sida, par plusieurs décennies de luttes pour la reconnaissance de l’autonomie, des savoirs, des valeurs et des préférences des patients, de leur libre arbitre, autorise aujourd’hui à inscrire cette ultime demande dans le champ de la démocratie en santé.
Humanisme rationnel
Il est temps que ce siècle, si économe en bonnes surprises, livre enfin une grande loi de liberté, digne du pays qui a rédigé la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Qu’on ne tourne plus le dos aux éternels ignorés d’un accompagnement de fin de vie digne, et que nul ne les qualifie plus de proportion négligeable (« pour laquelle on ne légifère pas ») : qu’ils soient par an 400 ou 4 000 (fourchettes d’estimation basse et haute de l’Institut national d’études démographiques en 2010). Il ne s’agit pas d’une rupture anthropologique, ni d’une entrée incontrôlée dans la règle d’une transgression, déjà largement pratiquée mais cachée sous le tapis : nous parlons de reconnaître et d’encadrer un acte jusqu’alors arbitraire et clandestin.
Il vous reste 62.52% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.