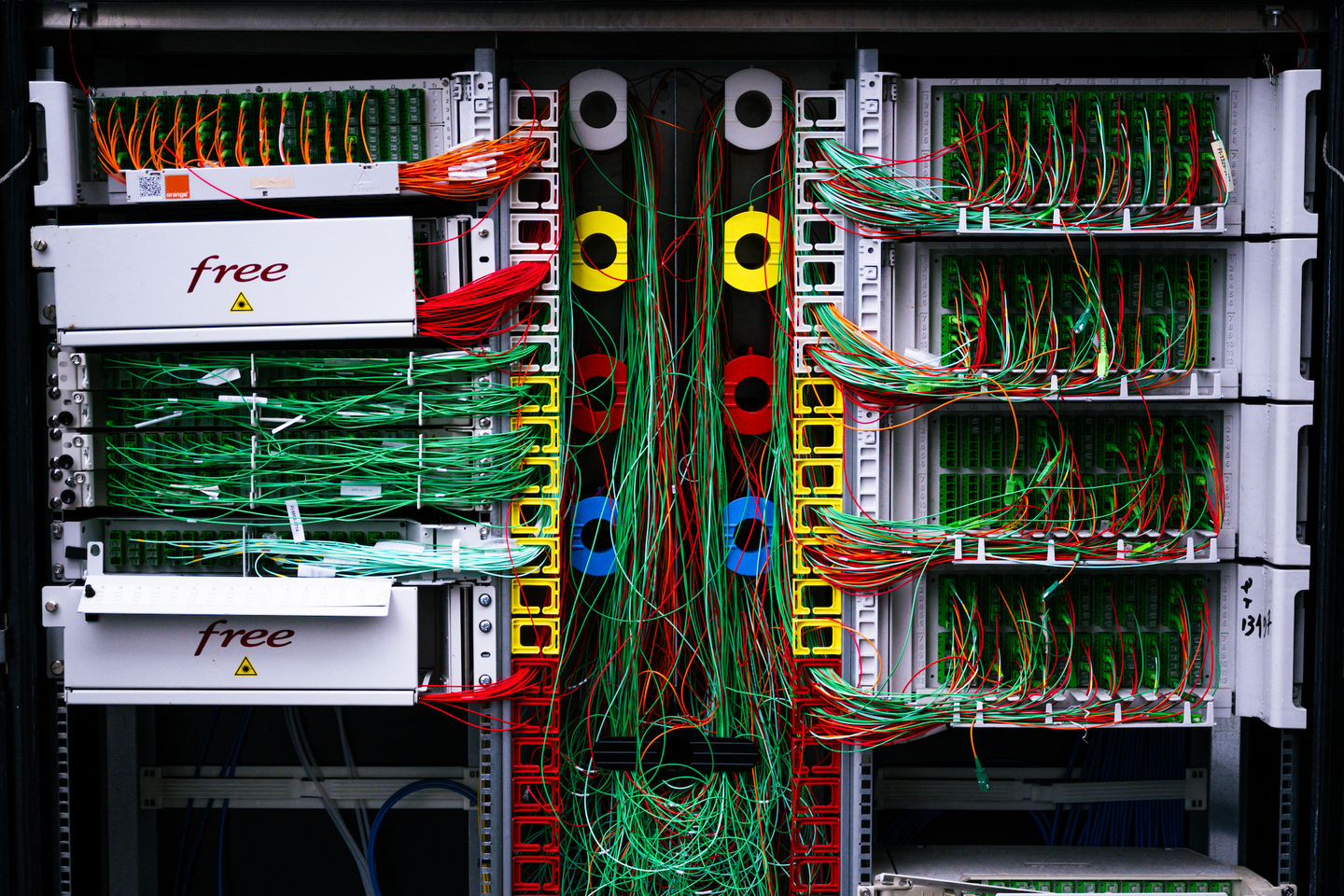La France vit, à bas bruit, une régression historique qui mine les fondements de son contrat social. Alors que ses dirigeants ne cessent de mettre en avant la nécessité de valoriser le travail, l’innovation, le risque, elle est redevenue, comme au XIXe siècle, une société d’héritiers. Etayée par de nombreux rapports, livres et études, la série sur l’héritage publiée par Le Monde met en avant une évolution qui, certes, n’est pas propre à l’Hexagone, mais contredit frontalement la promesse d’égalité des chances. Dans la constitution des patrimoines, l’héritage pèse désormais plus que le travail, dessinant un ordre social dans lequel les plus grandes fortunes sont réservées aux individus issus des familles riches.
Au début des années 1970, la fortune héritée représentait, en France, 35 % du patrimoine national, elle en pèse aujourd’hui 60 %. La conjonction de facteurs qui a mené à cet état de fait – montée de la Bourse et de l’immobilier d’un côté, dégradation des revenus du travail de l’autre, sous l’effet du ralentissement de la croissance et de la hausse du chômage – n’a nullement conduit l’Etat à corriger le tir.
Dans un contexte général de dérégulation fiscale, la politique conduite lors des dernières décennies a consisté, au contraire, à cribler de multiples exemptions la fiscalité sur les successions, qui souffre d’un handicap majeur : elle est très impopulaire, y compris aux yeux de ceux qui, disposant de faibles patrimoines, n’y seront pas soumis.
Matière inflammable
On mesure aujourd’hui les multiples dégâts que cause la distorsion entre ce que procure le travail et ce que garantit l’héritage. L’économie de la rente ne favorise pas l’avenir, elle entretient, à l’inverse, un sourd malaise dans la société. Les jeunes générations font figure de grandes sacrifiées. Elles peinent de plus en plus à s’installer dans l’âge adulte, sauf à disposer d’un don ou d’un héritage qui leur permettra de devenir propriétaires de leur logement.
En raison des faibles progressions salariales, le travail ne constitue plus un ascenseur social, aggravant le blocage d’une société de plus en plus inégalitaire. Le risque de voir cette société d’héritiers perdurer est renforcé par le vieillissement de la population qui fait croître le montant moyen de l’héritage : les baby-boomeurs ont en effet pour particularité d’être plus riches et d’avoir eu moins d’enfants que les générations précédentes.
En France, la dernière tentative de réforme fiscale remonte à 2013. Proposée par le premier ministre socialiste Jean-Marc Ayrault, elle a été refusée par le président de la République François Hollande parce que la matière était trop inflammable. Depuis, aucune discussion sérieuse autour d’un nouveau pacte fiscal n’a pu s’ouvrir entre les différentes forces politiques, tant les positions se sont radicalisées. Erigé en dogme dans un pays qui affiche un niveau de prélèvements obligatoires élevé, le « pas d’impôt nouveau » décrété par Emmanuel Macron ne dispense pas d’une remise à plat au moment où le pays doit trouver, d’ici à 2029, près de 100 milliards d’euros pour tenter de maîtriser sa dette.
Les impôts et les charges qui pèsent sur le travail freinent la promotion salariale, tandis que la multiplication des niches en matière de transmission sert d’optimisation fiscale aux mieux dotés. Ne pas vouloir le voir ou refuser d’y remédier, au prétexte qu’il n’y aurait pas de majorité pour cela, revient à accentuer les causes du malaise français.