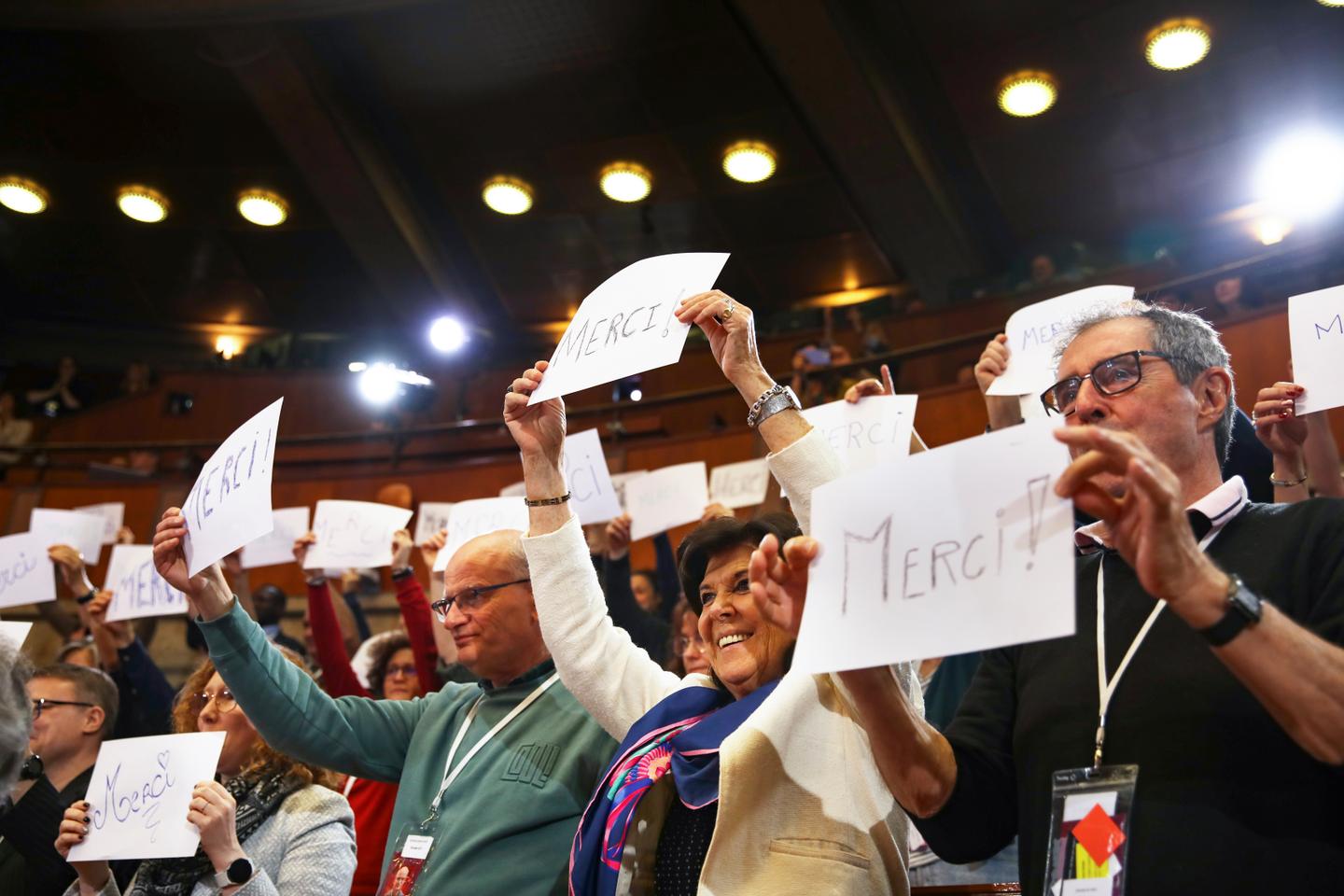La proposition de loi visant à limiter la liberté d’installation des médecins [adoptée en première lecture le 7 mai] divise : l’ensemble des syndicats médicaux ont retrouvé leur unité pour s’y opposer ; les élus locaux ont dépassé les clivages partisans pour réclamer son adoption ; le gouvernement a dégainé une alternative avec l’obligation de consacrer deux journées mensuelles à des zones en tension ; les patients voient s’étendre les déserts médicaux, expression qui a peu de réalité géographique, car l’accès à certaines spécialités est parfois complexe dans certaines métropoles, dont Paris.
Et si ce débat achoppait sur le fait qu’on n’a pas pris les choses dans le bon ordre ? Ne faudrait-il pas commencer par créer un service public de santé qui, curieusement, n’existe pas. En matière d’organisation des soins, il existe un service public hospitalier, mais les soins primaires ne répondent pas à cette logique. C’est un peu comme si, en matière d’éducation, le service public commençait au lycée ou à l’université et avait « oublié » l’école primaire et le collège, chacun devant se débrouiller pour les premières années d’éducation.
Cet « oubli » n’est pas le fruit du hasard. Il rappelle qu’il y a un siècle l’Assurance-maladie s’est construite avec l’opposition du corps médical, avec une sorte de « Yalta » : la solidarité nationale ne contrarierait pas les principes de la médecine libérale, parmi lesquels la liberté d’installation, mais aussi le paiement à l’acte, et n’interférerait pas avec l’organisation des soins non hospitaliers.
Désigner une autorité
Pourtant, le code de la santé publique reconnaît bien un droit large aux patients : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés. » Et l’article initial de ce code, le L. 1110-1, charge « les professionnels et les établissements de santé, les organismes d’assurance-maladie (…) et les autorités sanitaires (…) avec les collectivités territoriales et leurs regroupements » de « garantir l’égal accès de chaque personne aux soins ». Ce droit trouve sa traduction dans une assurance-maladie très récemment devenue universelle, mais pas dans l’organisation des soins, ce qui le prive d’une partie de son contenu.
Il vous reste 62.7% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.