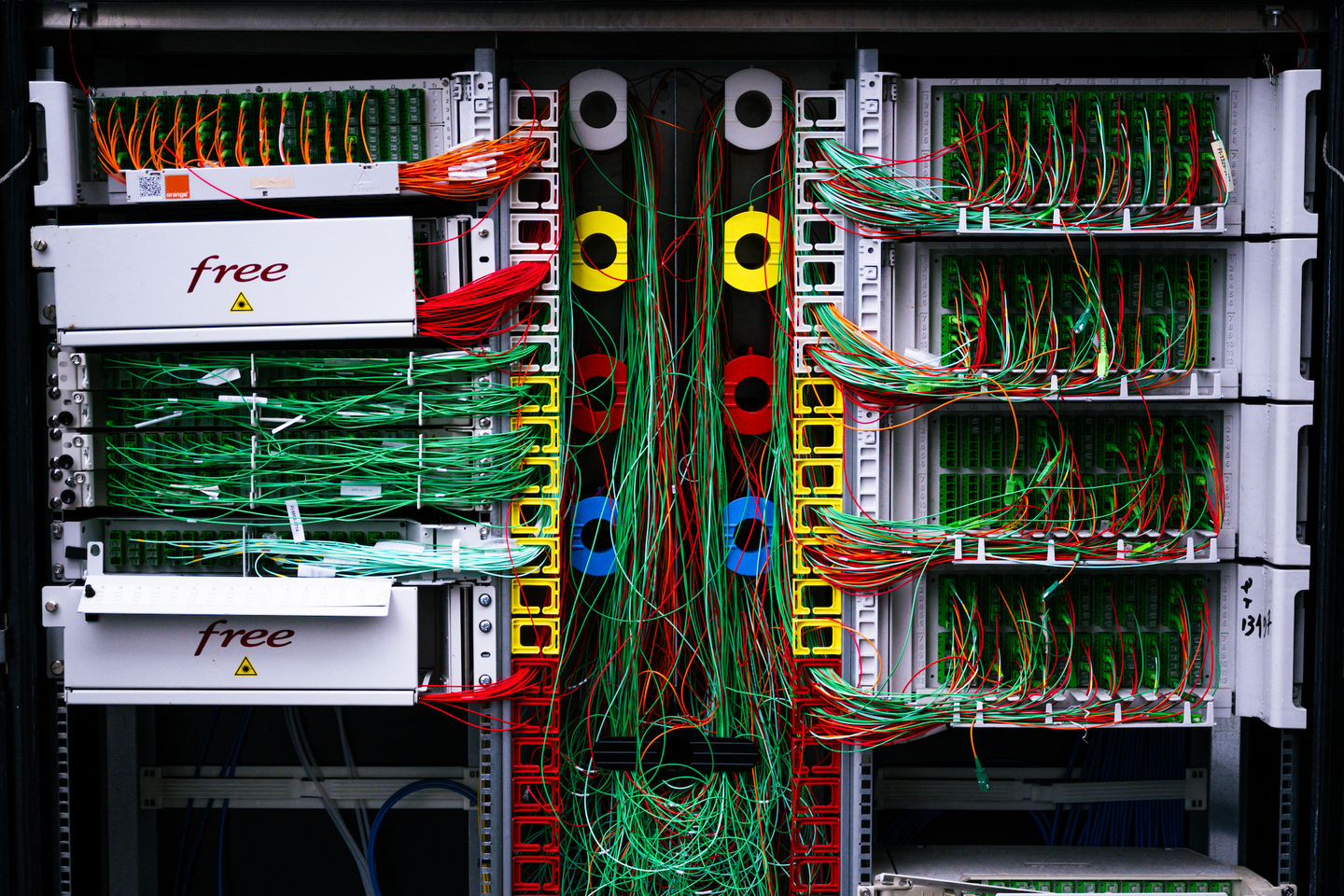Zied, 43 ans, consultant en communication installé avec son épouse dans la banlieue de Tunis, travaille à son compte et gère son budget avec rigueur. Mais depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les chèques, le 2 février, le voici privé de chéquier. Une difficulté au quotidien en Tunisie, où des milliers d’individus recourent à la monnaie scripturale pour échelonner leurs achats. Désormais, son usage est strictement encadré pour limiter les défauts de paiement.
Jusqu’ici, acheter des biens coûteux comme des appareils électroménagers ou du mobilier était envisageable pour Zied et son épouse. Malgré leurs revenus relativement limités – en moyenne 2 500 dinars par mois (soit 750 euros) –, les chèques postdatés, encaissables au fil des mois, leur permettaient d’acquérir certains produits. « L’année dernière, c’est comme ça que j’ai pu acheter un téléphone et une télévision. C’était rapide et facile, il suffisait de remplir les chèques et d’apporter les derniers relevés bancaires en magasin », relate Zied. Mais aujourd’hui, les choses se compliquent. Comment, par exemple, remplacer le réfrigérateur vieillissant ?
En voie de disparition dans d’autres pays, le chèque n’est pas, en Tunisie, « un simple moyen de paiement mais une garantie, voire un crédit, car les utilisateurs engagent leur intégrité physique en risquant la prison », explique Mehdi Jemaa, expert-comptable membre de l’association Alert, qui sensibilise les Tunisiens aux questions économiques. L’ancienne législation exposait les émetteurs de chèques sans provision à des peines pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison par chèque rejeté. De quoi dissuader les mauvais payeurs. La réforme a assoupli ces sanctions : la prison est désormais exclue pour les chèques inférieurs à 5 000 dinars et la peine a été réduite à deux ans pour les montants plus élevés, avec un cumul maximal de dix ans de prison.
« Les banques ne jouent pas leur rôle »
Mais parallèlement, les banques ont renforcé leurs contrôles : chaque carnet de chèques est désormais soumis à un plafond d’émission et à une date limite d’encaissement déterminée en fonction des ressources du client. Une plate-forme en ligne permet aussi aux bénéficiaires de vérifier la solvabilité de l’émetteur avant d’accepter un chèque.
Dans ce contexte, les commerçants qui s’appuyaient largement sur les paiements par chèques différés doivent revoir leurs pratiques. Certains proposent à leurs clients de leur envoyer tous les mois un commercial pour récupérer leur dû en liquide, d’autres proposent des prélèvements automatiques sur leur compte ou leur salaire. Mais ce service reste réservé aux personnes pouvant justifier d’un revenu fixe. Contactée par Le Monde, une enseigne confirme : « Pour payer par prélèvement, il faut soit un CDI, soit une pension de retraite validée par la banque. »
Pour acheter son réfrigérateur, Zied a exploré d’autres solutions de crédit. « On m’a proposé un paiement en 36 mensualités sans frais, mais il faut être propriétaire de son logement ou en CDI et fournir les justificatifs correspondants. Etant consultant et locataire, je ne suis pas éligible », déplore-t-il. Face à ces restrictions, certaines banques commencent à introduire des services permettant le paiement différé par carte bancaire. Mais son accès demeure limité. « Ma banque ne l’a pas encore mis en place et, en tant qu’indépendant, je ne suis sans doute pas un client prioritaire », poursuit Zied.
Pourtant, la loi impose désormais aux banques de consacrer 8 % de leurs bénéfices annuels au microcrédit destiné à leurs clients. Mais les établissements financiers tardent à adapter leurs offres, au risque d’un ralentissement de la consommation des ménages. « Cette mesure affecte plusieurs secteurs : électroménager, téléphonie, agences de voyage, commerce de détail et de gros… Il faut multiplier les organismes de crédit et assouplir l’accès au financement. Mais aujourd’hui, en l’absence de concurrence, les banques ne prennent aucun risque et ne jouent pas leur rôle. Les alternatives mettront du temps à se mettre en place », regrette Mehdi Jemaa.
« Une pratique illégale mais tolérée »
Les nouvelles restrictions sur les paiements par chèque ont par ailleurs une incidence sur la masse monétaire en circulation, selon Mohamed Salah Souilem. Cité par l’agence de presse tunisienne TAP, l’ancien directeur de la politique monétaire à la Banque centrale de Tunisie (BCT) a alerté sur la hausse des billets et de la monnaie en circulation (+ 7,5 % au 12 février par rapport à l’année précédente), du fait de la réforme sur les chèques mais aussi de l’inflation et de la croissance du PIB.
Restez informés
Suivez-nous sur WhatsApp
Recevez l’essentiel de l’actualité africaine sur WhatsApp avec la chaîne du « Monde Afrique »
Rejoindre
Si la consommation des ménages risque d’être affectée par cette réforme, des milliers de petites et moyennes entreprises (PME), qui usaient de ce moyen de financement pour pallier leur manque de trésorerie et la frilosité des banques à octroyer des crédits, devraient aussi en pâtir. « C’était une pratique illégale mais tolérée, ancrée dans l’économie informelle et qui permettait aux banques de se décharger de leurs responsabilités », explique Abderrazek Houas, porte-parole de l’Association nationale des PME.
S’il regrette que l’émission de chèques sans provision ne soit pas totalement dépénalisée, il salue néanmoins les restrictions imposées, estimant qu’elles pousseront les entreprises à utiliser d’autres instruments financiers comme la traite bancaire, qui permet à un créancier de recevoir une somme déterminée à une échéance donnée par son débiteur. Ce mode de paiement encadré oblige les entreprises à justifier leur solvabilité et limite les risques de défaut de paiement, lequel relève du droit civil et non pénal.
Selon Abderrazek Houas, le développement de ce type de solutions et la généralisation du paiement par carte de crédit pourraient, à terme, remplacer progressivement le chèque. « Les banques n’auront pas d’autre choix que de suivre et de financer l’économie au lieu de ne jouer qu’un rôle d’intermédiaire, sinon elles seront elles-mêmes affectées », assure-t-il. En attendant, de nombreux Tunisiens comme Zied devront revoir leurs habitudes de consommation et les PME se tourner vers d’autres moyens de financement, sous peine de réduire leurs activités.