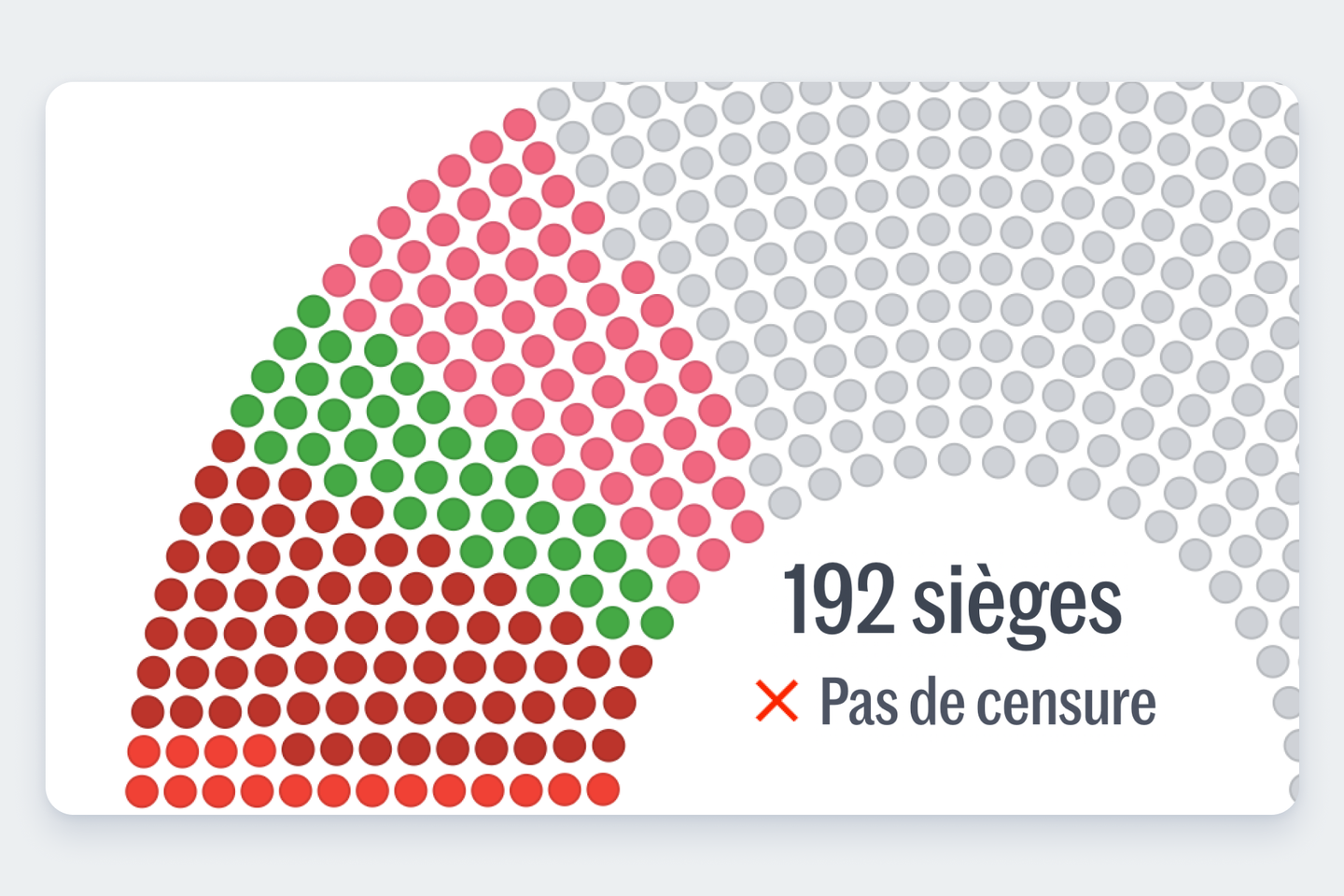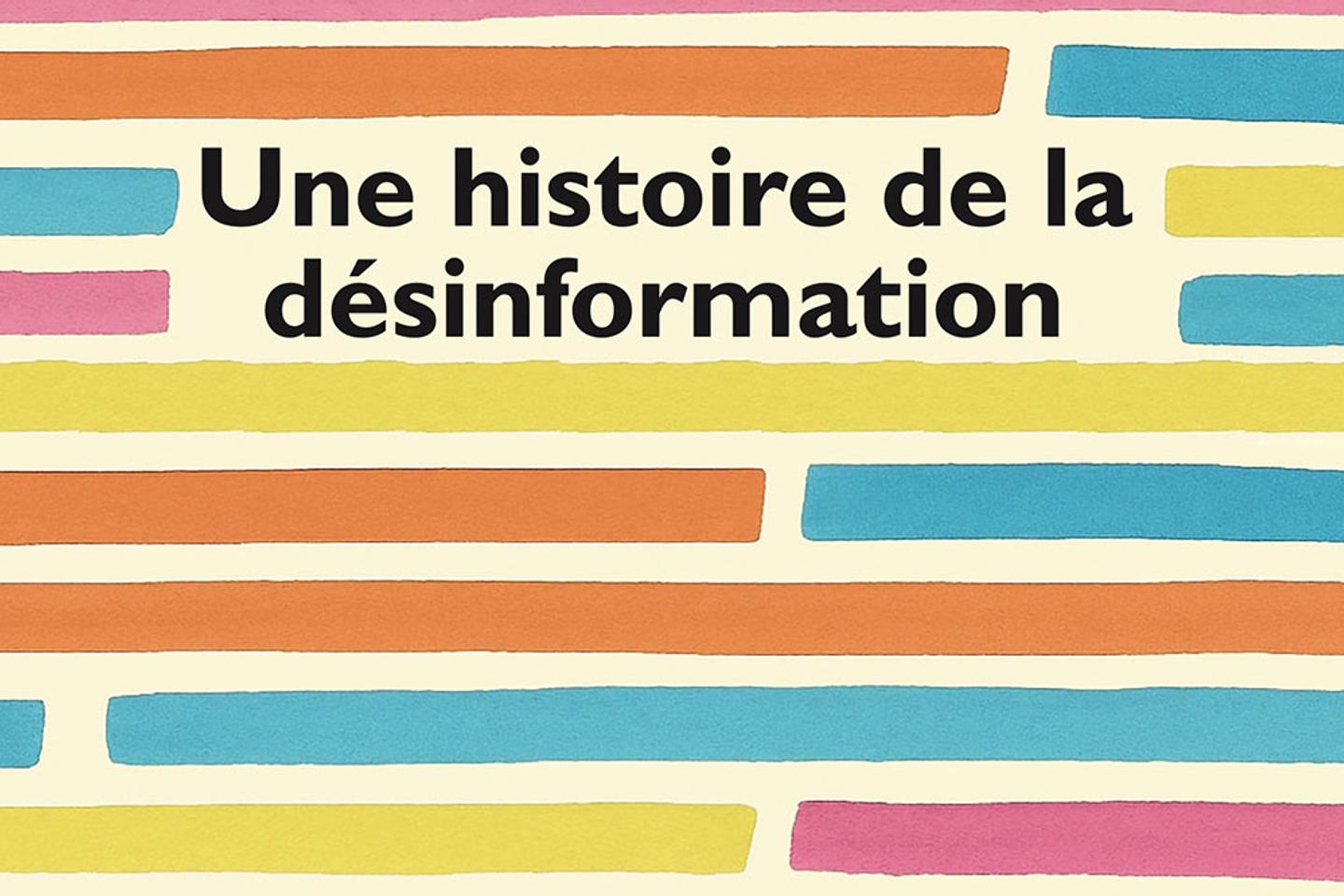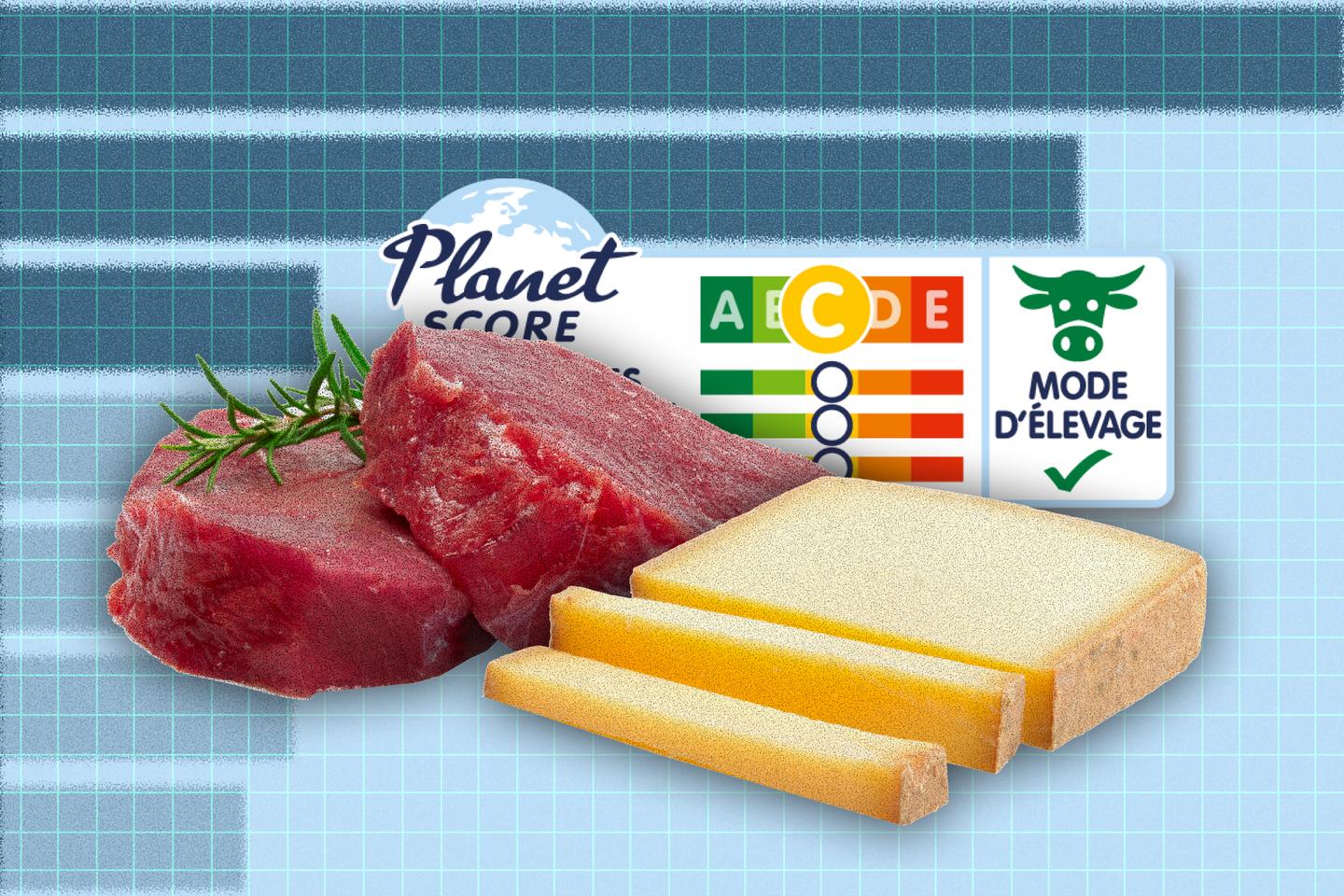Depuis l’annonce, mercredi 2 avril, d’une hausse spectaculaire des droits de douane sur tous les produits importés aux Etats-Unis, le monde économique est suspendu au pouls des bourses mondiales et de ses soubresauts. Voici notre glossaire, pour comprendre les termes économiques et boursiers qui font l’actualité.
Balance des paiements
La balance des paiements enregistre l’ensemble des flux économiques entre un pays et l’extérieur. Sous la forme d’un document comptable, elle se divise en plusieurs comptes, dont le compte financier et le compte courant. Ce dernier regroupe les échanges de biens, services, revenus et transferts de capitaux tandis que le compte financier retrace les flux d’investissements et de capitaux.
Intégrée au compte courant, la balance des biens, aussi appelée balance commerciale, mesure la différence entre les exportations et les importations de biens matériels (produits manufacturés, matières premières, etc.). Un déficit dans la balance commerciale, comme c’est le cas pour les Etats-Unis depuis les années 1970, indique que le pays importe davantage qu’il n’exporte. En 2024, ce déficit a atteint un chiffre record de 918 milliards de dollars (829 milliards d’euros).
Selon Donald Trump, il serait dû au fait que les autres pays « arnaquent » les Etats-Unis. De cette manière, il justifie la mise en place de droits de douane exorbitants pour rétablir un équilibre commercial et protéger l’industrie américaine de la concurrence étrangère.
Capitulation
Lorsque le cours de la Bourse baisse de manière significative, les investisseurs soldent leurs positions et se débarrassent précipitamment et massivement de leurs titres pour limiter leurs pertes. Dans le cycle des émotions qui régit la psychologie boursière, cette phase est dite de capitulation. Elle fait suite à la panique et précède la dépression. Elle est considérée comme le point le plus bas que peut atteindre un marché, et le début d’une nouvelle phase haussière.
Après l’annonce brutale par Donald Trump de la hausse spectaculaire des droits de douane sur les produits importés aux Etats-Unis, et l’effondrement des bourses mondiales vendredi 4 et lundi 7 avril, de nombreux observateurs espéraient avoir atteint le point de capitulation, qui annoncerait un possible rebond boursier. Celui-ci s’est produit mardi 8 avril, après l’annonce de discussions tarifaires entre le Japon et les Etats-Unis, mais sans certitudes sur l’avenir : rien ne dit que la bourse ne puisse pas encore dévisser.
Contrat à terme
Un contrat à terme – ou future, en anglais – est un engagement juridiquement contraignant d’acheter ou de vendre un actif (matière première, devise, produit financier) à un prix fixé aujourd’hui, pour une livraison à une date ultérieure. Il s’agit d’un outil-clé de gestion des risques liés à la volatilité mondiale des valeurs et un instrument financier précieux pour anticiper les tendances à venir en bourse : le prix auquel s’échange un contrat à terme reflète les attentes des investisseurs sur l’évolution future d’un actif.
Par exemple, pour un producteur de blé, la récolte a lieu en été mais les ventes se font à l’automne. Si le cours du blé est à 1 200 dollars la tonne, il peut choisir de vendre dès maintenant, via un contrat à terme, au prix actuel, par crainte d’une baisse des prix dans les mois suivants.
Le Monde
Soutenez une rédaction de 550 journalistes
Accédez à tous nos contenus en illimité à partir de 7,99 €/mois pendant 1 an.
S’abonner
Mercredi 9 avril, avant l’ouverture, jour de l’entrée en vigueur des nouveaux droits de douane, les contrats à terme sur les principaux indices boursiers ont chuté, selon CNBC : le Dow Jones Industrial Average de 0,74 %, le Nasdaq-100 de 0,88 %, le S&P 500 de 0,89 %. Cela indique que les investisseurs s’attendent à une journée de repli.
Dette extérieure
La dette extérieure désigne l’ensemble des emprunts contractés par un pays auprès de créanciers étrangers, qu’il s’agisse d’Etats, d’institutions ou d’investisseurs privés. Aux Etats-Unis, cette dette atteint des niveaux historiques – 36 000 milliards de dollars – alimentée par des déficits chroniques. Aussi, le dollar, avec son statut de monnaie de réserve mondiale, attire les capitaux mais cela contribue à le surévaluer, creusant le déficit commercial.
Dans ce contexte, Donald Trump mise sur une stratégie à deux volets pour tenter de contenir le coût de la dette, alors que 9 200 milliards doivent être refinancés en 2024. D’une part, il veut réduire les dépenses publiques et d’autre part, il relève les droits de douane pour rééquilibrer la balance commerciale et favoriser une baisse des taux. Ces taxes deviennent ainsi un levier économique autant qu’un outil de négociation avec les partenaires étrangers, avec pour objectif de prolonger la confiance des créanciers tout en limitant l’explosion du poids de la dette.
Droits de douane
Les droits de douane constituent un prélèvement fiscal (une taxe) sur les marchandises entrant sur un territoire national, en provenance de l’étranger. Le calcul de cette taxe peut se fonder sur la valeur des biens ou services importés (on parle de droit ad valorem), sur leur poids ou encore sur une autre unité de valeur (boisseau ou baril…).
La fin de la seconde guerre mondiale marque une rupture avec le protectionnisme prévalant depuis les années 1930. Des accords du GATT (accord général sur les droits de douane et le commerce) en 1947 à la fondation de l’Organisation mondiale du commerce en 1995, toujours dans l’optique de faciliter les échanges internationaux et de favoriser le libre-échange, les droits de douane n’ont cessé de baisser jusqu’au début des années 2020.
Avec ses « droits de douane réciproques » imposés au reste du monde, l’administration Trump fait le choix du protectionnisme et met fin à plus d’un demi-siècle d’ouverture économique des Etats-Unis.
Ce revirement brutal provoque déjà des secousses sur les places boursières et risque de déstabiliser l’ordre économique mondial.
Inflation
L’inflation est un phénomène économique commun caractérisé par l’augmentation des prix des biens de consommation et la dépréciation de la monnaie. Alors que Donald Trump s’était fait fort, durant sa campagne, de contenir celle-ci, la hausse des droits de douane va « probablement augmenter l’inflation dans les trimestres qui viennent », pronostique Jerome Powell, président de la Réserve fédérale des Etats-Unis (la banque centrale américaine). Ces nouvelles taxes augmentent en effet mécaniquement le coût des matières premières ou des pièces détachées importées sur le marché américain. Allianz Trade estime, dans une note récente, que « les deux tiers de la hausse des coûts d’importation seront répercutés sur les consommateurs », soulignant un risque d’inflation maximal à l’été 2025 (+ 4,3 %) aux Etats-Unis.
La réplique que l’Union européenne devrait annoncer « en début de semaine prochaine » d’après le porte-parole de la Commission – avec une possible augmentation des droits de douane sur les produits américains – pourrait également générer de l’inflation en Europe mais dans une moindre mesure.
A l’inverse, sur les marchés exportateurs fortement dépendants des commandes américaines, le risque serait plutôt déflationniste. La demande globale des produits européens pourrait se réduire, provoquant une contraction des prix. Ce phénomène « restera limité », relativise cependant l’économiste Vincent Vicard dans un entretien accordé à Alternatives économiques.
« Lundi noir »
L’expression « lundi noir » renvoie au krach du 19 octobre 1987, lors duquel l’indice Dow Jones de la Bourse de New York avait enregistré une chute historique de 22,6 % en une seule séance. Elle fait écho au « jeudi noir » du 24 octobre 1929, qui avait marqué le début de la Grande Dépression aux Etats-Unis.
Ce terme ressurgit régulièrement lors de fortes turbulences sur les marchés financiers. Il est particulièrement utilisé dans les médias ces derniers jours dans le contexte de la guerre commerciale engagée par Donald Trump, dont les annonces de droits de douane ont provoqué d’importantes vagues d’inquiétude chez les investisseurs, entraînant des chutes marquées aussi bien pour le CAC 40 à la Bourse de Paris, que pour le S&P 500, son équivalent américain.
Marché haussier et baissier
Les marchés alternent entre creux et sommets, comme les montagnes russes. D’un côté, le marché haussier, aussi appelé « bull market » en référence au taureau pointant ses cornes vers le haut, est caractérisé par une période de hausse des cours, de confiance et d’optimisme de la part des investisseurs.
A l’inverse, il existe deux sortes de chutes : la correction et le marché baissier. La première, qui peut concerner des titres ciblés ou des marchés plus larges, constitue une rupture soudaine dans la courbe haussière et doit osciller entre 10 % et 20 % par rapport à un pic précédent. Lorsque le ralentissement dépasse les 20 %, on parle de marché baissier (« bear market »).
Les annonces de Donald Trump en matière de droits de douane ont provoqué un séisme dans le milieu boursier, menaçant l’entrée dans une tendance baissière : entre son dernier pic, le 19 février, et la fermeture lundi soir, S&P 500, l’indice boursier américain de référence, a dévissé de 17,61 %, s’approchant dangereusement des 20 % symboliques.
Protectionnisme
Le protectionnisme, parfois qualifié de « nationalisme économique », est une doctrine destinée à réduire l’ampleur de la concurrence étrangère et protéger les biens produits à l’intérieur du pays. Il repose sur trois types d’instruments : les barrières tarifaires (droits de douane) et non tarifaires (règles d’origine, licences d’importation) et les restrictions quantitatives (quotas d’importation).
Cette politique interventionniste ressurgit brutalement sous la présidence de Donald Trump, dont l’objectif est un rééquilibrage de la balance commerciale. Lors de son premier mandat, il avait déjà mis en place plusieurs mesures protectionnistes, comme des droits de douane particulièrement élevés sur les produits importés de Chine. Cette dynamique, qui s’inscrit dans une tradition républicaine ancienne, déjà visible dans les années 1930 lors de la Grande Dépression, avec l’adoption de la loi Hawley-Smoot qui avait augmenté les droits de douane à l’importation de plus de 20 000 types de biens, n’a cessé de prendre de l’ampleur lors du second mandat de Trump. Le président a imposé un taux plancher, entré en vigueur le 6 avril, de 10 % de taxe douanière sur tous les produits importés aux Etats-Unis, avec des surtaxes selon les pays.
Cette approche fait écho à une vision fragmentée du commerce mondial : celle d’économies fonctionnant en silos, qui s’échangent ponctuellement des biens. Cette logique rompt avec l’économie mondiale du XXIe siècle structurée autour de chaînes de valeur internationales : un même produit peut être conçu, assemblé et distribué à travers plusieurs pays. Eriger des barrières revient à désorganiser ces circuits complexes et à risquer des représailles économiques, pouvant déboucher sur de véritables guerres commerciales.
Récession
La récession, qui ne doit pas être confondue avec la décroissance, désigne une période économique caractérisée par un important recul de l’activité. Sa définition exacte varie d’un pays à l’autre. En France, l’Insee parle de récession à partir de deux trimestres consécutifs de contraction du produit intérieur brut (PIB). Aux Etats-Unis, le National Bureau of Economic Research la définit de manière plus large comme un déclin significatif de l’activité économique sur plusieurs mois, qui se reflète dans le PIB, les revenus, l’emploi, la production industrielle et la consommation.
Le 8 avril, la banque J. P. Morgan a parié sur une entrée en récession des Etats-Unis en 2025, après l’annonce par Donald Trump de la hausse généralisée des droits de douane, synonyme pour les économistes d’inflation et de ralentissement de la croissance.
Stagflation
Après la période de croissance à deux chiffres des « trente glorieuses », les économies occidentales sont frappées, à partir des années 1970, par un tassement de la croissance et une hausse des prix. Ce « pire des deux mondes », comme le qualifie l’inventeur du concept, le conservateur britannique Iain Macleod, est surnommé « stagflation ».
Depuis le premier choc pétrolier de 1973, le concept a été repris par les économistes, qui expliquent le phénomène par les politiques publiques de soutien à la demande, qui font artificiellement grimper les prix dans un contexte de croissance atone. Or cette configuration constitue un cercle vicieux : l’inflation réduit la capacité d’épargne et contraint les capacités d’investissement, lesquelles ne sont plus suffisantes pour relancer l’activité économique et améliorer le pouvoir d’achat.
Mais d’autres leviers peuvent faire grimper artificiellement les prix et alimenter l’inflation. C’est le cas des droits de douane, qui se répercutent directement sur le consommateur. Si tous les économistes ne s’accordent pas sur les conséquences de la situation actuelle, la stagflation est considérée comme l’une de ses issues possibles. Ce serait politiquement la pire pour Donald Trump, qui a été en grande partie élu sur la promesse de combattre l’inflation des années Biden.
Valeur refuge
En période de turbulences sur les marchés financiers, comme c’est le cas actuellement, les investisseurs se tournent vers ce que l’on appelle des valeurs refuges : des actifs stables, réputés pour leur fiabilité et qui permettent de dégager le plus souvent une plus-value à la revente. L’or, qui se vend à quelque 3 000 dollars l’once (31,1 grammes), reste le plus emblématique.
Mais d’autres actifs jouent également ce rôle protecteur. C’est le cas des obligations, un titre de créance par lequel un emprunteur (une entreprise ou un Etat) s’engage à rembourser un montant avec intérêts à une date future déterminée. Certaines entreprises cotées en Bourse peuvent également faire office de valeur refuge, notamment celles dont l’activité dépend en grande partie de commandes publiques. Engie est un exemple : en un mois, le titre a progressé de 4,36 %, alors que le CAC 40 a enregistré un recul de 11,34 %.
Indice VIX
Dans le monde boursier, il est surnommé « l’indice de la peur ». Le VIX, ou CBOE Volatity Index (indice de volatilité de la bourse de commerce de Chicago), mesure la variation moyenne des options d’achat et les options de vente sur les 500 principales valeurs de Wall Street.
Une valeur VIX élevée est un signe d’affolement des marchés financiers et de panique des investisseurs. Depuis son introduction en 1986, ce symbole du trading algorithmique s’est envolé lors des périodes de crise, comme le 11-Septembre, la crise des subprimes de 2008 ou le Covid-19. Il a notamment dépassé le seuil de 70 cinq fois en 2008 et autant en 2020, avec un pic historique à 82,69 le 16 mars 2020, quand ses journées les plus calmes se situent entre 10 et 20. Le 7 avril, à la suite de l’annonce fracassante de l’augmentation généralisée des droits de douane américains, l’indice VIX a dépassé le seuil des 40 pour la première fois depuis la crise du Covid-19.