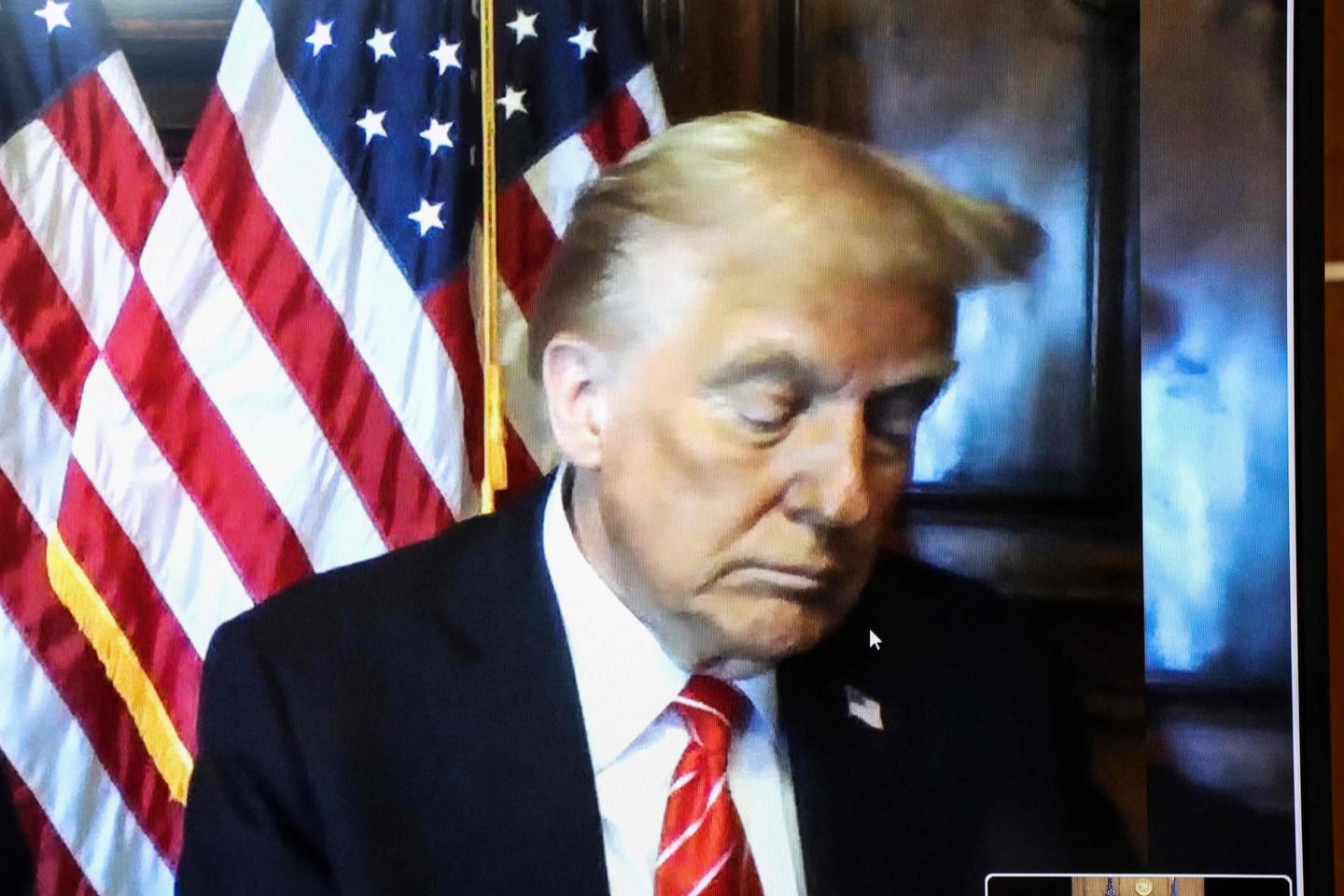Et soudain, l’imparfait a pétrifié le théâtre. Avec ce temps de l’indicatif qui maintient le passé révolu dans un semblant de survivance, avec ce temps au goût d’inachevé dont elle ne se prive pas, Marguerite Duras immobilise le théâtre dans un suspens auquel nos vies contemporaines ne sont plus habituées. La confrontation avec sa pièce, L’Amante anglaise, mise en scène par Jacques Osinski au Théâtre de l’Atelier, à Paris, souligne cette évidence, alors que rien ne se passe sur le plateau, que des questions et leurs réponses.
Pas, ou presque pas, d’allées et venues des acteurs, pas d’actions inouïes, pas de décor fastueux, mais un rideau de fer abaissé et, plus tard, l’espace nu et brut de la salle. Pour le spectateur, pendant près de deux heures quinze, il n’y a rien de spectaculaire à se mettre sous la dent. A part l’essence même du théâtre : les interprètes, le verbe de Duras, et sa prose qui installe le trouble dans la fiction. On ne s’ennuie pas une seconde à la vue et à l’écoute du trio de comédiens (Sandrine Bonnaire, Frédéric Leidgens, Grégoire Oestermann), mais on entre dans un curieux état de sidération avec l’impression tenace d’être aussi piégés que le sont les acteurs entre des vérités qui louvoient et ne se fixent jamais.
Inspirée par un fait divers (le meurtre et le dépeçage d’un homme, en 1949, par son épouse, Amélie Rabilloud), Marguerite Duras a pris des libertés avec le réel pour le passer au tamis de son écriture. La « dépeceuse tranquille » – ainsi que la surnommait la presse – sera l’héroïne de deux de ses textes : Les Viaducs de la Seine-et-Oise (Gallimard, 1960) et, sept ans plus tard, L’Amante anglaise (Gallimard), dont l’adaptation théâtrale est mise en scène par Claude Régy dès 1968, avec Claude Dauphin, Michael Lonsdale et Madeleine Renaud.
Détresse poignante
Lieu du drame : Viorne – cette ville imaginaire est substituée au lieu originel de Savigny-sur-Orge. Victime du meurtre : Marie-Thérèse Bousquet, la cousine sourde et muette de Claire Lannes. Le mari, Pierre Lannes, n’est pas celui que l’on dépèce, même s’il ne s’y trompe pas : « — Je crois que si Claire n’avait pas tué Marie-Thérèse, elle aurait fini par tuer quelqu’un d’autre. — Vous ? — Oui. Puisqu’elle allait vers le crime dans le noir, peu importe qui était au bout du tunnel, Marie-Thérèse ou moi… »
Le crime est su. Sur ce point-là au moins, aucune ambiguïté. Le reste est affaire de variations subtiles, à la limite du détectable. Duras multiplie les lignes de fuite au point de mettre sa fiction en déroute. Impossible de s’emparer, d’un geste sûr, des faits racontés, de les jauger et d’en tirer des conclusions tranchées. A mesure que les protagonistes s’expriment, leurs récits échappent à la saisie. Une certitude pourtant : la détresse poignante de Claire Lannes, à qui l’écrivaine rend justice en la resituant à sa juste place de femme intelligente et loin d’être folle.
Il vous reste 57.97% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.