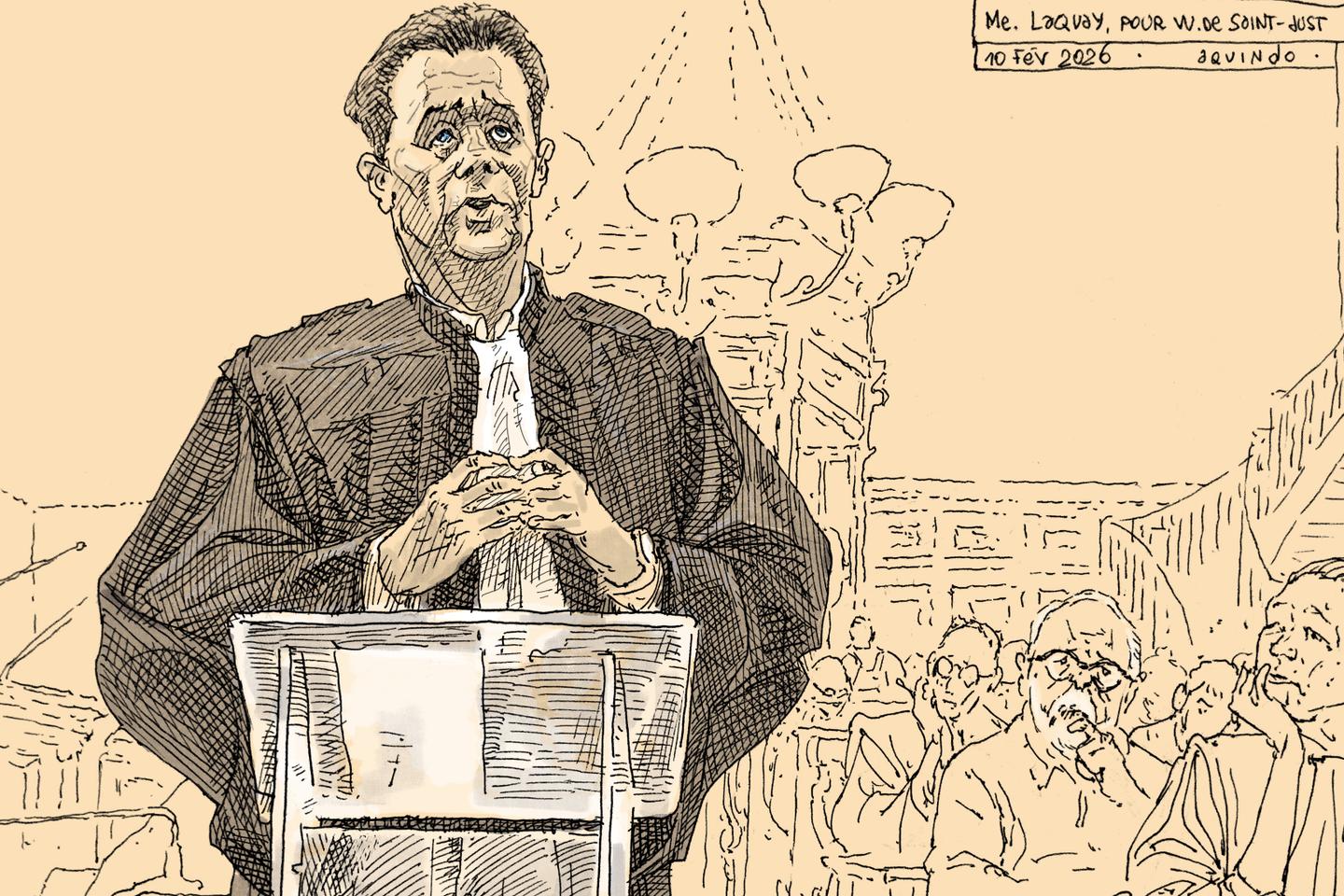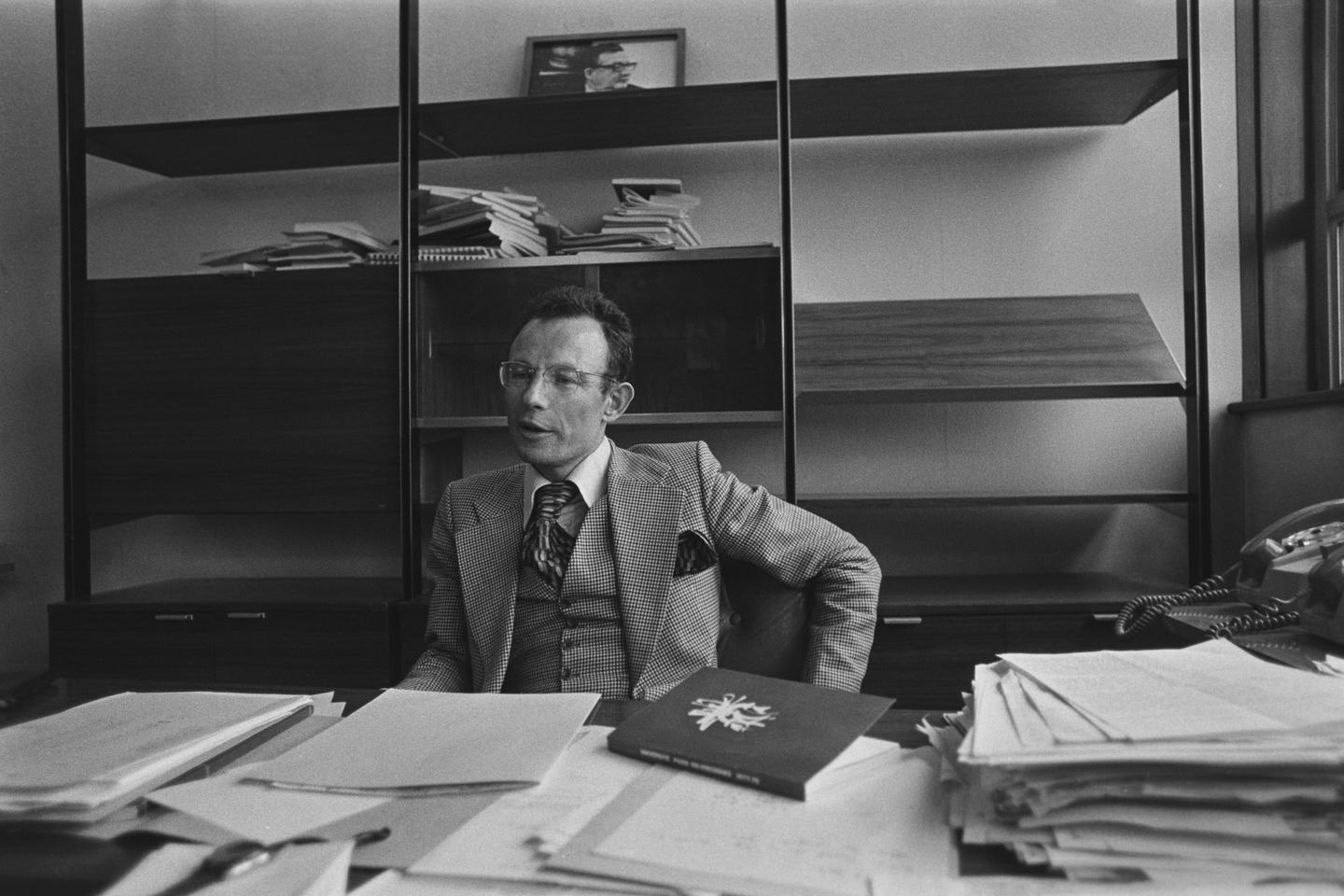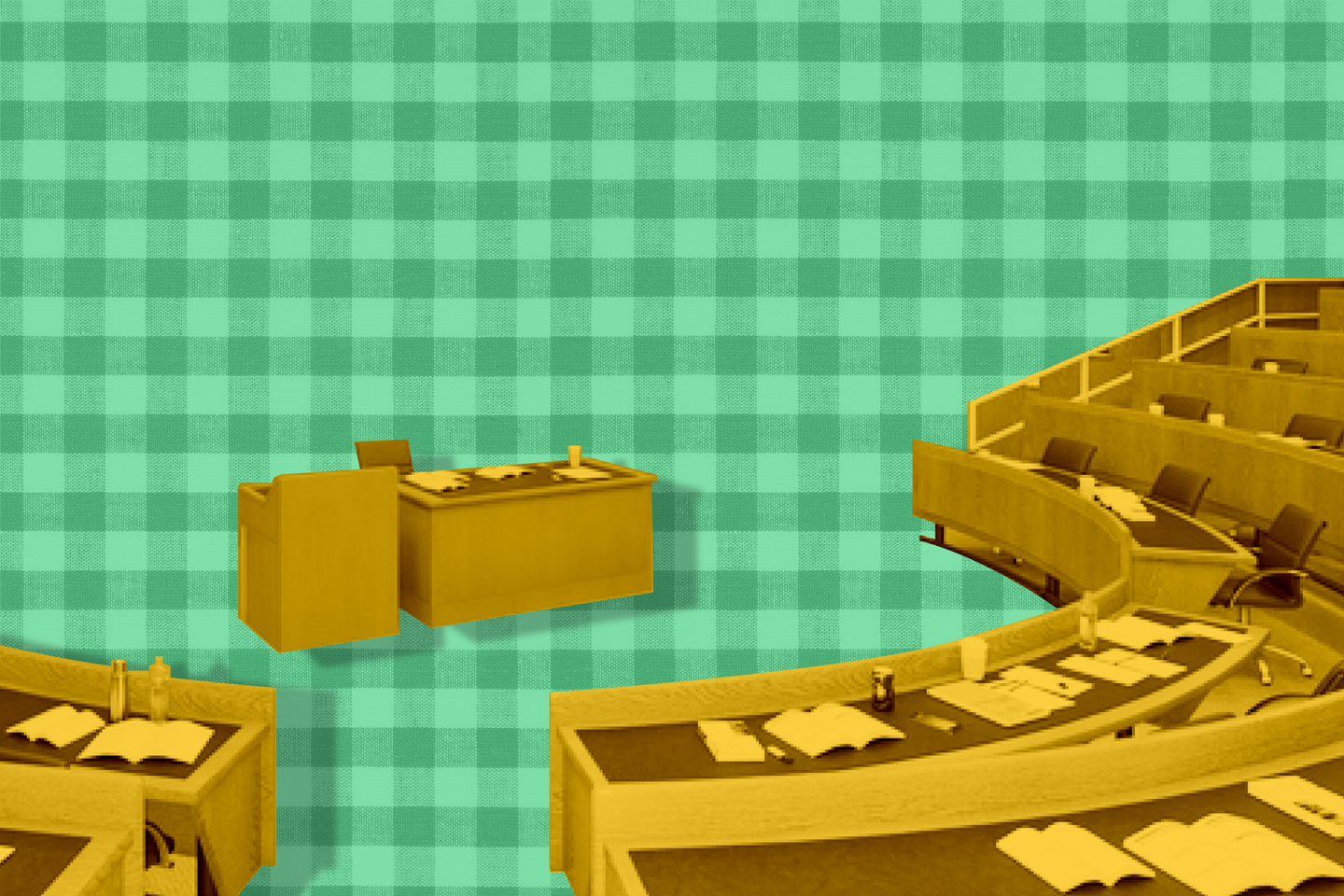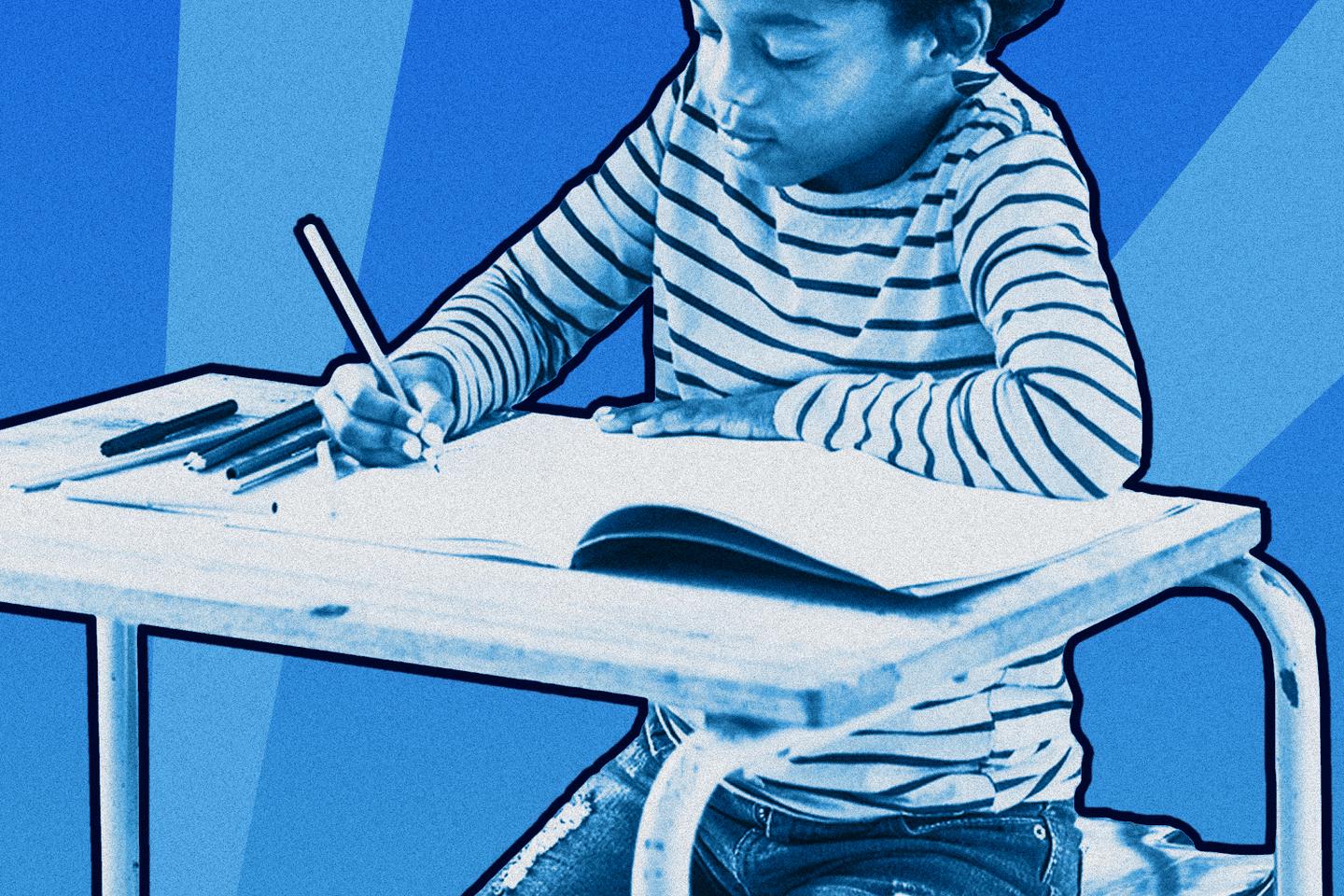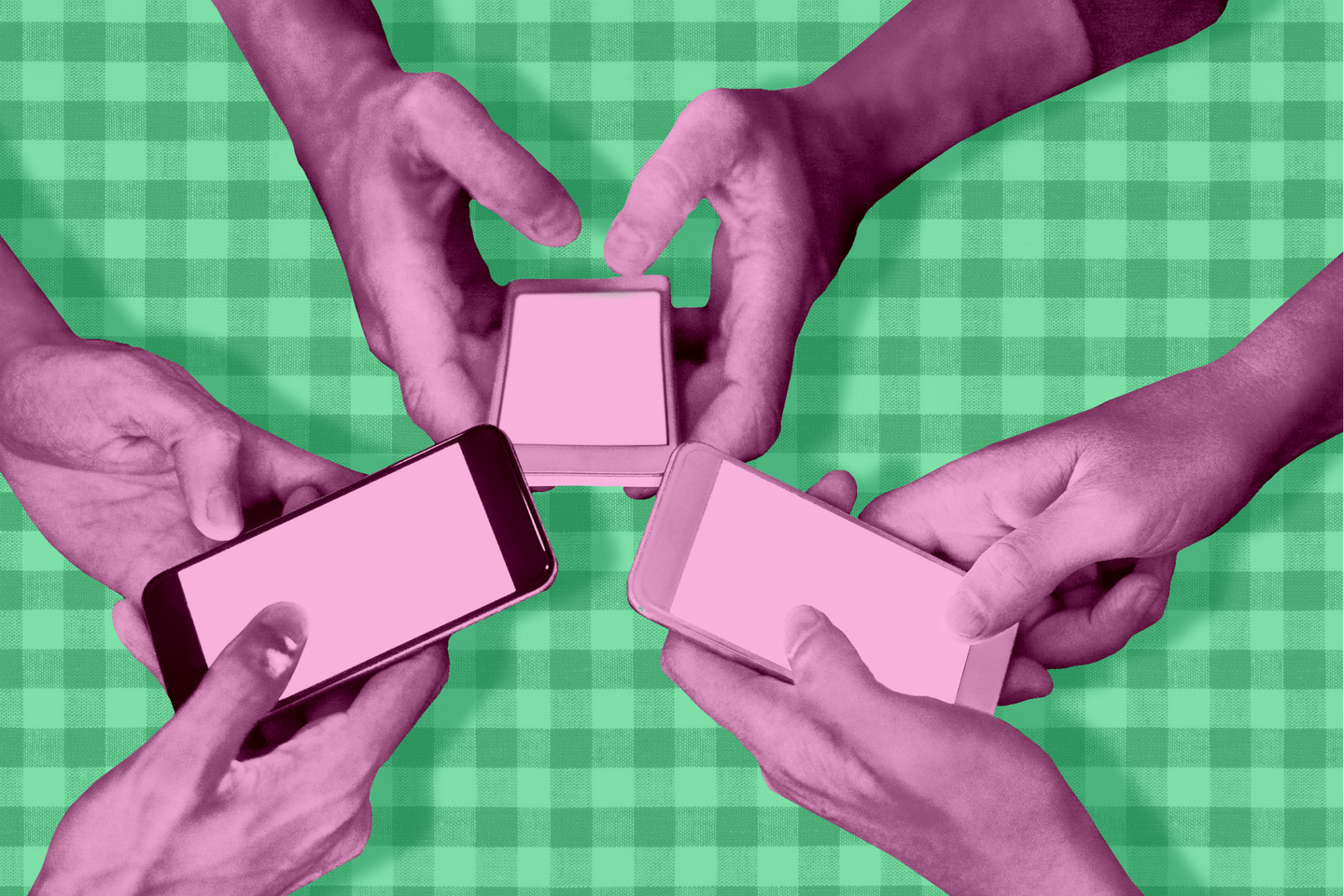L’an 2015, annus horribilis pour la France, frappée par une vague terroriste sans précédent. Le 7 janvier, la rédaction de Charlie Hebdo est décimée. Le lendemain, une policière est abattue à Montrouge (Hauts-de-Seine). Le surlendemain, l’Hyper Cacher de la porte de Vincennes, à Paris, est pris d’assaut. Bien que le territoire national soit placé en alerte de vigilance maximale, cela n’empêche pas les terribles attentats du 13 novembre d’être commis au Stade de France, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), au Bataclan et sur des terrasses des 10e et 11e arrondissements parisiens. Au total, on dénombre près de 150 morts et plusieurs centaines de blessés dans ces attaques ayant pour dénominateur commun l’islamisme – elles seront revendiquées par Al-Qaida et par l’organisation Etat islamique (EI).
Quelques mois avant l’hécatombe terroriste, en septembre 2014, le CNRS avait rendu public son « Livre blanc des études françaises sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans », un rapport relatif à la situation de la recherche en France dans ces domaines. Rédigé sous la houlette de l’historienne Catherine Mayeur-Jaouen, en concertation avec les représentants des laboratoires concernés, il tirait la sonnette d’alarme : « L’islamologie française, c’est-à-dire l’étude de l’islam comme religion et système de pensée, est menacée de disparaître, quand elle prospère partout ailleurs dans le monde (…). » Or, insistait l’autrice, « l’étude approfondie et véritablement scientifique des textes reste une nécessité à l’heure où tant de courants islamistes invoquent justement ces sources, à l’heure où les ventes de livres en arabe sont massivement, partout dans le monde, France comprise, des livres religieux de l’islam prémoderne ».
De fait, les données de ce Livre blanc s’avèrent sidérantes : non-remplacement de professeurs partis à la retraite – l’histoire religieuse de l’islam de langue arabe, du XVe au XIXe siècle, n’est plus enseignée nulle part en France, par exemple ; sous-encadrement des étudiants ; absence de maîtrise de l’arabe – le seul professeur d’histoire du Maghreb se trouvant alors en poste ne lit pas cette langue, tandis que les bibliothèques universitaires n’achètent quasiment plus de livres en arabe, et que des publications prestigieuses, à l’instar de la Revue des études islamiques en 1998, cessent de paraître.
Il vous reste 88.88% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.