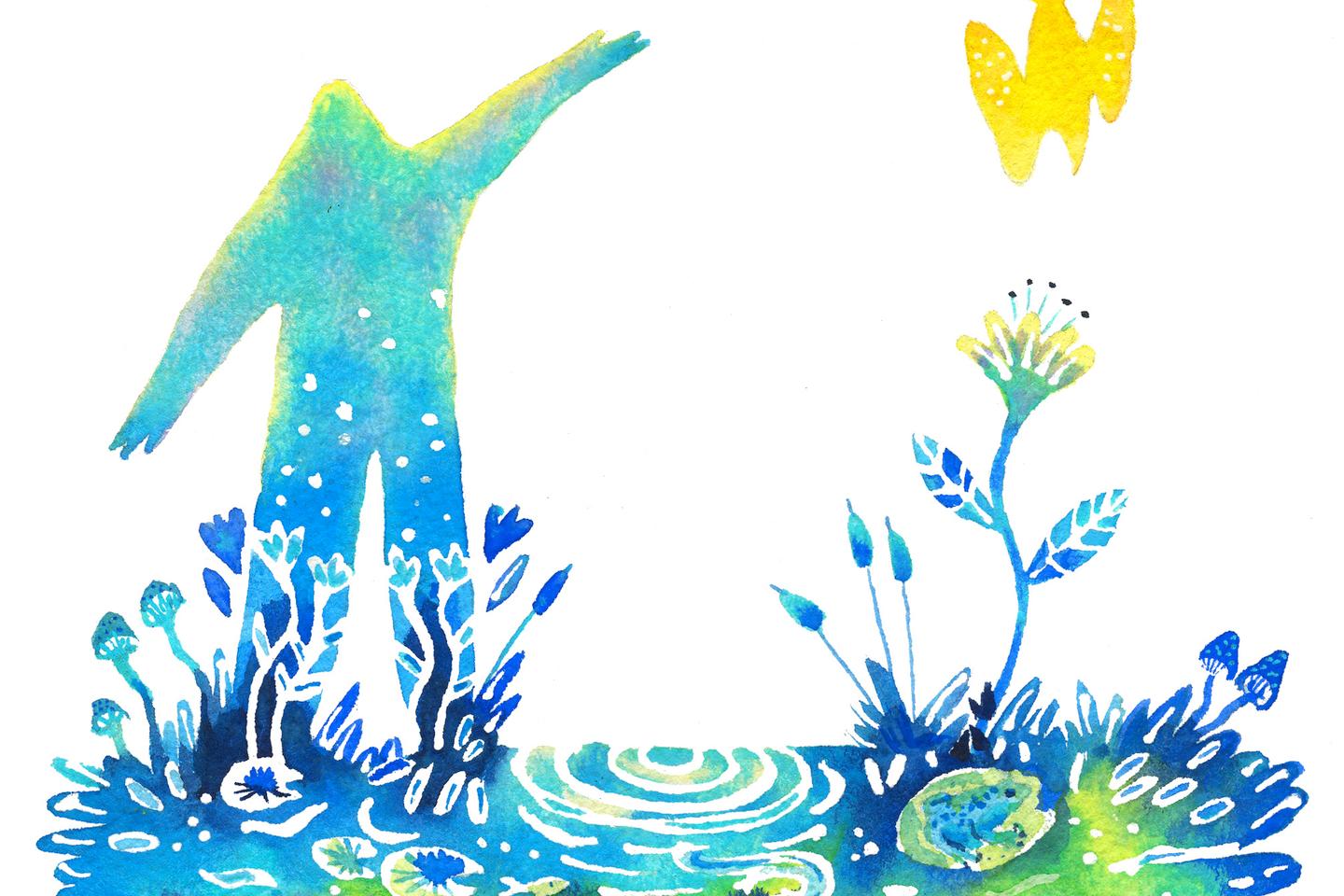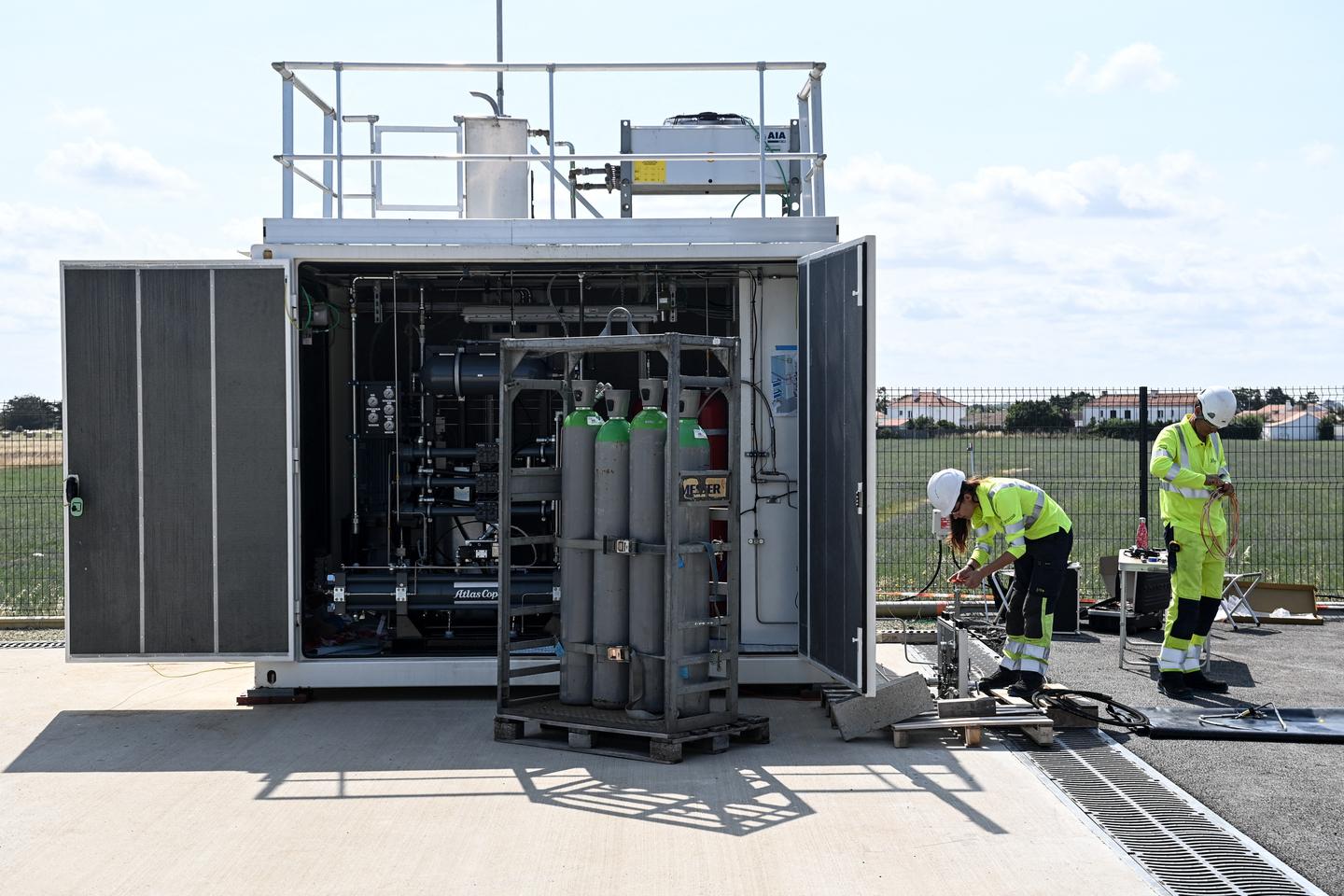Et si le vivant pouvait nous montrer la voie ? Face au changement climatique et à l’effondrement de la biodiversité, nos meilleurs alliés sont peut-être ceux que nous avons le plus mis à distance. Pour enrayer les crises écologiques, connaître et protéger le vivant et les écosystèmes n’est pas seulement un impératif : c’est aussi une partie de la solution.
Le podcast « Chaleur humaine » a rassemblé six scientifiques de renom pour plonger dans les mystères du vivant et comprendre comment les espèces s’épaulent pour créer des écosystèmes qui permettent à la vie de prospérer. Jeudi 15 mai, ces six chercheuses et chercheurs expliqueront, au Palais des sports de Grenoble, à l’occasion de la Biennale des villes en transition, comment leurs recherches leur ont permis de mieux appréhender le vivant. Rendez-vous sur cette page pour en savoir plus.
Vous pouvez cliquer ici pour vous inscrire gratuitement à l’infolettre « Chaleur humaine », et là pour rejoindre le canal « Chaleur humaine » sur Instagram.
Marie-Charlotte Anstett. L’abeille à la rescousse du cassis de Bourgogne
Comment faire revenir l’abeille Andrena fulva dans les cassissiers ? C’est à cette question qu’essaye de répondre l’écologue Marie-Charlotte Anstett, chargée de recherche CNRS à l’université de Bourgogne-Europe. L’abeille velue d’un roux flamboyant est l’une des pollinisatrices du noir de Bourgogne, une variété de cassis traditionnelle dans la région de Dijon. Alertés par des baisses importantes de rendements, les producteurs de cassis appellent Marie-Charlotte Anstett à la rescousse. La chercheuse montre, par comparaison avec des relevés scientifiques datant des années 1980, que 99 % des pollinisateurs du cassis ont disparu dans l’intervalle, dont l’un des principaux, l’andrène fauve, victime notamment de la présence de pesticides.
Un dispositif expérimental, à l’aide de faux bourdons, lui permet ensuite de montrer quels seraient les rendements si ces pollinisateurs n’avaient pas disparu. « On a plus que triplé le rendement du cassis en assurant une bonne pollinisation, explique-t-elle. Ces résultats, c’est un choc pour les agriculteurs. » Une dizaine d’entre eux ont accepté de suivre l’écologue dans un programme de réintroduction d’autres abeilles sauvages – des osmies – et de modifications de leurs pratiques. « Aujourd’hui, on peut compter 80 espèces d’abeilles sauvages revenues dans les champs de cassis, dont une vingtaine d’andrènes. Mais Andrena fulva, elle, a pour l’instant du mal à revenir », note l’écologue, qui amorce, avec les producteurs, une seconde étape du projet. En espérant voir revenir l’andrène fauve.
Vincent Prié. Les moules de rivière, vigies de la qualité de l’eau
Le chercheur Vincent Prié, spécialiste des mollusques et directeur de projets au sein du laboratoire Spygen, le reconnaît sans peine : « La moule de rivière, c’est une espèce méconnue et un peu ingrate de prime abord. » Pourtant, il y a quelques dizaines d’années, nos rivières étaient tapissées de ces mollusques qui peuvent vivre entre cinq et… deux cent quatre-vingts ans ! Dans les années 1970, les travaux sur les rivières, la multiplication des barrages et la pollution de l’eau en ont massivement réduit les populations en France.
Ces mollusques ne se mangent pas – « Ce n’est pas très bon », reconnaît Vincent Prié –, mais jouent un rôle majeur et longtemps méconnu pour les écosystèmes. « [Les moules] absorbent de l’eau en permanence, retiennent les particules en suspension, cela crée une sédimentation très particulière. En vingt-quatre heures, une moule nettoie un aquarium et clarifie les eaux. »
Or, une eau plus claire présente plusieurs bénéfices. D’abord, la lumière y pénètre mieux, ce qui est favorable aux algues, qui hébergent à leur tour des invertébrés en nombre, ce qui est propice à la multiplication des poissons. Mais cette capacité de filtrage est aussi une menace pour les mollusques : « [Ils] sont très sensibles à la qualité de l’eau et récupèrent tout : les pollutions, les microplastiques, etc. » C’est donc un bon indicateur : plus une eau est propre, plus on y trouve de moules de rivière. « La bonne nouvelle, c’est que le creux de la vague semble passé, puisque l’on commence à retrouver des moules là où elles avaient disparu, comme dans la Seine, à Paris, alors que le fleuve était très pollué dans les années 1980. »
Sandra Lavorel. La fétuque paniculée, une alliée contre le changement climatique
Personne ou presque ne connaît le nom de cette haute graminée, commune dans les massifs montagneux entre 1 800 et 2 200 mètres d’altitude. Sandra Lavorel, écologue, directrice de recherche à l’université Grenoble-Alpes, médaille d’or du CNRS 2023, voue pourtant une affection particulière à la fétuque paniculée, également appelée « queyrelle » dans les alpages. « Les promeneurs n’y prêtent pas attention. Les éleveurs ne l’apprécient pas car elle est dure à manger pour les bêtes. Les défenseurs de la biodiversité, non plus, car elle exclut les jolies fleurs autour d’elle. Bref, elle est mal aimée », note la scientifique.
La fétuque paniculée dispose pourtant d’atouts, notamment pour affronter le changement climatique en montagne. Particulièrement résistante à la sécheresse, elle pourrait se révéler utile pour maintenir les sols des prairies de montagne grâce à ses racines solides et en constituant une réserve de nourriture en cas d’extrême nécessité. Mieux ! La fétuque paniculée est un excellent puits de carbone. Son défaut : elle est également très sensible au réchauffement. Si elle sort trop tôt au printemps, elle peut griller sous l’effet des gels tardifs. « Cette plante nous pose donc un dilemme : faut-il la favoriser ou non ? Cela illustre très bien le type de questions auxquelles nous oblige l’adaptation au changement climatique », précise Sandra Lavorel.
Sabrina Krief. Les chimpanzés, sentinelles de notre avenir
Qu’est-il arrivé à Aragon ? Ce chimpanzé de 25 ans qui habite à Sebitoli, dans le nord du parc national de Kibale, en Ouganda, a une malformation faciale et un pied en moins. Membre d’un groupe d’une centaine d’individus vivant sur un territoire de 25 kilomètres carrés, il en est le plus âgé avec de telles infirmités. Depuis 2008, Sabrina Krief, primatologue au Muséum national d’histoire naturelle, cherche à comprendre et à protéger ces grands singes des atteintes que leur fait subir la pression grandissante des activités humaines sur la forêt. Ils sont chassés, mutilés, mais aussi empoisonnés par les produits phytosanitaires épandus sur les cultures.
« On a trouvé dans leurs poils plus de 60 polluants, néonicotinoïdes, glyphosate, DDT… », explique Sabrina Krief. Son équipe fait l’hypothèse que c’est l’exposition des femelles qui provoque les malformations. « Elles consomment du maïs dans les champs, exposent leur fœtus entre le premier et le troisième mois quand les cartilages se forment. A la naissance, les chimpanzés ont le nez mal formé », analyse la chercheuse, qui met en garde : « Les chimpanzés sont nos plus proches parents, on partage 99 % de leur ADN, ce sont des sentinelles. » Dans le cadre de la station d’étude qu’elle dirige, la primatologue travaille maintenant à la mise en place d’une filière de thé, cultivé sans pesticides, à proximité du territoire des chimpanzés de Sebitoli. Elle souhaite créer un label de commerce équitable qui permette aux agriculteurs d’obtenir de meilleurs revenus.
Ségolène Humann. Le moineau, symbole de la dérive de notre modèle agricole
Il est petit, vit aussi bien en ville qu’à la campagne, toujours proche des humains, nourrit ses petits avec des insectes et change de plumes une fois par an. Les plus de 50 ans se souviennent peut-être que le moineau était jadis abondant. Le moineau domestique a perdu la moitié de sa population en quarante ans. Les travaux de la chercheuse Ségolène Humann éclairent en partie ce phénomène. Elle a notamment montré, à travers l’analyse des plumes de moineaux capturés dans une soixantaine de fermes conventionnelles et biologiques du Plateau suisse agricole, que l’oiseau était massivement contaminé par les néonicotinoïdes, des pesticides qui s’attaquent au système nerveux des animaux.
Newsletter
« Chaleur humaine »
Comment faire face au défi climatique ? Chaque semaine, nos meilleurs articles sur le sujet
S’inscrire
« Les doses que les moineaux ingèrent sont sublétales : ils ne meurent pas d’un coup, mais ça les tue à petit feu », souligne-t-elle. Elle a par ailleurs mené des expériences consistant à injecter une microdose d’un néonicotinoïde à des moineaux retenus quelques semaines en volière afin d’en mesurer certains effets. « Cette très faible dose a augmenté le stress des mâles et a fait baisser leur densité spermatique, observe Ségolène Humann. On ne sait pas à quel point cela affecte leur fertilité. »
Charlène Descollonges. Le castor, ingénieur de nos rivières
Hydrologue et autrice de plusieurs ouvrages sur l’eau, Charlène Descollonges a vu monter ces dernières années l’intérêt pour le castor. « C’est une espèce étonnante, dont on ne comprend pas tout, mais qui joue un rôle majeur dans l’entretien des rivières. » Au début du XXe siècle, il ne restait plus qu’une centaine d’individus, en Camargue : la protection de l’espèce a permis de la sauver et de la réintroduire dans de grandes parties du territoire, et on compte désormais autour de 20 000 castors en France. Si sa quasi-disparition a transformé de nombreux cours d’eau, sa réintroduction progressive a contribué à améliorer la qualité de l’eau et la biodiversité.
« Les bénéfices de la présence du castor sont nombreux : il facilite le stockage de l’eau, crée des habitats pour les insectes, les oiseaux, les amphibiens. Il y a de nombreuses raisons de se réjouir de sa présence », estime Charlène Descollonges. L’hydrologue a souvent pisté les rongeurs, qui travaillent la nuit. « Quand on les observe, on se rend compte que c’est une espèce bruyante, on les entend et on les sent, puisqu’ils sécrètent du castoréum. » Surtout, ce sont d’étonnants ingénieurs : ils construisent sans plan des structures robustes, même si elles semblent chaotiques au regard des humains. Mais la coexistence avec le castor n’est pas forcément simple, en particulier avec les agriculteurs. « Il y a des stratégies de cohabitation possible, mais cela implique de changer de regard pour trouver des solutions », considère Charlène Descollonges.
Cet article a été réalisé en partenariat avec la Biennale des villes en transition, organisée par la ville de Grenoble.