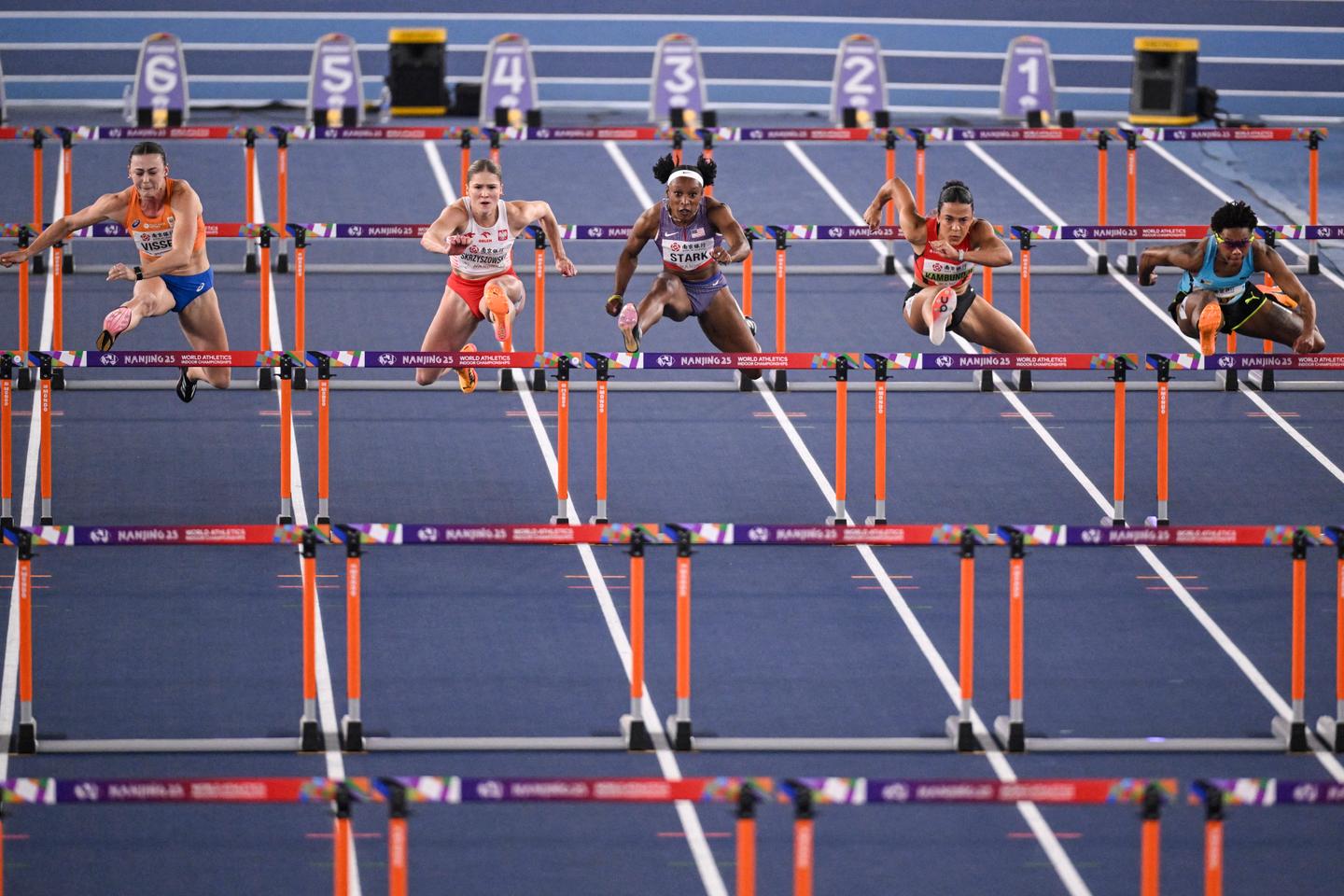Ingérences politiques, restrictions budgétaires, actions militantes : la liberté académique est en danger dans un nombre grandissant de pays, dont font désormais partie les Etats-Unis, sous la présidence de Donald Trump. Aucun classement des universités n’a pourtant estimé utile de mesurer le degré de liberté d’enseignement et de recherche, souligne Stéphanie Balme, directrice du Centre de recherches internationales, à Sciences Po. A l’occasion de la publication de l’édition 2025 du classement de Shanghaï, vendredi 15 août, elle exhorte l’Europe à « affirmer ses priorités » en promouvant les valeurs d’une science humaniste, de la liberté académique et de l’interdisciplinarité.
Lorsque est apparu le classement de Shanghaï, vous meniez vos recherches en Chine. Qu’aviez-vous perçu à l’époque ?
En 2006, j’étais en mission à l’université Shanghaï Jiao Tong, et dans le bureau où naissait ce qui allait devenir le célèbre classement chinois et mondial des universités. Je cherchais à analyser la stratégie scientifique de la Chine derrière cet outil et, accessoirement, à savoir pourquoi Sciences Po n’y figurait pas… Nous étions frappés par le contraste entre la discrétion de cette université, fondée à la fin du XIXe siècle et alors inconnue à l’international, et son ambition de classer toutes les autres, y compris les membres de l’Ivy League américaine [telles Harvard ou Yale], selon des critères purement quantitatifs [nombre de publications dans de grandes revues scientifiques, nombre de chercheurs…], calqués sur les standards états-uniens. Le monde universitaire international aurait pu ignorer ce classement. Au contraire, celui-ci a influencé les stratégies des établissements. Je me souviens d’avoir eu alors le sentiment d’assister à une transformation majeure dont peu, à l’époque, mesuraient encore l’ampleur.
Il vous reste 74.2% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.