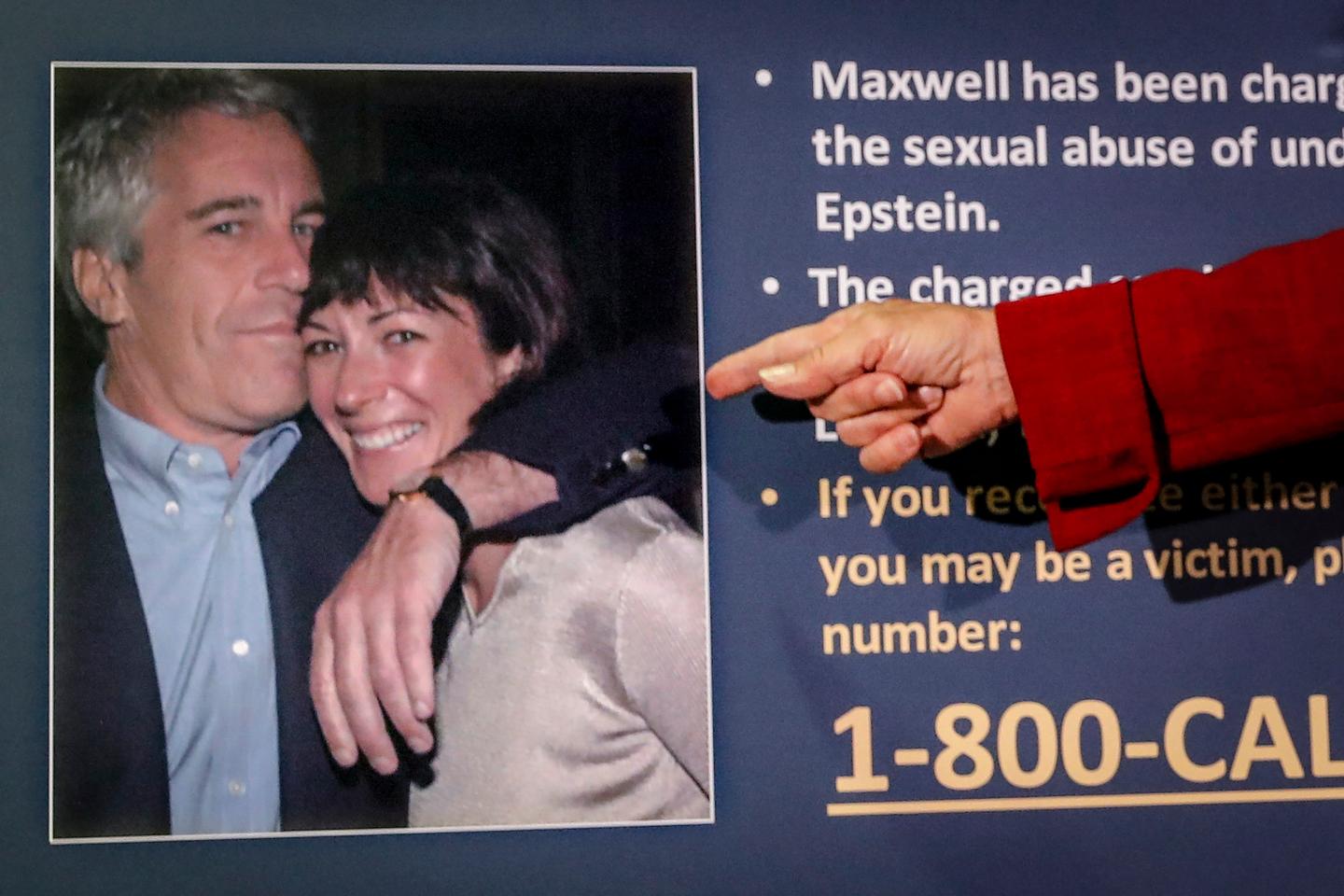Ses clients l’ont surnommé « Kouamé » – un nom très répandu en Côte d’Ivoire – parce qu’il vend, dit-on, le meilleur attiéké du coin. Dans son échoppe d’Oulfa, quartier populaire aux portes de Casablanca, Youssef Lazouzi propose un bout d’Abidjan : sachets de semoule de manioc à 18 dirhams (1,70 euro), riz parfumé… Il y a un peu plus d’un an, ce trentenaire marocain avait misé sur des cosmétiques bio. Sans succès. « Je me suis adapté à ma nouvelle clientèle, confie-t-il. Elle est aujourd’hui à majorité subsaharienne. »

A l’autre bout du quartier, Youssef Nasser, 42 ans, livre à vélo, comme chaque jour, sa vingtaine de kilos de gombos et de « piments africains qui arrachent » aux restaurateurs ambulants et bouis-bouis sénégalais ou nigérians, où l’on peut voir une photo du roi. Il y a quelques années, cet homme fluet vendait du pain. Il a changé de métier et gagne désormais 3 000 dirhams (284 euros) par mois, soit l’équivalent du salaire minimum au Maroc.
« Je les aime bien ces étrangers, je ne peux pas gâter [critiquer] les Subsahariens », glisse-t-il en usant, lui aussi, d’un verbe typique d’Afrique de l’Ouest : « J’ai un frère en France, un autre en Espagne, je ne veux pas qu’on les traite mal. Les Subsahariens méritent une chance au Maroc. Ils cherchent à s’en sortir, il faut les soutenir. »
Il vous reste 87.79% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.