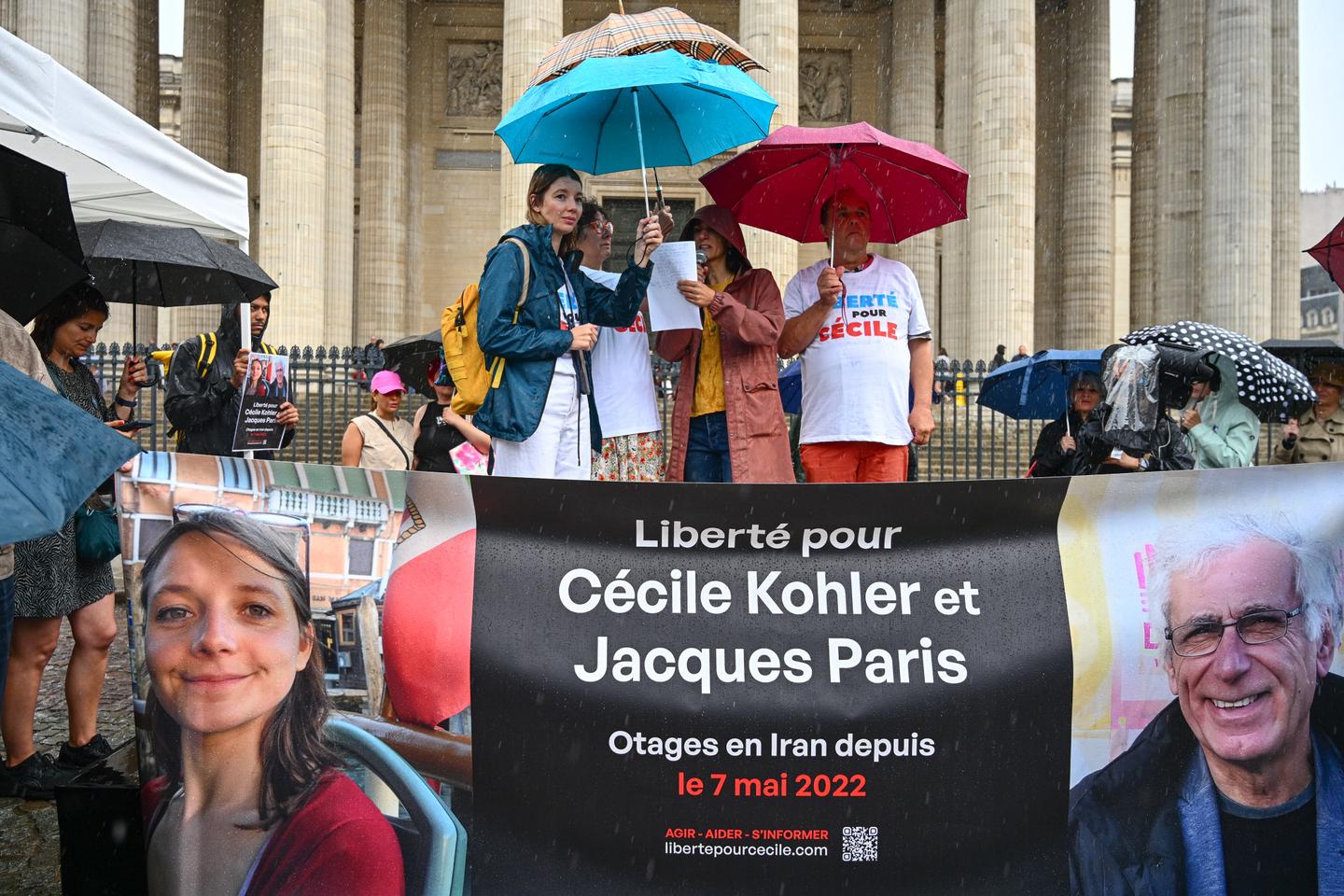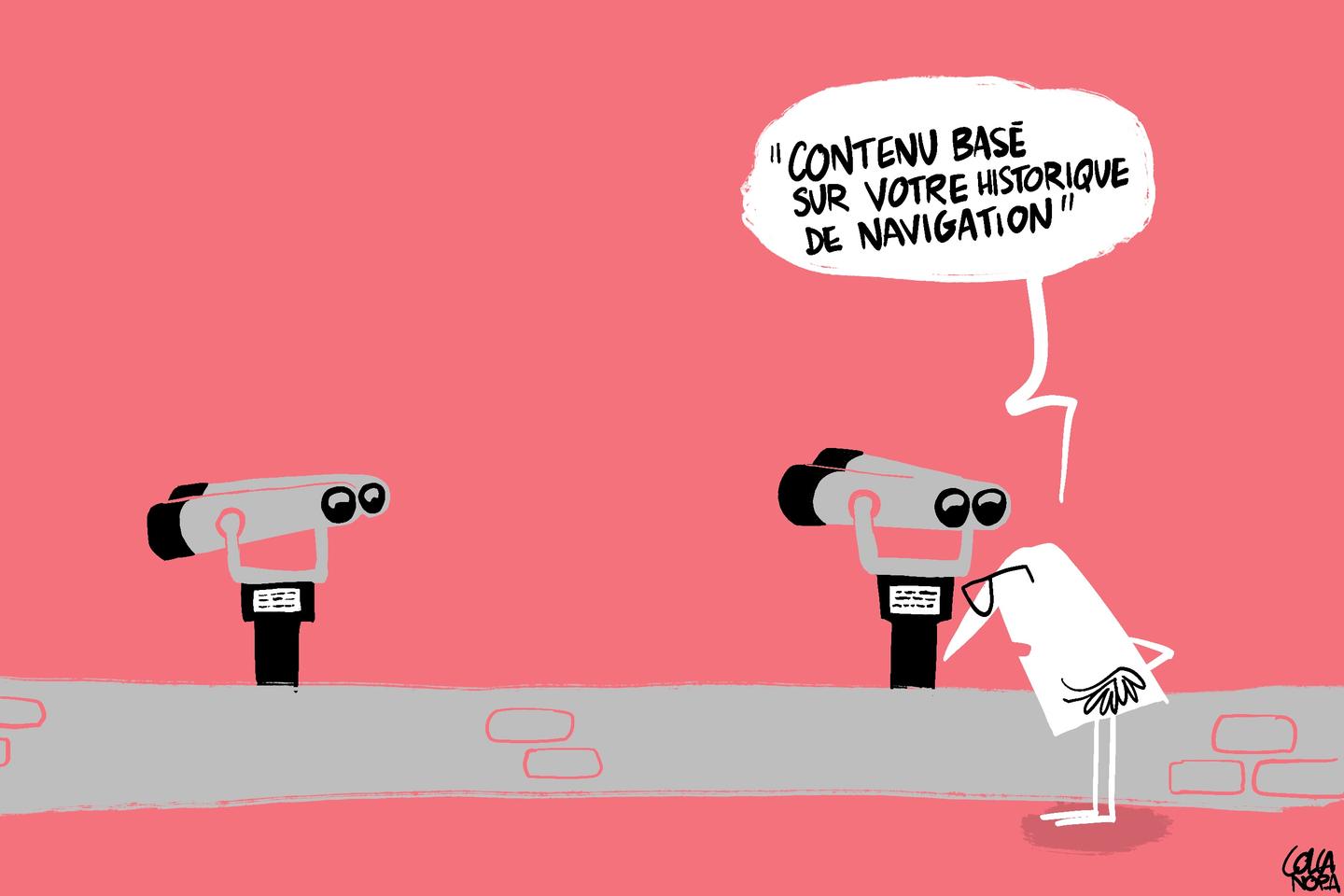Baptiste Giraud, maître de conférences en science politique à Aix-Marseille Université, et Jérôme Pélisse, professeur des universités en sociologie à Sciences Po, expliquent dans l’ouvrage collectif qu’ils ont coordonné, Le Dialogue social sous contrôle (PUF), que la négociation en entreprise est désormais conçue comme « le premier socle du droit du travail ».
Vous soulignez dans votre ouvrage que, depuis plusieurs décennies, l’Etat a multiplié les réformes visant à réorganiser les relations professionnelles. Quel est le fil directeur de ce mouvement ?
Baptiste Giraud : On observe dans cette succession de réformes une constante : la décentralisation de la négociation collective, avec une place croissante accordée à l’échelon des entreprises. Les lois Auroux, en 1982, vont ainsi instaurer le principe d’une négociation annuelle obligatoire au sein des organisations. L’entreprise sera également le cadre où devront être déterminées les modalités de mise en place des 35 heures. De même, dans les années 2000 et 2010, le champ de la négociation d’entreprise va être étendu à de nouvelles thématiques comme la lutte pour l’égalité professionnelle ou contre la pénibilité au travail.
Quel impact ont eu ces réformes, et la décentralisation qui les a accompagnées, sur le dialogue social ?
B. G. : Au-delà du mouvement continu en faveur des négociations en entreprise, on peut voir une évolution se dessiner. A partir de la fin des années 1990, cette décentralisation va être avant tout pensée pour permettre aux directions d’entreprise de renforcer leur stratégie de compétitivité (accroissement de la flexibilité du temps de travail, baisse du niveau de rémunération des heures supplémentaires…). Il s’agit, en somme, d’une mise sous contrôle étatique et patronale qui représente une subversion de la logique de la négociation collective.
Jérôme Pélisse : Autre évolution notable : le mouvement que nous venons de décrire s’accompagne d’une remise en cause du « principe de faveur » qui voulait qu’un texte de niveau inférieur (un accord d’entreprise par exemple) ne pouvait être que plus favorable aux salariés qu’un texte de niveau supérieur (un accord de branche, par exemple).
Il vous reste 57.6% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.