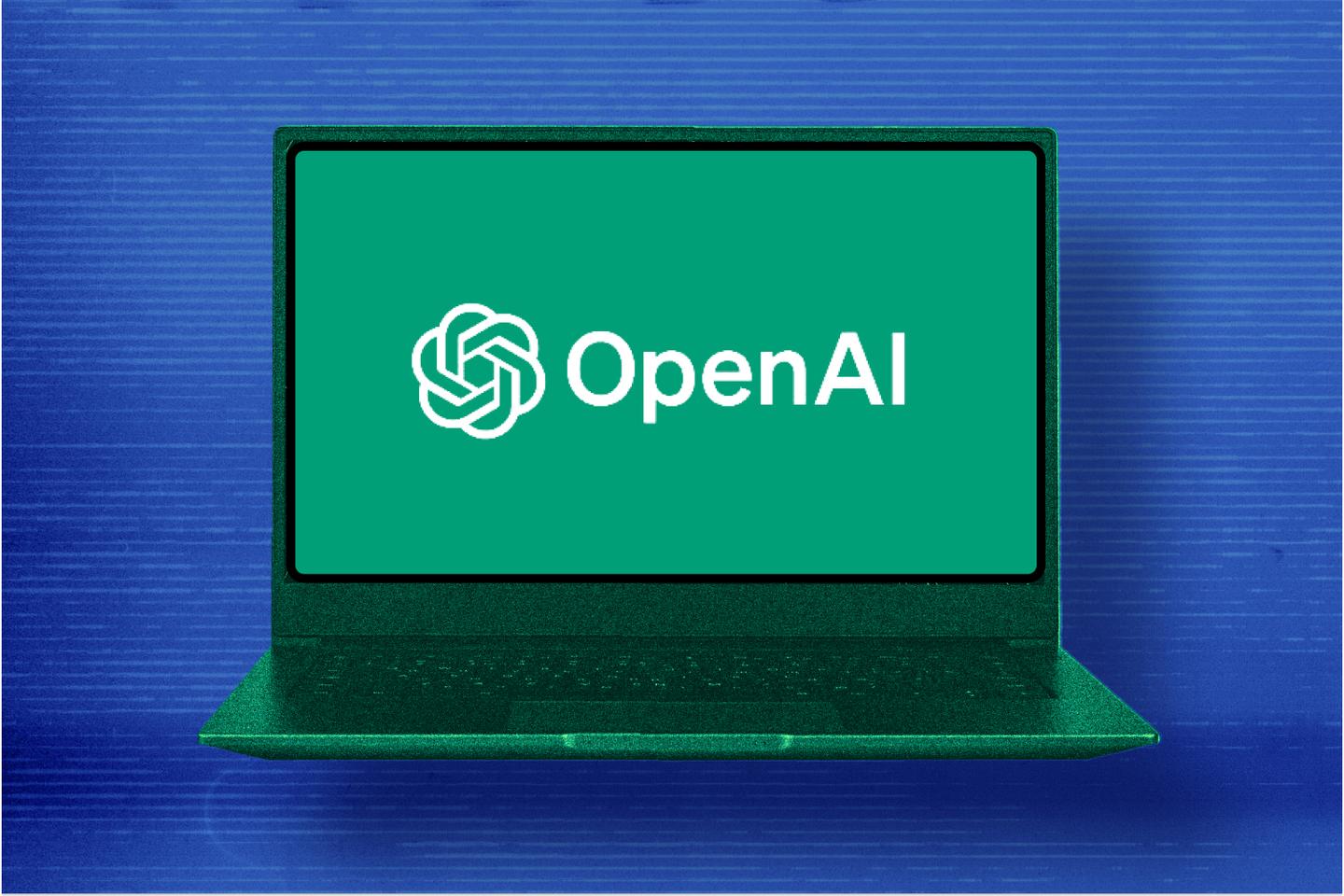Novembre 2020. Un mal mystérieux frappe les pêcheurs de Thiaroye-sur-Mer, près de Dakar, avant de s’étendre à d’autres villages de la Petite-Côte, au sud de la capitale sénégalaise. Le même scénario, partout, se répète : après être sortis en mer, des hommes remontent leur pirogue sur la plage et découvrent que leur corps est couvert de boutons urticants. Cette étrange varicelle touche leurs mains, leurs avant-bras, souvent les contours de leur bouche, parfois leurs parties génitales et leurs yeux. Ils sont des dizaines, puis des centaines affectés par cette maladie inexpliquée.
Il aura fallu cinq années d’investigations en mer et de recherches pour trouver la responsable de ces « dermatoses aiguës » : une microalgue marine, Vulcanodinium rugosum, qui produit une biotoxine, la portimine A, à des « niveaux élevés », selon les conclusions publiées le 13 février dans la revue scientifique EMBO Molecular Medicine. L’énigme a été résolue par un consortium scientifique international réunissant une quinzaine de laboratoires sénégalais, français, espagnol et singapourien. Mais les enquêteurs ont longtemps tâtonné, laissant malgré eux la psychose se répandre.
D’abord, se souvient Patrice Brehmer, de l’Institut de recherche et de développement de Dakar, « les hommes infectés ont tardé à prévenir les autorités à cause du tabou entourant ce mal jugé infamant, ce qui a ralenti les enquêtes ». Sollicité dès l’alerte donnée par la gendarmerie sénégalaise à la mi-novembre 2020, le scientifique a participé aux premières sorties en mer pour prélever des échantillons. « On ne savait pas quoi ni où chercher précisément. Nous étions démunis », reconnaît-il.
Les premières analyses se concentrent sur des polluants chimiques, mais la piste est vite écartée. Des nappes brunâtres ont été aperçues au large de l’île de Gorée. Fausse alerte encore, rien d’anormal n’est détecté dans les eaux. Le pétrole est un temps soupçonné à cause des explorations de gisements d’hydrocarbures qui se multiplient à l’époque au large de la Petite-Côte. « Des niveaux importants de phtalate provenant de dérivés pétroliers étaient notés dans les filets de pêcheurs, explique Patrice Brehmer. Mais, dans la littérature scientifique, il n’y avait aucune concordance entre ces symptômes observés et les perturbateurs endocriniens liés aux phtalates. » Nouvelle désillusion.
« Les rumeurs les plus folles circulaient »
En plein Covid, l’inquiétude, voire la paranoïa s’emparent de Dakar. Certains cessent d’acheter du poisson alors que les produits de la mer sont très utilisés dans la cuisine sénégalaise et que le secteur de la pêche fait vivre au moins 17 % de la population active du pays. « Les rumeurs les plus folles circulaient à l’époque, rapporte Souleymane Diagne, pêcheur à Ouakam. On disait même que c’était la lotte qui en était à l’origine. » Aucune intoxication alimentaire pourtant ne sera relevée. Et aucun baigneur ne présentera de symptômes inquiétants.
Assez rapidement, le profil des malades se précise. Des pêcheurs, utilisant « uniquement des filets maillants calés ou des filets dérivant de surface », selon l’étude, souffrent de ces « nécroses cutanées ». « Le 24 novembre 2020, on arraisonne au hasard une pirogue de pêcheurs artisanaux, raconte Patrice Brehmer. En prélevant une substance marron dans les filets, j’ai l’intuition que l’on est tout proche. » Après avoir exclu les pistes d’infections bactériennes, virales ou de polluants chimiques, des échantillons sont envoyés en France à l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer).
Et puis ? Plus rien, ou presque. La « maladie mystérieuse des pêcheurs sénégalais » s’évapore aussi inexplicablement qu’elle est apparue. A partir de janvier 2021, plus aucun cas n’est signalé, tous les hommes infectés finissent par guérir, les éruptions cutanées ayant parfois duré quelques heures ou 21 jours au maximum. Mais à l’instar d’un serial killer dans un polar, le mal revient, un an plus tard, « dans la même zone géographique, et à la même période », précise M. Brehmer. Sans que les scientifiques parviennent à l’expliquer, la crise baisse en intensité. Elle a touché au total 1 300 personnes au Sénégal entre novembre 2020 et décembre 2021.
Des cas similaires en Guinée
Début 2022, près de 500 pêcheurs attachés au port de Bonfi, près de Conakry, la capitale guinéenne, présentent des éruptions cutanées similaires à celles observées au Sénégal. Avec son « masque, [son] tuba et un filet à plancton », Patrice Brehmer repart en mer pour collecter des échantillons. En France, où l’étude est élargie, son collègue de l’Ifremer, Philipp Hess, responsable de l’unité Physiologie et toxines des microalgues toxiques, fait un parallèle avec une étrange maladie ayant touché Cuba, en 2015. « Une soixantaine d’adolescents étaient ressortis d’une baignade dans la baie de Cienfuegos avec les mêmes éruptions cutanées, dit-il au Monde. Sauf qu’à l’époque, on ne dispose que de leurs témoignages et d’aucune photographie. »
Restez informés
Suivez-nous sur WhatsApp
Recevez l’essentiel de l’actualité africaine sur WhatsApp avec la chaîne du « Monde Afrique »
Rejoindre
De semaine en semaine, l’énigme suscite davantage l’intérêt des scientifiques. Ces derniers pointent le rôle clé joué par la toxine émise par la microalgue Vulcanodinium rugosum « en raison d’un faisceau de présomptions fiables ». Mais il reste à savoir « pourquoi ces toxines [sont] responsables de ces lésions cutanées », poursuit Philippe Hess.
Des dermatologues de Toulouse, des scientifiques de Murcie en Espagne et de Singapour se joignent au jeu de piste autour de Vulcanodinium rugosum. En laboratoire, ils travaillent sur des cellules primaires pour comprendre la chaîne immunitaire ayant conduit à ces nécroses cutanées. Ils dévoilent le rôle primordial d’un « capteur immunitaire, l’inflammasome NLRP1 », à l’origine « d’un mécanisme de défense […] provoquant ainsi les symptômes sévères constatés chez les pêcheurs », selon l’étude parue le 13 février.
Reste deux énigmes, et non des moindres. Pourquoi et comment cette microalgue s’est-elle développée en pleine mer au large de Dakar et Conakry alors qu’elle était observée dans des baies comme à Cuba ? Et est-ce la faute à l’intensification du transport maritime, notamment aux bateaux de pêche chinois observés à Cuba et le long du littoral ouest-africain ? L’enquête n’est pas encore tout à fait bouclée.