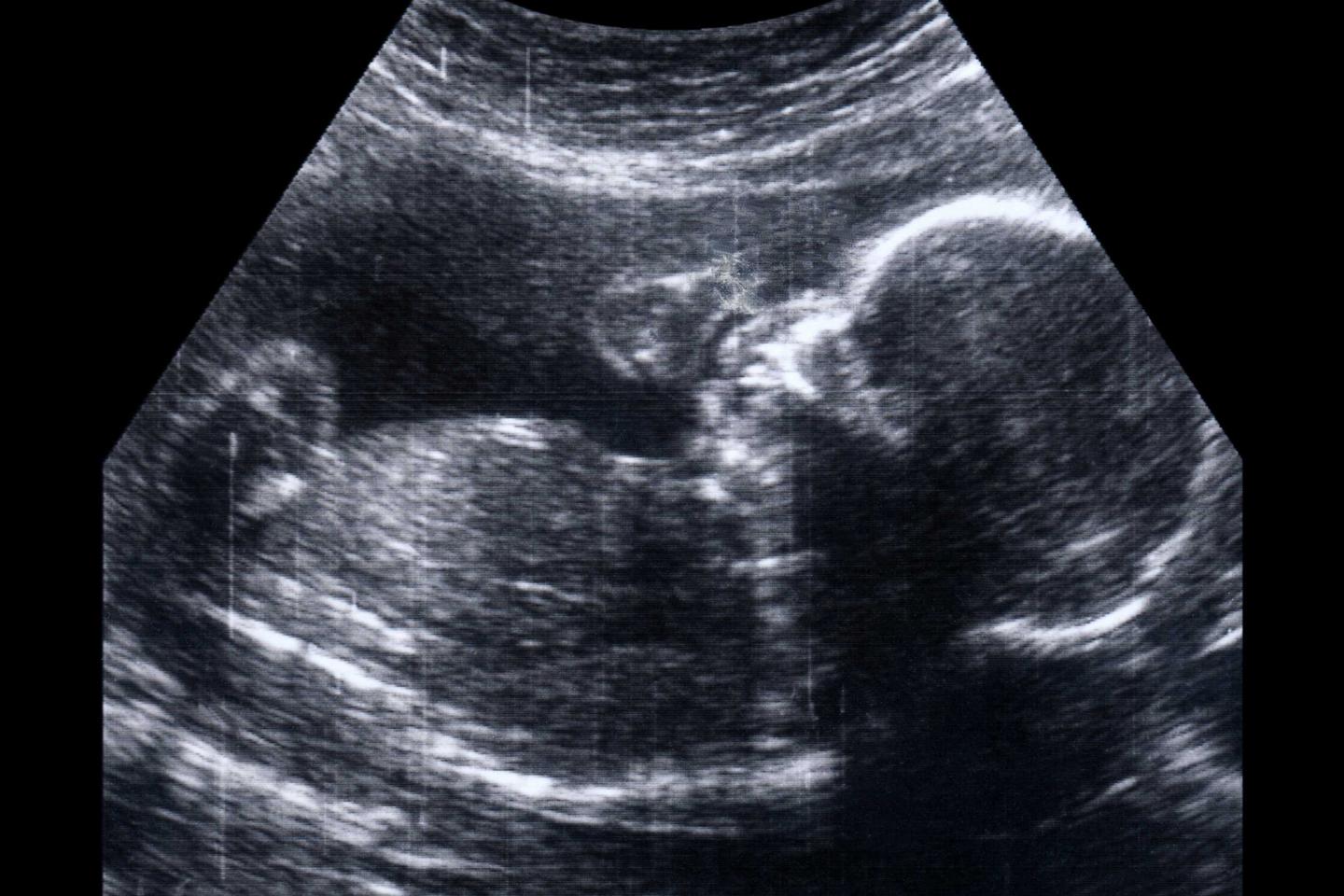Sur l’image de son post d’adieu publié sur Facebook, Matar Diagne, 27 ans, affiche un large sourire. Le regard vers l’horizon, l’étudiant pose seul sur le pont Faidherbe, l’un des édifices emblématiques de la ville de Saint-Louis au Sénégal. Son visage radieux contraste avec ses mots. « Je ne serai plus vivant quand vous lirez ce message, dit-il en annonçant son suicide. Je préfère mourir dans la dignité plutôt que de vivre dans le déshonneur ». Matar Diagne s’est pendu dans la nuit du 10 au 11 février.
Pour expliquer ce « déshonneur », il évoque à six reprises son « isolement », amplifié par la « souffrance de la maladie » sans nulle autre mention du mal qui le touchait. Il y décrit sa détresse psychologique et l’absence de soutien. Avant son geste, l’étudiant en master de droit souligne la « pression » sociale et demande que les fonds versés en vue de la publication d’un manuscrit envoyé à un éditeur servent à la « prise en charge de l’AVC de [sa] mère ».
Son suicide a suscité une vague d’émotions sur les réseaux sociaux et dans les médias sénégalais. Vus et commentés en ligne des dizaines de milliers de fois, ses propos exhortant à l’écoute – « N’isolez personne, n’ignorez personne (…). Rapprochez-vous des gens qui s’isolent, parlez-leur (…) sans les juger » – ont été repris à la une des journaux du pays.
Le quotidien gouvernemental Le Soleil écrit ainsi que ce témoignage a agi comme un « miroir des maux dont souffre la société sénégalaise » et a appelé à tirer « les leçons de ce cri silencieux » pour éviter que « d’autres jeunes ne succombent au désespoir ». Aucune réaction politique n’est toutefois intervenue.
Seulement 38 psychologues et psychiatres dans le pays
« Le drame de Matar illustre d’abord le tabou de la santé mentale, surtout celle des hommes », juge Fatou Fall, la présidente de Safe Open Space (SOS). En lisant sa missive, celle qui a été parmi les premières à avoir mis en place des cellules d’écoute au Sénégal a eu « un sentiment de déjà-vu ».
« Il y a six ans, un Sénégalais anonyme avait annoncé sur Twitter [X, aujourd’hui] son suicide », explique-t-elle. Il l’avait rendu public en avançant que « peut-être [sa mort] aiderait certains pour mieux se comporter avec les gens ». La militante y a vu un écho aux « calomnies et [aux] accusations non fondées », dénoncées par Matar, et la « preuve persistante de la stigmatisation de la santé mentale au Sénégal ».
Signes du manque de préoccupation publique, les seules données officielles disponibles datent de 2019. Avec 38 psychologues et psychiatres pour 18 millions de Sénégalais, le « ratio d’un thérapeute pour 475 000 habitants reste alarmant ». L’Organisation mondiale de la santé (OMS) en préconise 25 fois plus. « Et il y a urgence à faire de la prévention face à une population extrêmement jeune », rappelle Mme Fall, alors que trois Sénégalais sur quatre ont moins de 35 ans, selon les statistiques officielles.
A Saint-Louis, le suicide de Matar a créé « une onde de choc » et a provoqué « une réponse ambivalente des autorités académiques », selon Al Jabbar Adebo, lui aussi étudiant à l’université Gaston-Berger (UGB). Formé en novembre 2024 à l’écoute active par l’association SOS, l’élève ingénieur a participé au rassemblement organisé dans l’un des amphithéâtres trois jours après le suicide de l’étudiant.
Des traumatismes nombreux
« Le rectorat nous l’a présenté comme une thérapie collective », dit-il. « Cela ressemblait davantage à une opération communication », commente un autre participant qui a souhaité garder l’anonymat. Devant la centaine d’étudiants ayant pris part à la réunion, un agent administratif de l’université a invité à « la résilience » et à « se forger un moral de fer », d’après cette même source dénonçant une « initiative contre-productive ».
Restez informés
Suivez-nous sur WhatsApp
Recevez l’essentiel de l’actualité africaine sur WhatsApp avec la chaîne du « Monde Afrique »
Rejoindre
« Nous avons besoin de psychologues disponibles sur le campus, poursuit Al Jabbar Adebo. On doit faire face à un mal-être grandissant des étudiants, dont l’isolement s’est renforcé du fait de la dégradation de nos conditions de vie, notamment des logements et de la restauration ».
La mort de Matar a suscité des revendications semblables à l’université Cheikh-Anta-Diop (UCAD) de Dakar. Le principal centre universitaire au Sénégal accueille plus de 90 000 des 240 000 étudiants du pays, mais ne compte aucune cellule d’accompagnement psychologique.
Les traumatismes sont pourtant nombreux. Les révoltes de juin 2023, suite à la condamnation à deux ans de prison de l’ancien opposant devenu premier ministre, Ousmane Sonko, avaient été violemment réprimées et avaient entraîné la fermeture du campus durant six mois. Depuis, ses facultés peinent à retrouver un semblant de normalité.
Retard dans le versement des bourses
Au lendemain de la réunion à l’université de Saint-Louis, une trentaine d’étudiants dakarois « en master de droit comme Matar » devisaient, sous les margousiers de la faculté, de la « trahison des nouvelles autorités » après l’annonce de la fin des bourses d’accompagnement.
Le « malaise étudiant », renforcé par les retards – parfois de 14 mois – dans le versement des bourses pédagogiques est pointé. « Les autorités font croire que nous serions des privilégiés, alors qu’avec le système des bourses nous faisons vivre nos familles restées au village et payons nos études », rappelle Mohamed, membre d’un collectif de tous les masters 2 de l’UCAD.
A l’instar de l’étudiant « devenu militant par la force des choses », tous racontent une vie difficile : les chambres exiguës en colocation, les privations de nourriture – les 7 000 francs CFA (quelque 10 euros) mensuels en coupons ne permettent pas plus d’un repas par jour au restaurant universitaire –, et la pression sociale alors que « le niveau pédagogique ne cesse de se dégrader ». « Tout concourt à notre déclassement, se désole Mohamed. Le suicide de Matar en est le symptôme. » Depuis Saint-Louis, Al Jabbar Adebo poursuit : « Combien de Matar faudra-t-il au gouvernement pour réagir et comprendre l’ampleur du feu qui couve au sein de la jeunesse sénégalaise ? »