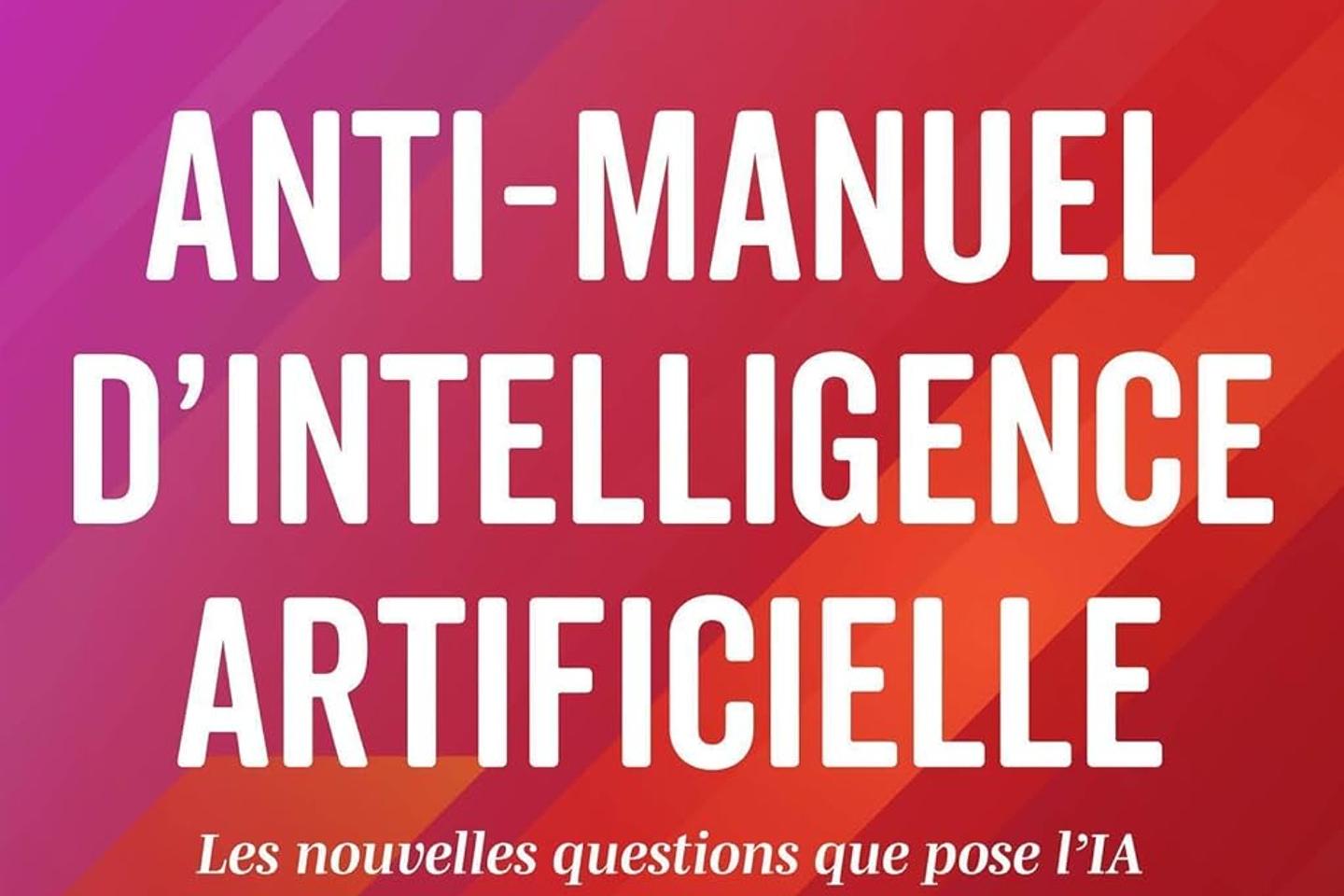Même s’ils sortent d’une usine située au cœur de l’Afrique de l’Est, les jeans Wrangler et Levi’s sont fabriqués selon une stricte tradition américaine et destinés à des chaînes telles que Walmart et JC Penny aux Etats-Unis. Pour l’instant.
L’exportateur de vêtements United Aryan, installé à la périphérie de Nairobi, la capitale du Kenya, doit son existence à l’African Growth and Opportunity Act (AGOA), des accords vieux de vingt-cinq ans donnant accès à certains produits africains au marché américain sans droits de douane. L’AGOA expirera en septembre, à moins que le président Trump n’accepte de le prolonger. Une décision qui menace les moyens de subsistance de millions d’Africains, parmi lesquels des milliers d’employés d’United Aryan.
Jusqu’à 8 millions de paires de jeans ainsi que des millions de chemises et d’autres articles sont expédiés de l’usine vers les Etats-Unis chaque année. Un ouvrier moyen d’une chaîne de production gagne l’équivalent d’environ 190 euros par mois. « Nous avons 150 000 personnes qui dépendent directement ou indirectement de nous », explique le PDG, Pankaj Bedi, soulignant que son usine « a stabilisé l’ensemble de la situation socioéconomique de la région ».
La zone était dangereuse avant le début des activités d’United Aryan, en 2002, souligne-t-il : « Les gangs volaient tout, jusqu’aux câbles en cuivre ! » Aujourd’hui, « nos familles sont heureuses, nos enfants vont à l’école, la criminalité a diminué », souligne Norah Nasimiyu, 48 ans, représentante des travailleurs, entourée d’ouvriers coupant des jeans et cousant des poches. Chaque jour, des milliers de personnes se rassemblent devant les portes de l’usine, espérant remplacer les absents parmi les quelque 10 000 employés.
L’usine a déjà connu de sérieux défis : en 2005, l’abolition d’un régime de quotas qui avait encadré le commerce du textile pendant des décennies a inondé les marchés de vêtements asiatiques. La crise financière de 2008 et la pandémie de Covid-19 l’ont ensuite presque mise à l’arrêt. « Il y a eu de nombreuses fois où nous avons pensé que nous devions abandonner, déclare Pankaj Bedi. Mais lorsque vous avez 150 000 personnes qui dépendent de ce que vous faites, vous avez une responsabilité. Fermer une entreprise est une affaire de cinq minutes, mais créer ce genre de plateforme n’est pas facile. »
Le temps presse
Aujourd’hui, l’usine est suspendue à une question : les Etats-Unis renouvelleront-ils l’AGOA ? Sans avantage en matière de franchise de droits, les acheteurs américains se tourneront vers des options moins chères en Asie. Si les républicains et les démocrates semblaient, lors de négociations entreprises l’année dernière, favorables à la prolongation des accords, la survie de ceux-ci semble aujourd’hui menacée par le retour de Donald Trump à la Maison Blanche et sa position ouvertement sceptique à l’égard du libre-échange.
Les Etats-Unis bénéficient de la main-d’œuvre la moins chère d’Afrique, surtout dans le secteur du textile, sensible aux coûts, observe Bedassa Tadesse, professeur d’économie à l’université du Minnesota à Duluth. « Mais nous sommes arrivés à un stade où les décisions de politique commerciale ne sont plus seulement fondées sur une analyse coût-bénéfice », estime-t-il. Le président américain pourrait néanmoins voir l’AGOA comme un moyen de contrer l’influence chinoise en Afrique, observe M. Tadesse.
« C’est un instrument très important dans les relations américano-africaines, surtout quand nous venons de perdre pratiquement tout notre “soft power” en démantelant l’Usaid » (l’agence américaine d’aide au développement), ajoute Witney Schneidman, expert de l’AGOA au sein du groupe de réflexion américain Brookings Institution. Mais « c’est un petit changement dans la vision du monde de Trump », ajoute-t-il.
Restez informés
Suivez-nous sur WhatsApp
Recevez l’essentiel de l’actualité africaine sur WhatsApp avec la chaîne du « Monde Afrique »
Rejoindre
Pankaj Bedi, qui a participé aux négociations au sein de l’Association manufacturière kényane, reste confiant : « Vous ne pouvez pas produire en Amérique ce que nous produisons », souligne-t-il. Mais le temps presse. L’usine et ses clients doivent connaître le sort de l’AGOA d’ici à la fin de mars pour pouvoir planifier la saison à venir. Sinon, les lignes de production s’arrêteront. « Les acheteurs ont commencé à paniquer, relève M. Bedi. Nous leur avons assuré que tout ira bien. Croisons les doigts ! »