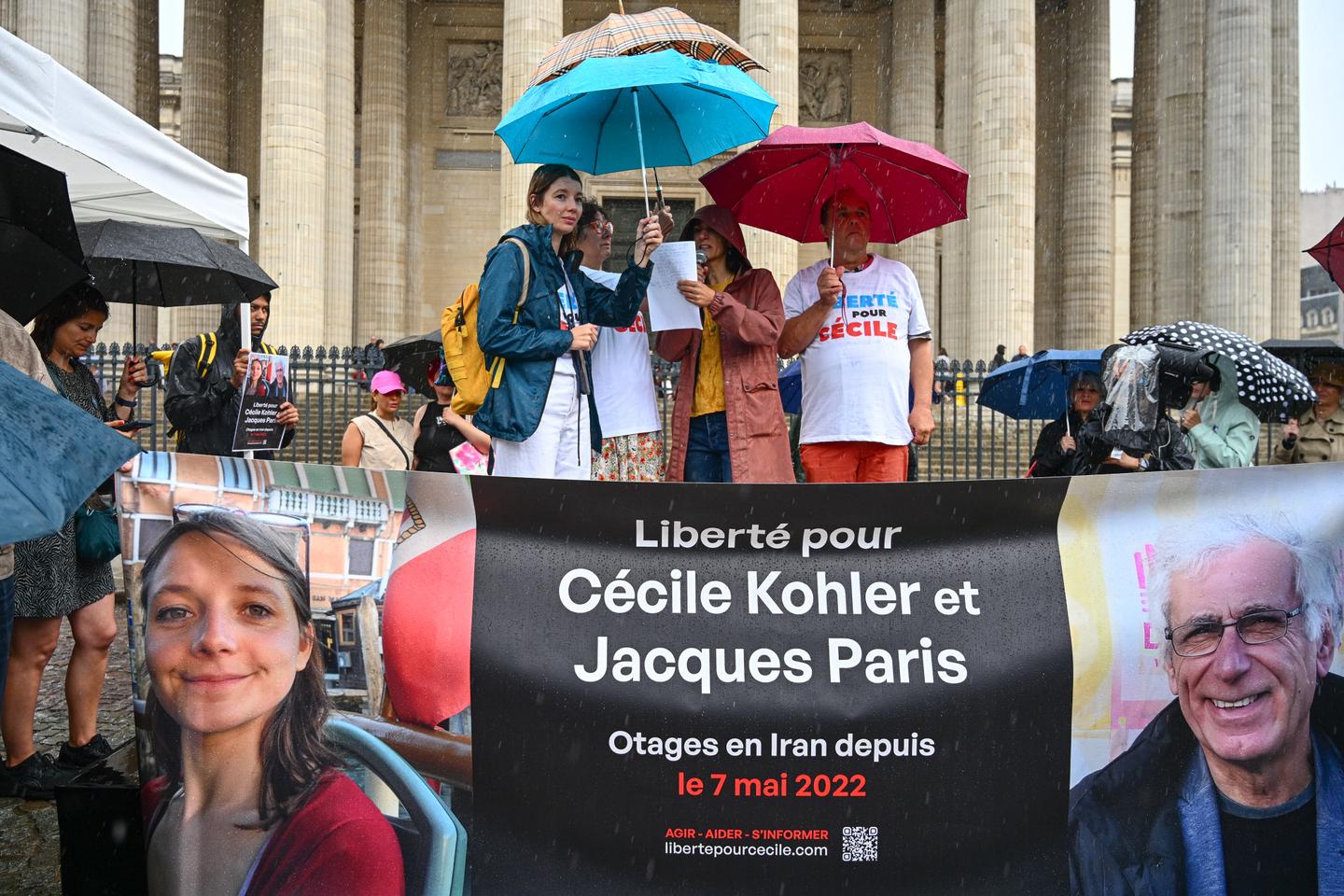Entre le début des manifestations lancées par le mouvement de la génération Z et la fuite du président Andry Rajoelina à Dubaï, dimanche 12 octobre, dix-huit jours se sont écoulés, à Madagascar, au cours desquels les revendications visant la fin des incessantes coupures d’eau et d’électricité se sont transformées en un appel à la démission du chef de l’Etat. La chute de ce président élu dans des conditions contestées dans un pays aux multiples potentialités mais entravé par une effarante corruption n’est pas, a priori, une mauvaise nouvelle. Surtout lorsque, en dépit d’une répression féroce, la jeunesse malgache, dont on ne peut que saluer la volonté de prendre son destin en main, a finalement obtenu, samedi, que l’armée prenne son parti sans effusion de sang.
Arrivé une première fois à la tête du pays par un coup d’Etat soutenu par l’armée en 2009, M. Rajoelina avait été contraint en 2013 de se retirer de la scène politique. Il avait ensuite été élu à deux reprises lors de scrutins entachés de multiples irrégularités, en 2018 puis en 2023. Il promettait alors de réaliser en cinq ans ce qui ne l’avait pas été au cours des soixante années écoulées depuis l’indépendance : transformer Madagascar en pays émergent.
En réalité, la Grande Ile, a, en dépit de ses ressources naturelles, poursuivi la funeste trajectoire qui en fait le seul pays au monde à n’avoir jamais cessé de s’appauvrir sans pourtant avoir connu de guerre. Aujourd’hui 80 % de sa population vit avec moins de 3 dollars (2,60 euros) par jour, le système éducatif est à terre, et le réseau de routes praticables moins dense qu’au moment de l’indépendance. Dans ce chaos, une petite élite a cependant prospéré autour du président, s’arrogeant, grâce aux leviers de l’Etat et à une corruption généralisée, marchés publics et monopoles sur l’exploitation des ressources naturelles, exportées selon des circuits pas toujours officiels.
Cynisme et déni
Depuis son exil, Andry Rajoelina se place à présent sur le terrain du droit pour contester l’acte de destitution voté par l’Assemblée nationale malgache. Il dénonce une dérive inconstitutionnelle consacrée par la prise de pouvoir des militaires, dont l’une des conséquences pourrait être la suspension des financements internationaux vitaux pour Madagascar. Il parle en connaissance de cause, puisqu’il a lui-même été sanctionné en 2009.
On ne peut qu’être frappé par le cynisme de cette mise en garde, de la part d’un dirigeant qui n’a cessé de bafouer le droit pour asseoir son pouvoir, et finalement pour masquer son déni des causes du soulèvement populaire qui a conduit à sa chute. Rien ne dit que les militaires au pouvoir voudront et sauront satisfaire les attentes de la population en souffrance. Mais la communauté internationale, qui a fermé les yeux sur les dérives de M. Rajoelina, ferait montre d’hypocrisie si elle se précipitait pour infliger des souffrances supplémentaires à une population qui vient de se libérer d’un dirigeant indigne.
Quant à Emmanuel Macron, il aurait mieux fait de s’abstenir, plutôt que de manifester le 13 octobre son souci de la « continuité institutionnelle » à Madagascar, renouvelant un message si souvent adressé par Paris à l’égard de dirigeants africains corrompus mais amis, qui nourrit les colères populaires.
Par ses paroles, le président français n’a fait que déclencher l’hostilité d’une population malgache pourtant largement francophile. Il a aussi maladroitement mis en lumière le décalage entre son discours et la réalité des mouvements à l’œuvre en Afrique.