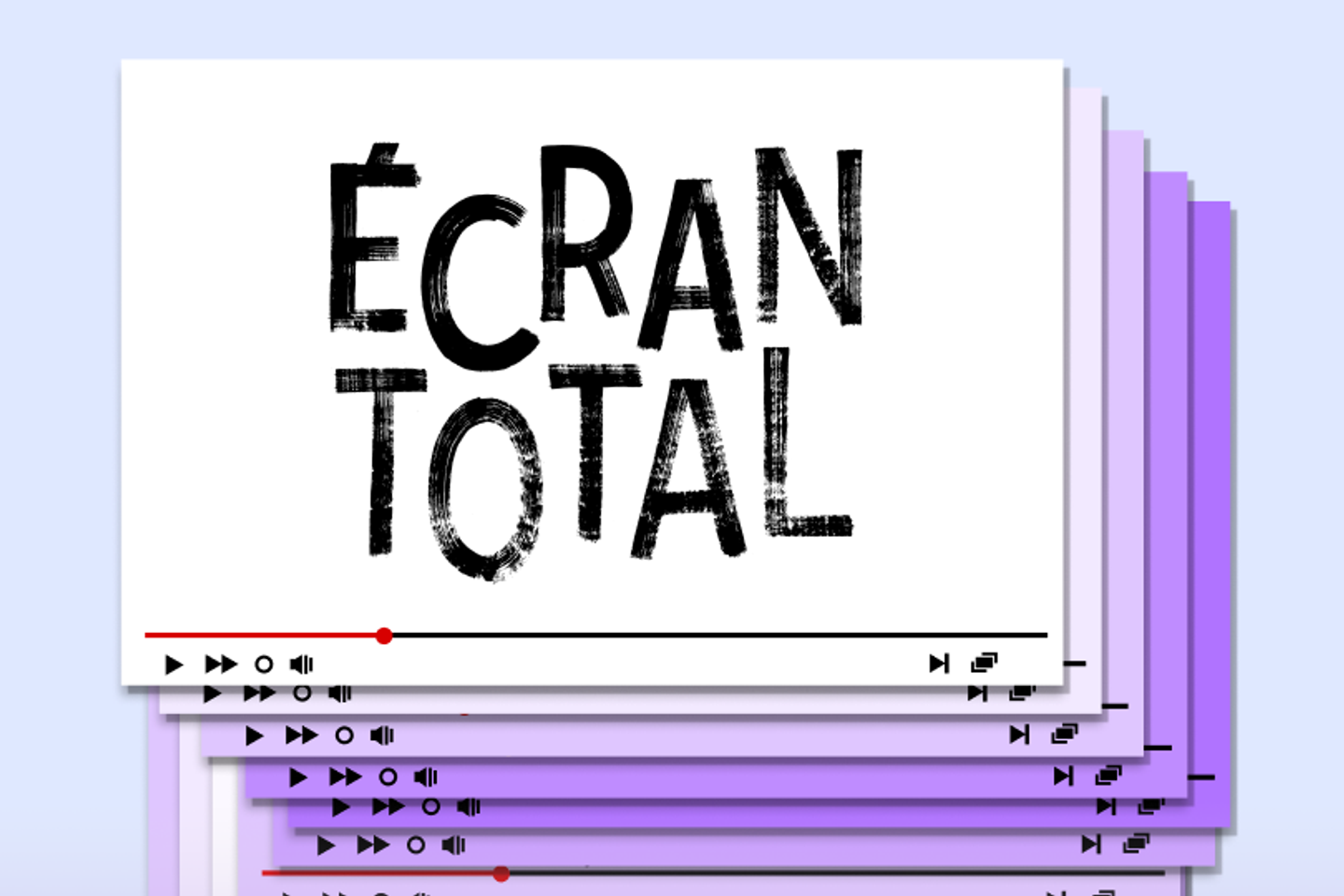Qui a déjà vu un film de Lucrecia Martel se souvient de cette expérience de suintement qui colle le spectateur à l’écran, tel un escargot dans son jus. Qui ne connaît pas son œuvre doit se ruer au Centre Pompidou, à Paris, où a lieu la rétrospective consacrée à la réalisatrice argentine, du 14 novembre au 1er décembre – quatre longs-métrages sur une quinzaine d’années, La cienaga (2001), La niña santa (2004), La Femme sans tête (2008) et Zama (2017), sept courts, un moyen-métrage…
Vite repérée par les grands festivals, la réalisatrice née en 1966, à Salta, est devenue l’une des figures de proue d’un nouveau cinéma argentin, plongeant dans les eaux sales d’un passé toujours présent (populisme, violence, racisme). Les trois premiers longs de Lucrecia Martel, tournés dans la région conservatrice et rurale du nord du pays, à quelques kilomètres de sa maison familiale, sont désignés comme « la trilogie de Salta ».
Dans La cienaga, cerné par une nature sauvage, c’est le bruit d’un verre cassé qui déclenche l’alarme du scénario. Au bord d’une piscine, où l’eau est en train de croupir, une femme alcoolisée lâche son ballon de liqueur et se blesse. Les enfants de la maison, filmés comme un amas de corps agglutinés, se mettent alors en mouvement. Hôpital, voiture… Des bribes de conversations flottent d’une bouche à l’autre, étouffées par le bruit des cigales et des aboiements…
Précision des plans
Est-ce parce que Lucrecia Martel a connu la dictature vers l’âge de 10 ans (« Du sang coulait du coffre des voitures », assure-t-elle) que son œuvre distille une atmosphère d’épouvante ? Dans un stimulant livre d’entretiens et d’analyses, Lucrecia Martel. La circulation, sous la direction de Luc Chessel et d’Amélie Galli (Les Editions de l’œil, 256 pages, 30 euros), la cinéaste parle aussi des histoires morbides transmises par sa grand-mère, qui les terrorisait, elle et ses frères et sœurs ; de ce manque d’intimité dont elle souffrait, dans cette famille nombreuse (qu’elle se mit à filmer à l’adolescence), et du magma des conversations d’adultes dans lequel elle se perdait.
L’hôtel rempli de médecins en séminaire, à la libido débordante, installe un autre climat suffocant, dans La niña santa : Amalia (Maria Alche), adolescente à la moue boudeuse, catholique mystique, vit dans l’auberge avec sa mère, qui en est propriétaire, la séduisante Helena (Mercedes Moran, aux faux airs d’Anna Magnani). Un jour, Amalia subit un attouchement de la part d’un des médecins de l’hôtel, qui lui colle furtivement son sexe sur les fesses.
Il vous reste 64.07% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.