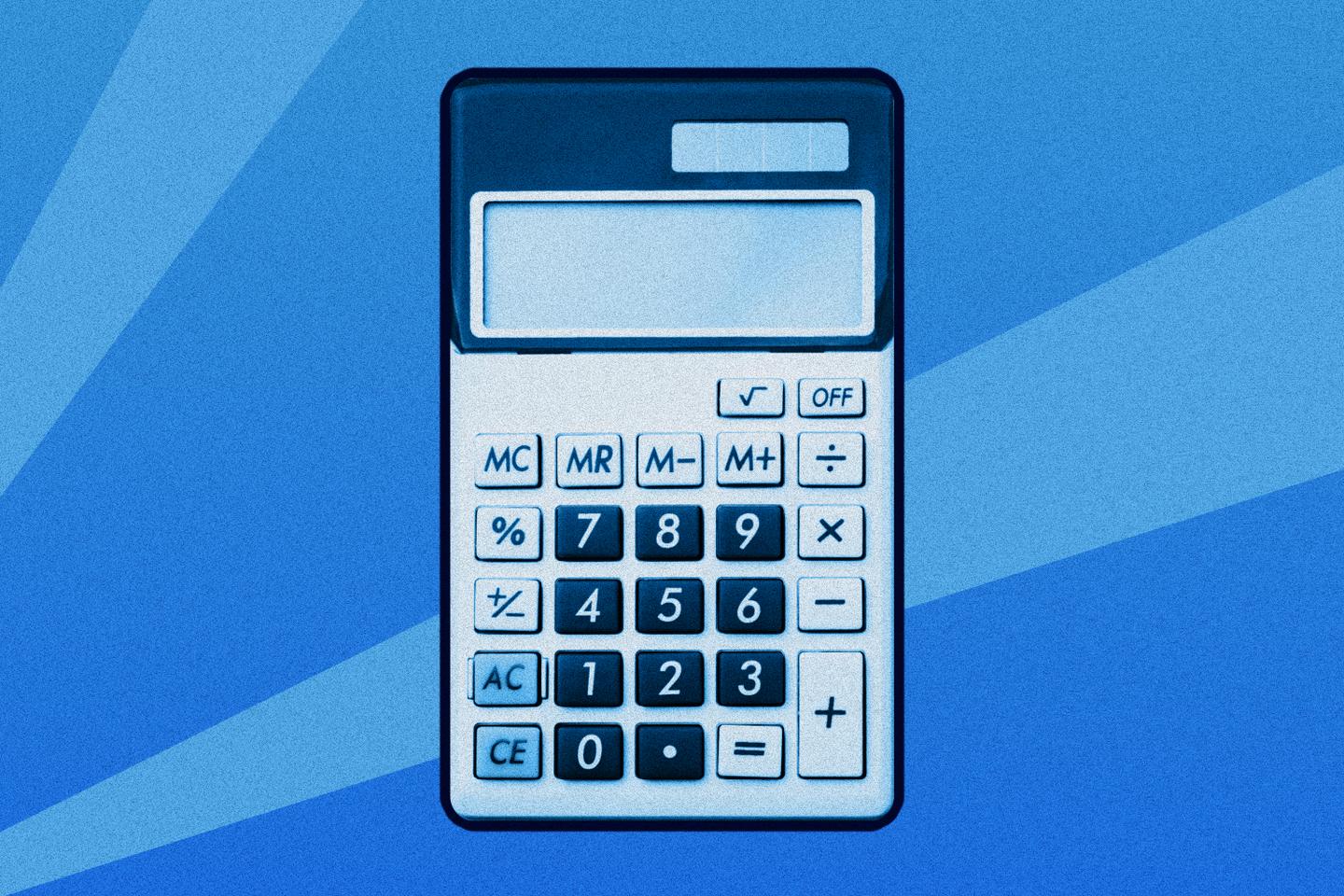Le 17 novembre 2023, la Cour internationale de justice rendait un arrêt ordonnant à l’Azerbaïdjan de garantir sans délai le retour sûr, digne et sans entrave des Arméniens déplacés du Haut-Karabakh, la protection de leurs biens et la préservation de leur patrimoine. Cette décision, prise au nom du droit international, l’emporte sur toute considération politique, traité ou accord bilatéral. Pourtant, deux ans plus tard, elle demeure lettre morte.
Aucune action n’a été engagée pour permettre aux déplacés de regagner leur maison, protéger leurs droits ou documenter l’état des villes et des villages quittés. Les biens et le patrimoine culturel des Arméniens continuent à être détruits, dénaturés ou réattribués dans le Haut-Karabakh, afin d’effacer toute trace de leur présence et de leur mémoire. Cette passivité des instances internationales et des Etats interpelle, surtout à l’heure où la menace pèse sur d’autres populations dans le monde. Va-t-on cautionner par l’inaction ce qui a été clairement qualifié en droit de crime contre l’humanité et d’épuration ethnique ?
Rappelons les faits. Le 19 septembre 2023, après neuf mois d’un blocus total visant à vider la région de ses habitants, l’Azerbaïdjan lançait une offensive militaire décisive dans l’enclave du Haut-Karabakh. En quelques jours, les derniers 120 000 Arméniens du territoire, épuisés par la famine, les privations et le manque de soins, terrifiés par les violences perpétrées contre des civils, furent contraints à l’exil. A ce jour, aucune réponse politique à la hauteur de la gravité du crime n’a été apportée. La réalité des rapports de force ne saurait suspendre l’application du droit international : le droit au retour des habitants du Haut-Karabakh dépasse les considérations géopolitiques et demeure une responsabilité collective reconnue par les conventions internationales.
Confusion entre paix et injustice
Le droit international est clair : l’article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques reconnaît à chacun le droit de rentrer dans son propre pays. Ce droit ne dépend pas d’une nationalité formelle, mais d’un lien profond et durable avec une terre, une culture, une mémoire. Ce droit n’appartient pas aux Etats, mais aux individus. Aucune autorité, par inaction ou renoncement, ne peut en priver ceux qui en sont titulaires.
Il vous reste 55.39% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.