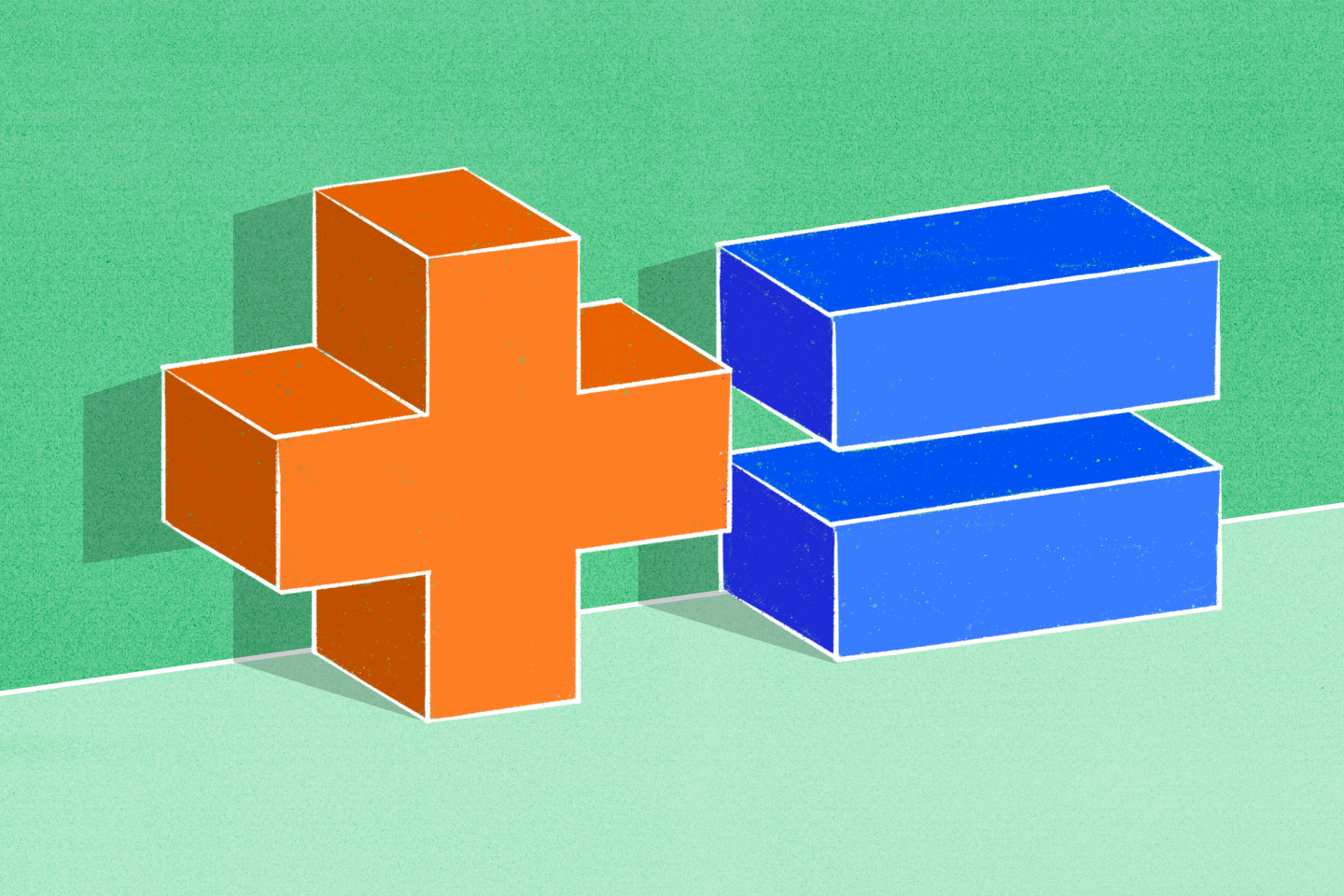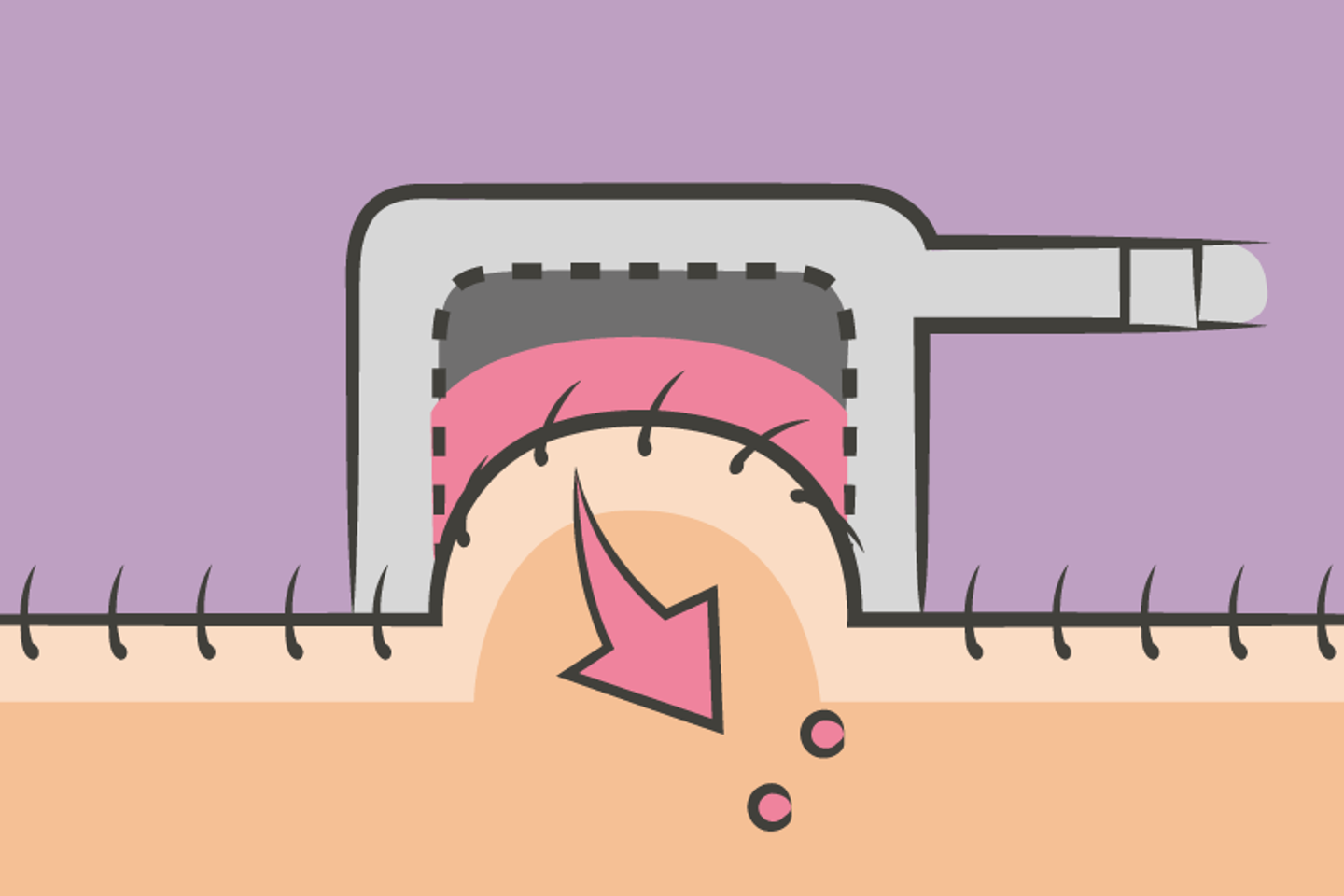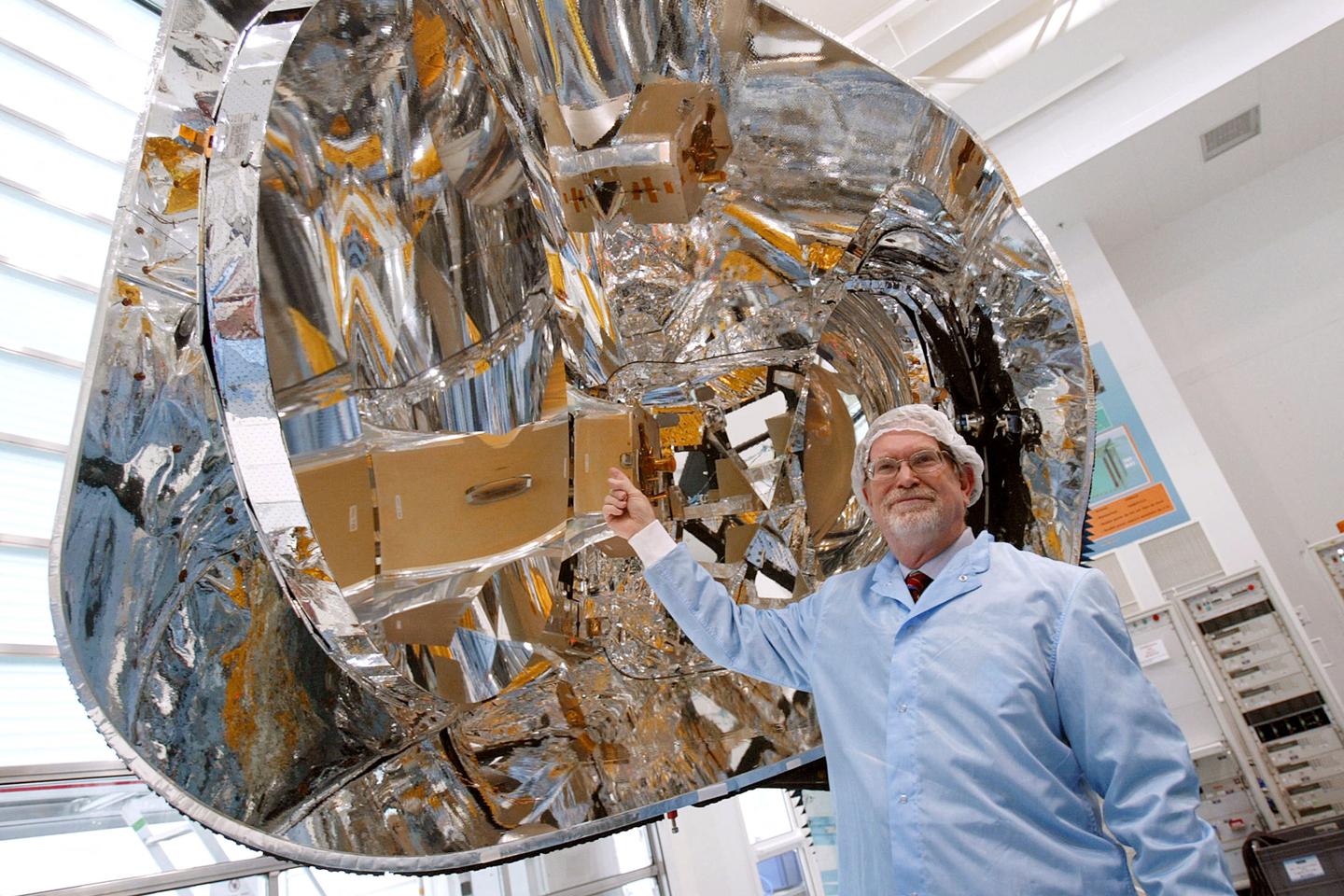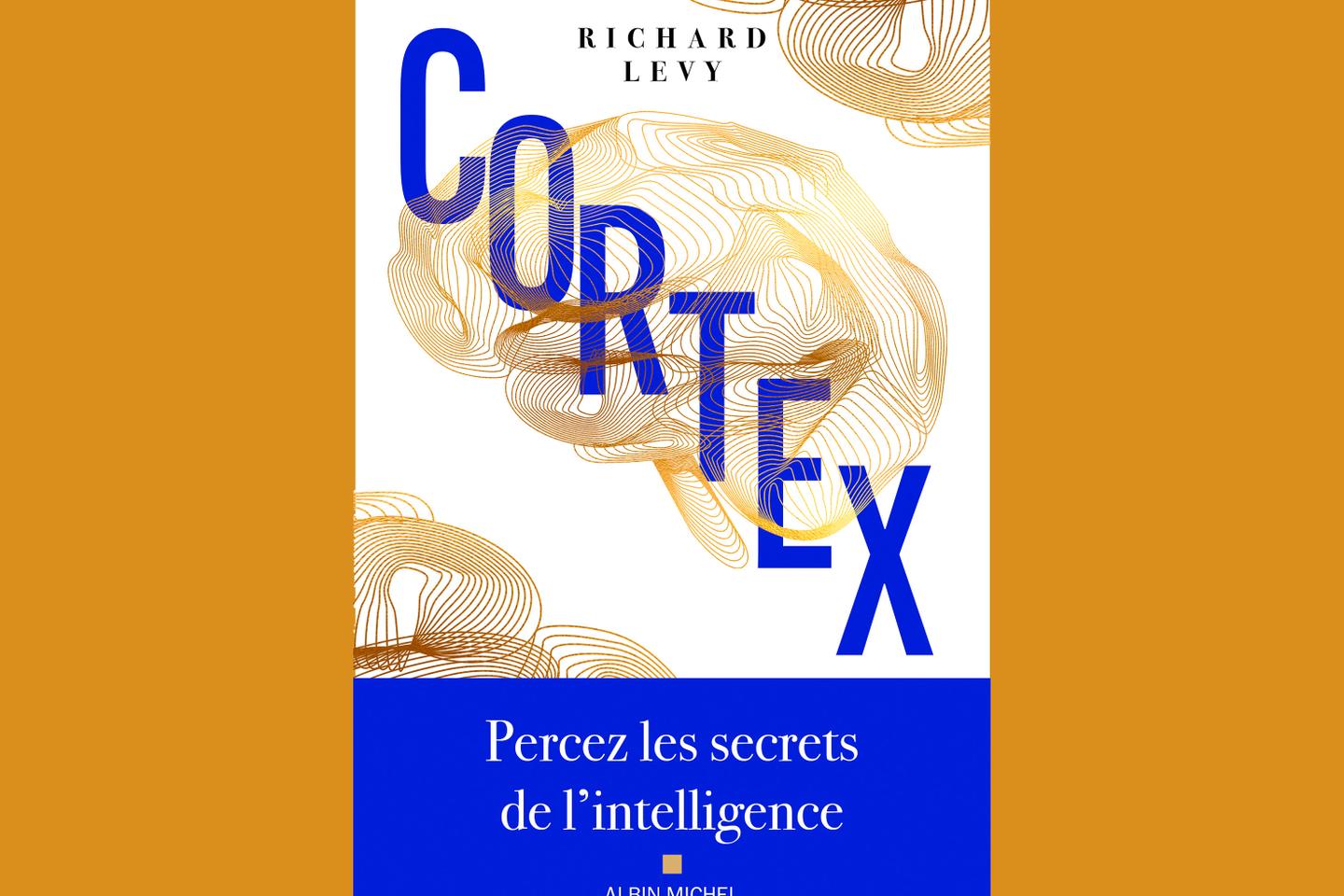C’est l’histoire d’une femme de 117 ans, Maria Branyas Morera, désignée sous le nom de code M116 dans un article publié en ligne le 24 septembre 2025 dans la revue Cell Reports Medicine. Elle a détenu le record de doyenne de l’humanité, officiellement reconnue comme la personne vivante la plus âgée du monde du 17 janvier 2023 jusqu’à son décès, le 19 août 2024, à l’âge de 117 ans et 168 jours.
Née le 4 mars 1907 à San Francisco de parents espagnols, elle s’était installée en Catalogne dès l’âge de huit ans, où elle a vécu toute sa vie. Si les centenaires sont aujourd’hui plus nombreux à travers le monde, les supercentenaires, c’est-à-dire les personnes ayant franchi le seuil des 110 ans, restent une rareté.
À 117 ans, Maria Branyas Morera a dépassé de plus de trente ans l’espérance de vie moyenne des femmes catalanes, qui est de 86 ans. Que nous enseignent ses gènes, son immunité, son métabolisme et son microbiote sur l’extrême longévité humaine ?
L’étude des supercentenaires peut contribuer à mieux comprendre les mécanismes régissant la longévité humaine. Pour explorer les particularités d’une personne d’un âge aussi exceptionnel, les chercheurs ont mené une analyse multi-omique de Maria Branyas Morera, une approche intégrant plusieurs niveaux d’information biologique : analyse ADN, expression génique, métabolites, protéines, microbiote et empreinte épigénétique. Les données du génome, transcriptome, métabolome, protéome, microbiome et épigénome ont été comparées à celles de sujets n’ayant pas dépassé les 110 ans.
Bien que cette recherche repose sur un seul cas, elle révèle un constat majeur : vieillissement extrême et mauvaise santé ne vont pas nécessairement de pair. De plus, ces deux processus peuvent être distingués et étudiés séparément, jusque dans leurs signatures moléculaires.
Pour dresser le portrait biologique de Maria Branyas Morera, les scientifiques ont recueilli des échantillons de sang, de salive, d’urine et de selles, à différents moments. La plupart des analyses ont été réalisées alors qu’elle avait 116 ans et 74 jours.
Une usure extrême des télomères
Parmi les indicateurs biologiques associés au vieillissement, les chercheurs se sont intéressés à la longueur des télomères. Ces structures, situées aux extrémités des chromosomes, jouent un rôle protecteur pour l’ADN. À chaque division cellulaire, elles se raccourcissent progressivement, un peu comme un compteur du temps biologique.
Il a été observé que la longueur moyenne des télomères de Maria Branyas Morera est la plus courte de toutes les personnes saines étudiées. Ainsi, 40 % de ses télomères étaient plus courts que ceux de 80 % de tous les sujets étudiés. Autrement dit, elle présentait une usure extrême de ces structures chromosomiques.
Dans la mesure où la supercentenaire était dans un bon état de santé, les chercheurs avancent l’idée que ses télomères fonctionnaient davantage comme une sorte d’horloge biologique marquant le temps qui passe, plutôt que comme un indicateur annonciateur de maladies liées à l’âge, telles que la neurodégénérescence ou le diabète. Ils émettent aussi l’hypothèse que cette usure considérable des télomères pourrait avoir joué un rôle protecteur contre le cancer, en empêchant d’éventuelles cellules malignes de proliférer, ce qui pourrait expliquer l’absence de cancer diagnostiqué chez elle.
Des variants génétiques rares
Un autre résultat marquant concerne l’ADN de Maria Branyas Morera. Les chercheurs ont identifié chez elle sept variants génétiques très rares, présents dans les deux copies de ses chromosomes (on parle de variants homozygotes). Or, aucun de ces variants n’a été retrouvé dans les génomes de populations européennes utilisées comme contrôle. Cette singularité génétique laisse penser que ces variants ont pu contribuer à sa longévité exceptionnelle.
Les chercheurs de l’Institut de recherche sur la leucémie Josep Carreras (Barcelone) ont ensuite examiné si certains processus biologiques essentiels pouvaient être influencés par les variants rares identifiés dans le génome de Maria Branyas Morera. Ils ont constaté qu’un certain nombre concernait le système immunitaire, avec des fonctions essentielles dans le contrôle des infections, la régulation des maladies autoimmunes et possiblement dans la surveillance anticancéreuse. Ces mécanismes, qui sont au cœur de la longévité, pourraient avoir contribué à limiter l’apparition de maladies.
Des variants ont également été retrouvés dans des gènes liés au métabolisme des lipides et à la fonction cardiaque, ainsi que dans des gènes associés à la neuroprotection, c’est-à-dire à la préservation des fonctions cognitives à un âge très avancé, qui a pu lui être bénéfique. Un autre variant affectait un gène impliqué dans la réparation de l’ADN, un processus critique pour limiter les dommages qui s’accumulent avec le temps et qui influence directement la durée de vie.
Une fonction mitochondriale efficace
Enfin, plusieurs variants touchaient des gènes impliqués dans la fonction mitochondriale. Or, les mitochondries, véritables centrales énergétiques des cellules, produisent de l’énergie par le processus de phosphorylation oxydative, un processus essentiel pour la production d’énergie mais aussi étroitement lié au vieillissement. On sait en effet depuis longtemps que les espèces réactives de l’oxygène (espèces chimiques oxygénées telles que des radicaux libres et les ions péroxydes) issues de la phosphorylation oxydative sont liées au vieillissement.
Les chercheurs ont ensuite testé directement la fonction mitochondriale des cellules sanguines de la supercentenaire. Là encore, le résultat les a surpris : ses mitochondries affichaient non seulement une activité préservée, mais aussi des performances supérieures à celles mesurées chez des femmes plus jeunes, signe d’une fonction énergétique robuste à un âge extrême.
Un génome résilient
Les chercheurs indiquent que le génome de Maria Branyas Morera semble particulièrement « résilient ». Il combine des variants génétiques potentiellement bénéfiques et l’absence de variants délétères, ce qui peut favoriser une vie en bonne santé et une longévité accrue. Parmi ces caractéristiques, certains gènes sont liés à la protection cardiovasculaire, à la neuroprotection, au système immunitaire et à la phosphorylation oxydative mitochondriale, autant de mécanismes connus pour influencer la longévité.
Elle possédait par exemple une version favorable du gène APOE et ne présentait pas de forme délétère de ce gène qui est, au contraire, reliée à une espérance de vie réduite et à des pathologies liées au vieillissement. Cela dit, pour un autre gène associé à la longévité, FOXO3A, elle n’avait pas l’allèle spécifique associé à une durée de vie accrue.
Globalement, ce profil génétique suggère que la longévité exceptionnelle de Maria Branyas Morera ne dépendrait pas d’un seul variant rare, mais plutôt d’une combinaison de plusieurs variants agissant de concert dans différentes voies biologiques, qu’il s’agisse du système immunitaire, de la cardioprotection, de l’activité cérébrale, ou encore du métabolisme énergétique des mitochondries. C’est sans doute cette synergie qui a contribué à sa remarquable longévité.
Pour mieux comprendre les mécanismes biologiques qui ont accompagné cette longévité exceptionnelle, les chercheurs ont examiné son sang en détail.
Mutations liées à l’âge dans des cellules sanguines
La première étape a consisté à rechercher une « hématopoïèse clonale de signification indéterminée » ou « CHIP ». Ce phénomène, lié à l’âge, correspond à l’apparition de populations de cellules sanguines issues d’un clone unique porteur de mutations. Fréquent chez les personnes âgées, il augmente le risque de cancer du sang (hémopathie maligne) ou de maladie cardiovasculaire.
Chez cette femme de 117 ans, trois mutations touchant des gènes connus pour être associés au CHIP ont été identifiées. Pourtant, malgré ces prédispositions génétiques, elle n’a souffert ni de cancer ni de problème cardiovasculaire au cours de sa vie.
On ignore les raisons pour lesquelles certaines personnes avec des mutations CHIP restent en bonne santé, mais cela pourrait tenir à une expansion limitée des clones, à l’absence de survenue de mutations supplémentaires nécessaires pour déclencher une hémopathie maligne, ou encore à une surveillance immunitaire accrue contre des cellules cancéreuses.
Un système immunitaire robuste
Les chercheurs ont utilisé la transcriptomique unicellulaire pour analyser l’ensemble des ARN messagers produits par les gènes d’une cellule à un instant donné. Cette technique a été utilisée pour analyser son système immunitaire, en l’occurrence les sous-populations de globules blancs. Ils ont identifié les principales familles de lymphocytes et ont observé une augmentation marquée des lymphocytes B associés à l’âge (age-associated B cells ou ABC), une sous-population connue pour augmenter avec l’âge et être liée à l’inflammation.
Surtout, au sein des lymphocytes T effecteurs et mémoires, les lymphocytes T cytotoxiques prédominaient. Or, ces globules blancs sont essentiels dans la réponse immunitaire contre les virus et les cancers. L’enrichissement de ce type de cellules immunitaires avait déjà été observé chez d’autres supercentenaires. Par ailleurs, comme attendu du fait de son âge avancé, son système immunitaire montrait aussi une forte augmentation des lymphocytes T sénescents.
Un métabolisme lipidique efficace
Les chercheurs espagnols ont analysé le métabolisme lipidique de Maria Branyas Morera, en le comparant à celui de plus de 6 000 individus. Ils ont observé un métabolisme lipidique exceptionnel, caractérisé par des taux très bas de triglycérides et VLDL-cholestérol (« mauvais cholestérol », impliqué dans le transport des triglycérides et associé à un risque accru de maladie cardiovasculaire) et des niveaux très élevés de HDL-cholestérol (« bon cholestérol »). Par ailleurs, les lipides associés à une mauvaise santé et à une mortalité accrue, comme les acides gras saturés et le cholestérol estérifié, étaient bas, tandis que le cholestérol libre, bénéfique pour la santé et la survie, était élevé.
Un faible niveau d’inflammation
Des marqueurs d’inflammation systémique étaient également très faibles, témoignant d’un faible niveau d’inflammation chronique, en concordance avec un excellent état cardiovasculaire. Quelques métabolites témoignaient toutefois de son âge avancé, comme de faibles taux en certains acides aminés et une augmentation du lactate et de la créatinine.
Selon les auteurs, « ces résultats métabolomiques suggèrent qu’un métabolisme lipidique très actif associé à des niveaux d’inflammation très faibles pourrait expliquer l’excellente santé et la longévité exceptionnelle observées chez cette supercentenaire, malgré des signes de déclin fonctionnel dans d’autres voies biologiques ».
Un détail néanmoins intrigant est venu nuancer ce tableau favorable : la protéine la plus élevée chez cette supercentenaire comparée aux femmes plus jeunes post-ménopausées était la SAA1, habituellement associée à la maladie d’Alzheimer, alors même qu’elle n’a présenté aucun signe de neurodégénérescence.
Les données ont aussi montré une surexpression de certains gènes codant les immunoglobulines G, des molécules clés pour la mémoire immunitaire, renforçant l’idée d’une immunité efficace à un âge extrême.
Ces résultats soulignent une fois encore la coexistence chez cette supercentenaire de mécanismes protecteurs remarquablement actifs avec quelques marqueurs biologiques a priori défavorables, dont elle n’a pourtant pas subi les effets cliniques.

Un microbiote intestinal protecteur
Les chercheurs se sont ensuite intéressés à un autre facteur essentiel de la santé et du vieillissement : le microbiote intestinal, cet écosystème bactérien qui vit dans le tube digestif et influence non seulement la digestion, mais aussi l’immunité, l’inflammation, le cerveau. Pour ce faire, ils ont analysé la composition bactérienne des selles de de Maria Branyas Morera et ont comparé les résultats à ceux de 445 individus contrôles, âgés de 61 à 91 ans.
Résultat surprenant : son microbiote contenait une proportion particulièrement élevée de bactéries de la famille des Bifidobacteriaceae. Or, ces bactéries bénéfiques, connues sous le nom de Bifidobacterium, diminuent généralement avec l’âge. Leur abondance inhabituelle chez une personne de 117 ans rejoint les observations faites chez d’autres centenaires et surtout chez des supercentenaires.
Bifidobacterium est considéré comme une bactérie bénéfique qui participe notamment aux réponses anti-inflammatoires. Une forte teneur en Bifidobacterium est également associée à la production d’acides gras à chaîne courte ainsi qu’à l’acide linoléique conjugué, deux familles de molécules liées à un métabolisme lipidique favorable et à une meilleure santé globale.
Trois yaourts chaque jour
Ce profil bactérien intestinal faisait écho à d’autres observations de l’étude : un état inflammatoire très bas et un métabolisme lipidique exceptionnellement efficace. Un détail de son mode de vie pourrait l’expliquer en partie : Maria Branyas Morera consommait environ trois yaourts chaque jour, contenant notamment Streptococcus thermophilus et Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, connues pour favoriser la croissance des bifidobactéries dans l’intestin. Ce type d’aliment est associé à plusieurs bénéfices métaboliques : réduction du poids corporel, moindre incidence du diabète de type 2, réduction de la masse grasse et de la résistance à l’insuline.
Les auteurs jugent plausible que l’effet bénéfique du yaourt, via la modulation de l’écosystème intestinal, ait contribué au bien-être et à la longévité exceptionnelle de Maria Branyas Morera. Il est cependant impossible de l’affirmer avec certitude car il aurait fallu pour cela un suivi prolongé avec des prélèvements répétés sur plusieurs années.
Au-delà des yaourts, le profil bactérien de la supercentenaire catalane est aussi cohérent avec son adhésion au régime méditerranéen, reconnu pour ses effets protecteurs contre les maladies cardiovasculaires et métaboliques, et qui favorise également la diversité microbienne intestinale. Dans son cas, ce type d’alimentation pourrait avoir contribué à entretenir un microbiote équilibré, soutenant une santé prolongée et une longévité exceptionnelle.
Épigénome
En plus de l’ADN lui-même, les chercheurs se sont intéressés à l’épigénome, c’est-à-dire l’ensemble des marques chimiques portées par l’ADN, qui régulent l’activité des gènes sans modifier leur séquence. Ces marques déterminent si un gène est « allumé » ou « éteint » et évoluent au fil de la vie, en fonction de l’âge, de l’environnement ou du mode de vie. Les chercheurs se sont concentrés sur la méthylation de l’ADN, un marqueur épigénétique largement étudié en biologie du vieillissement.
En analysant plus de 850 000 sites de méthylation, Eloy Santos-Pujol, Aleix Noguera-Castells, Manel Esteller et leurs collègues ont comparé le génome de Maria Branyas Morera à celui de 81 personnes plus jeunes, âgées de 21 à 78 ans. Ils ont identifié 69 sites dont la méthylation était différente, majoritairement moins méthylés que chez les autres individus. Ces différences suggèrent que certaines régions de son ADN étaient plus actives ou mieux régulées, ce qui pourrait favoriser une meilleure santé cellulaire.
Un âge biologique beaucoup plus jeune que son âge réel
Depuis quelques années, les chercheurs utilisent ces marques de méthylation de l’ADN pour construire des « horloges épigénétiques », capables d’estimer l’âge biologique des tissus. En général, l’âge biologique correspond à l’âge chronologique, mais certaines pathologies ou infections virales peuvent l’accélérer.
Dans le cas de Maria Branyas Morera, six horloges différentes ont donné le même résultat frappant : son âge biologique était nettement inférieur à son âge réel, et ce dans les trois types d’échantillons analysés (sang, salive, urine).
Une analyse plus poussée par séquençage complet a confirmé ces résultats : son âge biologique était inférieur de 23 ans à son âge chronologique. En d’autres termes, ses cellules se comportaient comme celles d’une personne beaucoup plus jeune, ce qui fournit une explication supplémentaire à son exceptionnelle longévité.
Faut-il pour autant imaginer que ces découvertes ouvrent la voie à des interventions pharmacologiques susceptibles de prolonger significativement la vie humaine ? À ce stade, rien n’est moins sûr, d’autant que le vieillissement et l’atteinte d’une longévité extrême sont probablement des processus hautement individualisés, façonnés par une confluence de facteurs génétiques, environnementaux et aléatoires. De plus, Il convient de rappeler que toute généralisation à partir d’une étude menée sur un seul individu doit être envisagée avec prudence.
À ce jour, la traduction de ces connaissances pour guider des stratégies favorisant un vieillissement sain et/ou développer des traitements anti-âge efficaces reste un défi majeur.
Comme le soulignent les auteurs, plusieurs pistes sont à l’étude, notamment des molécules qui miment les effets d’une restriction calorique (inhibiteurs de la voie de signalisation cellulaire mTOR ou metformine, un antidiabétique). D’autres approches visent la protection des télomères, ces extrémités des chromosomes qui s’usent avec l’âge et qui, si elles étaient mieux préservées, pourraient ralentir certains processus du vieillissement.
La situation est encore plus complexe pour ce qui est de l’épigénétique, soulignent les chercheurs. Utiliser les agents déméthylants disponibles pour modifier la méthylation de l’ADN pourrait même être contre-productif, car ces traitements, qui ont pour fonction d’enlever des groupes méthyle ajoutés sur certaines bases de l’ADN afin de modifier l’expression des gènes, sont peu sélectifs et risquent de perturber le fonctionnement normal des gènes. Ils sont d’ailleurs conçus avant tout pour lutter contre certains cancers. Cependant, d’autres stratégies de régulation épigénétique, comme certaines modifications des histones (protéines autour desquelles s’enroule l’ADN), méritent d’être explorées.
Santé et longévité dépendent d’un ensemble de facteurs distincts
Maria Branyas Morera n’était pas seulement la doyenne de l’humanité : son organisme a offert aux chercheurs une occasion unique de plonger dans les mécanismes intimes de la longévité.
Plus globalement, les résultats de cette étude multi-omique sur cette femme hors normes suggèrent que la longévité humaine extrême pourrait résulter de la coexistence de deux ensembles de caractéristiques distinctes, potentiellement indépendantes, chez un même individu. D’un côté, on observe des marqueurs typiques d’un âge très avancé. De l’autre, coexistent simultanément des signes protecteurs, préservés au niveau génétique, épigénétique et fonctionnel dans des tissus.
« L’ensemble de ces observations montre que, dans certaines conditions, le vieillissement et la maladie peuvent être découplés, remettant en cause l’idée largement répandue selon laquelle ils seraient intrinsèquement liés », concluent les auteurs. En d’autres termes, cette étude démontre que vieillir très longtemps ne signifie pas forcément vieillir mal.
Pour en savoir plus :
Santos-Pujol E, Noguera-Castells A, Casado-Pelaez M, et al. The multiomics blueprint of the individual with the most extreme lifespan. Cell Rep Med. 2025 Sep 24 :102368. doi : 10.1016/j.xcrm.2025.102368
López-Otín C, Blasco MA, Partridge L, et al. Hallmarks of aging : An expanding universe. Cell. 2023 Jan 19 ;186(2) :243-278. doi : 10.1016/j.cell.2022.11.001. https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(22)01377-0