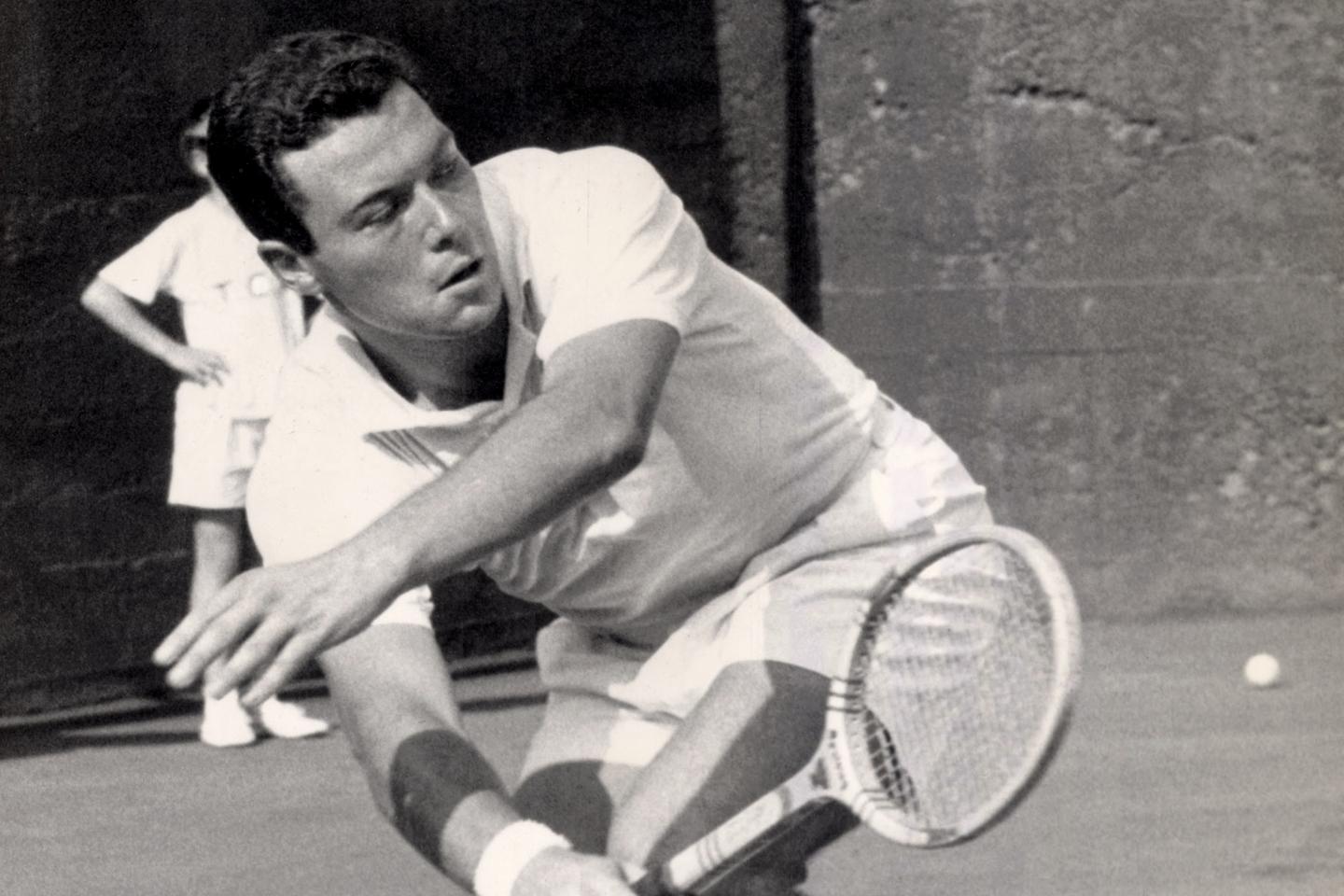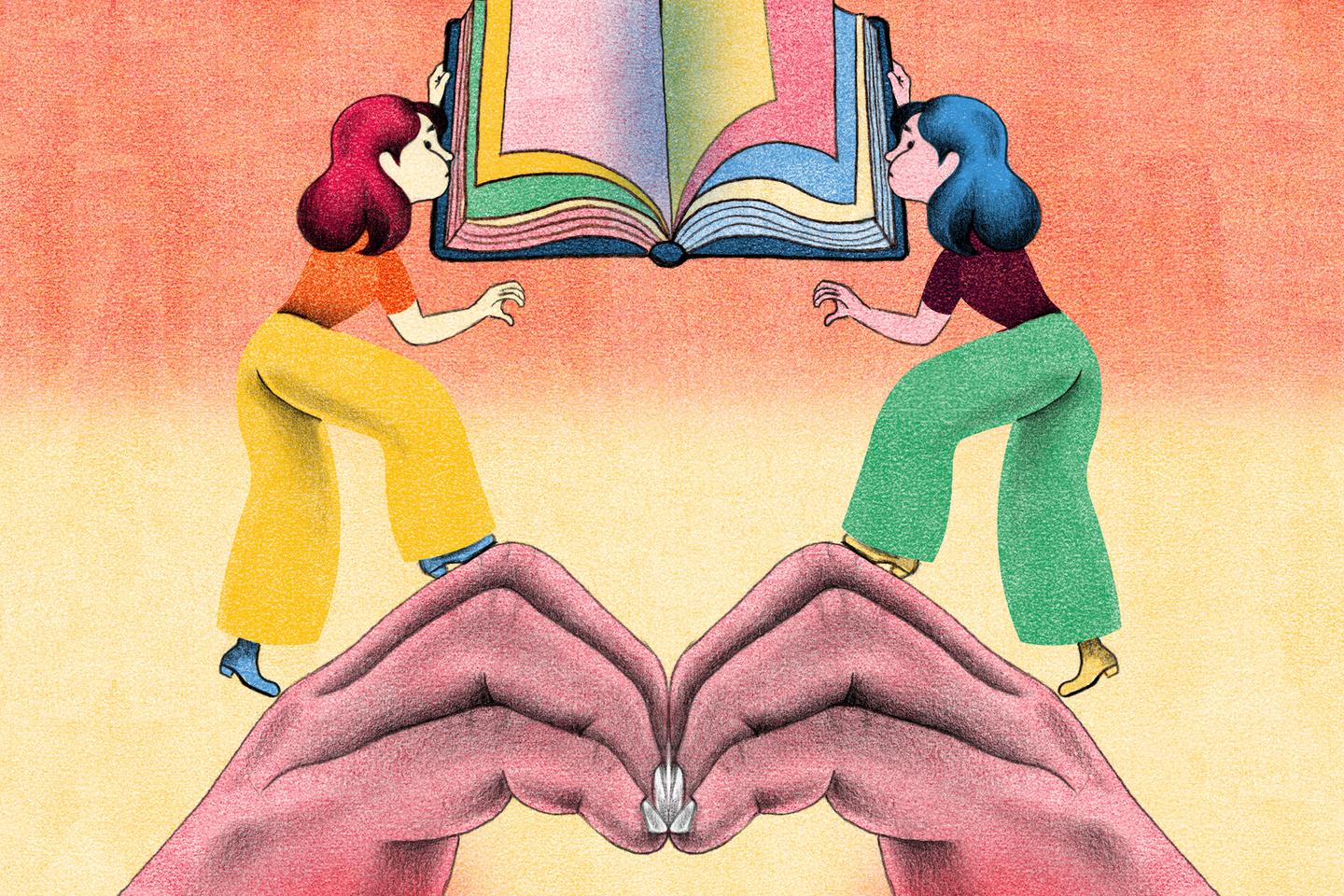Elle échauffe les esprits, déchaîne les passions, relance des guerres que l’on pensait soldées. Longtemps jugée sulfureuse, dénoncée comme pornographique ou perverse au début du XXe siècle, l’éducation à la sexualité des enfants et des adolescents n’en finit pas d’agiter les cours de récréation et l’arène politique.
Cette « question “chaude” », selon le titre du livre de l’historien Yves Verneuil (Peter Lang, 2023), qui en a retracé le cheminement tourmenté, s’est progressivement fait une place dans les classes, mais reste un point de crispation pour les milieux conservateurs religieux et d’extrême droite populiste. Car, au carrefour de la biologie et du culturel, de l’intime et du relationnel, elle n’a cessé de questionner le rôle de l’Etat et ses limites éducatives. En témoignent les récentes polémiques autour du programme d’éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité (Evars), engagé en 2023 par Pap Ndiaye, alors ministre de l’éducation nationale, et lancé en cette rentrée après avoir été repoussé et remanié à la suite de contestations et de rumeurs.
De fait, les objectifs et les contenus de cet enseignement ont évolué selon les époques. De la répression de la débauche à la promotion de l’épanouissement personnel, de la transmission des savoirs biologiques à la prévention des violences sexistes et sexuelles, des enjeux démographiques et sanitaires aux luttes contre les discriminations et pour l’égalité des droits, ses mutations témoignent des transformations profondes de la société en matière de sexualité et d’égalité, et du rôle qu’y ont joué les crises sanitaires et les luttes d’émancipation. Elles racontent aussi l’évolution des oppositions qui les ont inlassablement freinées et les reconfigurations des rapports de force entre les institutions religieuses et le pouvoir politique.
Il vous reste 88.99% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.