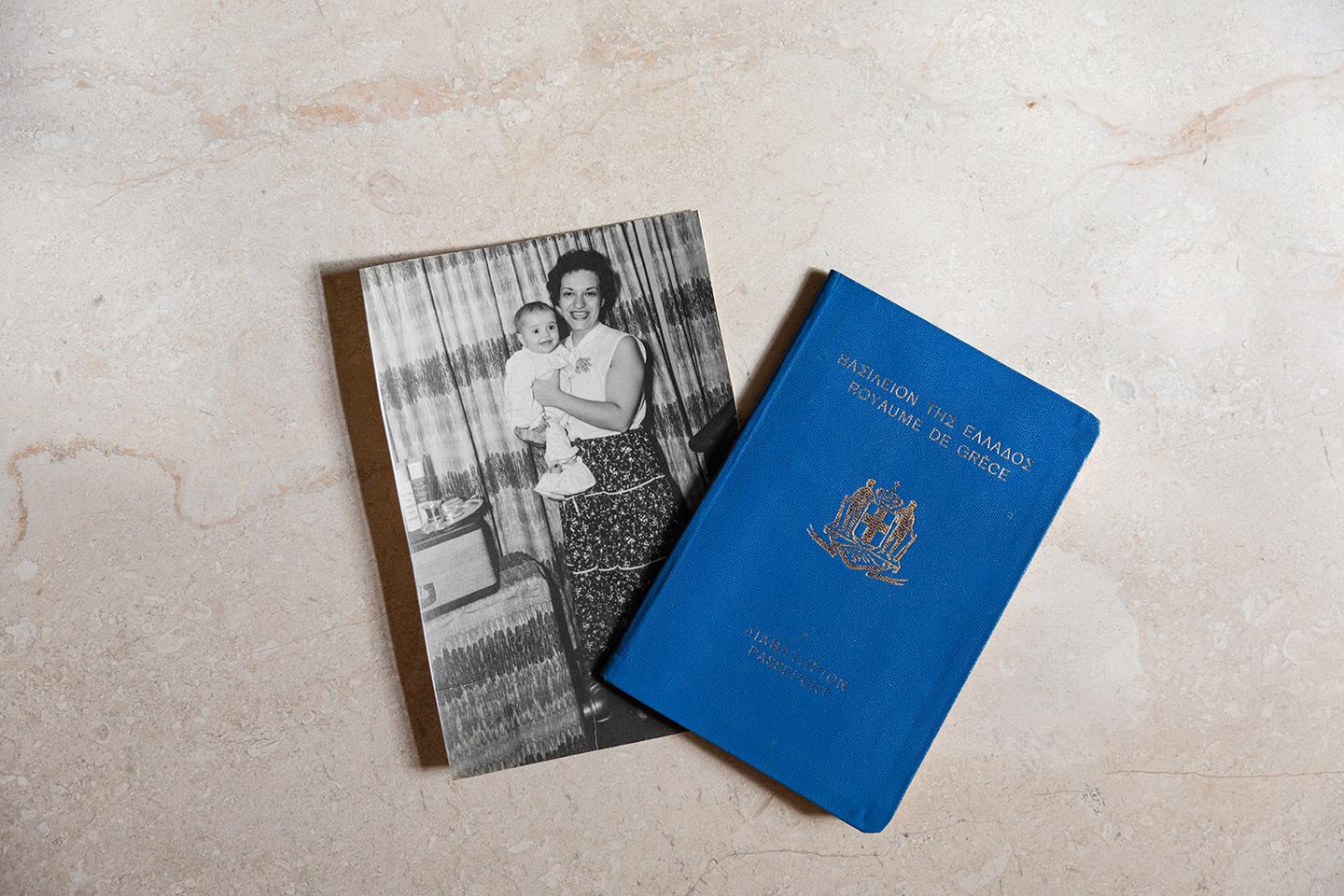La guerre en cours à Gaza depuis près de six cents jours s’accompagne de polémiques d’une virulence inouïe, notamment sur la définition même de ce conflit. Le gouvernement israélien et ses partisans considèrent que la qualification de « génocide » relève de l’antisémitisme, alors que certaines organisations de défense des droits humains l’ont reprise à leur compte, Amnesty International dénonçant à Gaza un « génocide en direct ».
Les débats sur ce sujet sont très agités dans le monde universitaire, y compris en Israël, où deux spécialistes de l’histoire de la Shoah estiment que, « même sans Auschwitz à Gaza, il s’agit bien d’un génocide ». Les termes d’« urbicide » et de « scolasticide » ont aussi pu être employés pour désigner la destruction méthodique du tissu urbain, d’une part, et du système d’enseignement, d’autre part.
Les controverses sont d’autant plus vives que la guerre contre Gaza se traduit par une troublante inversion du langage, l’armée israélienne revendiquant son bilan « humanitaire », malgré la banalisation des traitements inhumains contre la population locale.
Selon la Cour internationale de justice, Israël n’a jamais cessé, depuis 1967, d’être à Gaza la « puissance occupante », même après le retrait, en 2005, de son armée et de ses colons, et ce du fait du « contrôle des frontières » de l’enclave palestinienne. Ce « contrôle » s’est mué en blocus après la prise du pouvoir par le Hamas à Gaza, en 2007. L’armée israélienne avait alors conçu un « modèle » allouant à chaque habitant une ration quotidienne de 2 279 calories (2 784 pour les hommes, 2 162 pour les femmes et 1 758 pour les enfants).
Il vous reste 71.28% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.