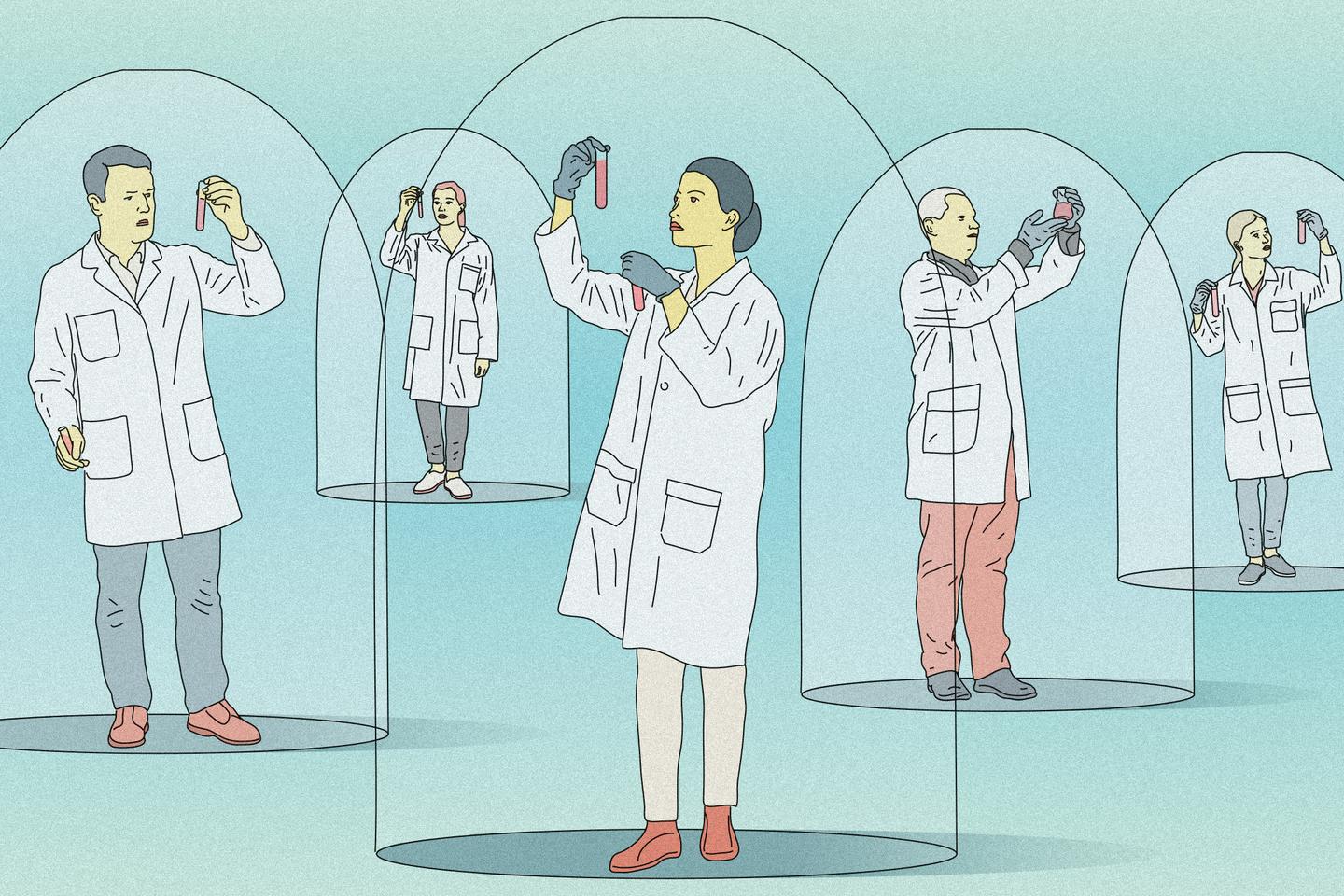En 2022, la France a utilisé 563 primates non humains pour la recherche fondamentale et appliquée (hors réutilisations des animaux), contre 144 en Allemagne et 174 au Royaume-Uni. Or si l’on se réfère au nombre de publications dans le domaine biomédical, ces deux pays dépassent très nettement la France (selon la revue Nature). Cette surconsommation de primates par rapport à nos voisins ne semble donc apporter aucun avantage sur le plan scientifique.
Pourtant, en juillet 2024, le CNRS a lancé un appel d’offres dans le cadre des marchés publics pour la construction d’un centre national de primatologie sur la commune du Rousset (Bouches-du-Rhône), non loin de Marseille. La durée de la construction est estimée à cinquante-huit mois pour un budget de 30 millions d’euros hors taxes, auquel il faudrait ajouter les futurs et importants frais de fonctionnement. Ce centre est censé accueillir « à terme » 1 740 primates, ce qui permettrait de répondre à 40 % de la demande de la recherche académique française pour pallier une prétendue « pénurie ».
Un tel objectif paraît démesuré. Faisons un rapide calcul : 40 % du nombre actuel de primates utilisés annuellement dans la recherche fondamentale et appliquée représentent 225 animaux. Pourquoi donc envisager d’élever 1 740 primates pour une « production » annuelle d’environ 200 animaux ? D’autant que nous parlons d’un avenir de huit à dix ans. D’ici là les méthodes non animales, en plein essor, auront considérablement progressé et la société, déjà largement opposée à l’expérimentation animale aujourd’hui, le sera plus encore. Soit le CNRS envisage un accroissement des utilisations de primates dans la recherche académique dans les années à venir, soit il envisage de les vendre à des utilisateurs privés ou à d’autres utilisateurs européens.
Dans un cas comme dans l’autre un tel projet est contraire aux objectifs de la directive européenne 2010/63/UE relative à la protection des animaux à des fins scientifiques. On lit en effet dans son considérant 10 qu’elle représente une étape importante vers « l’objectif final que constitue le remplacement total des procédures appliquées à des animaux vivants à des fins scientifiques et éducatives, dès que ce sera possible sur un plan scientifique ». Et dans le considérant 17 : « (…) l’utilisation de primates non humains préoccupe au plus haut point les citoyens. Il y a donc lieu de n’autoriser l’utilisation de primates non humains que dans les domaines biomédicaux essentiels à la santé humaine, pour lesquels il n’existe encore aucune méthode alternative. »
Il vous reste 56.42% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.