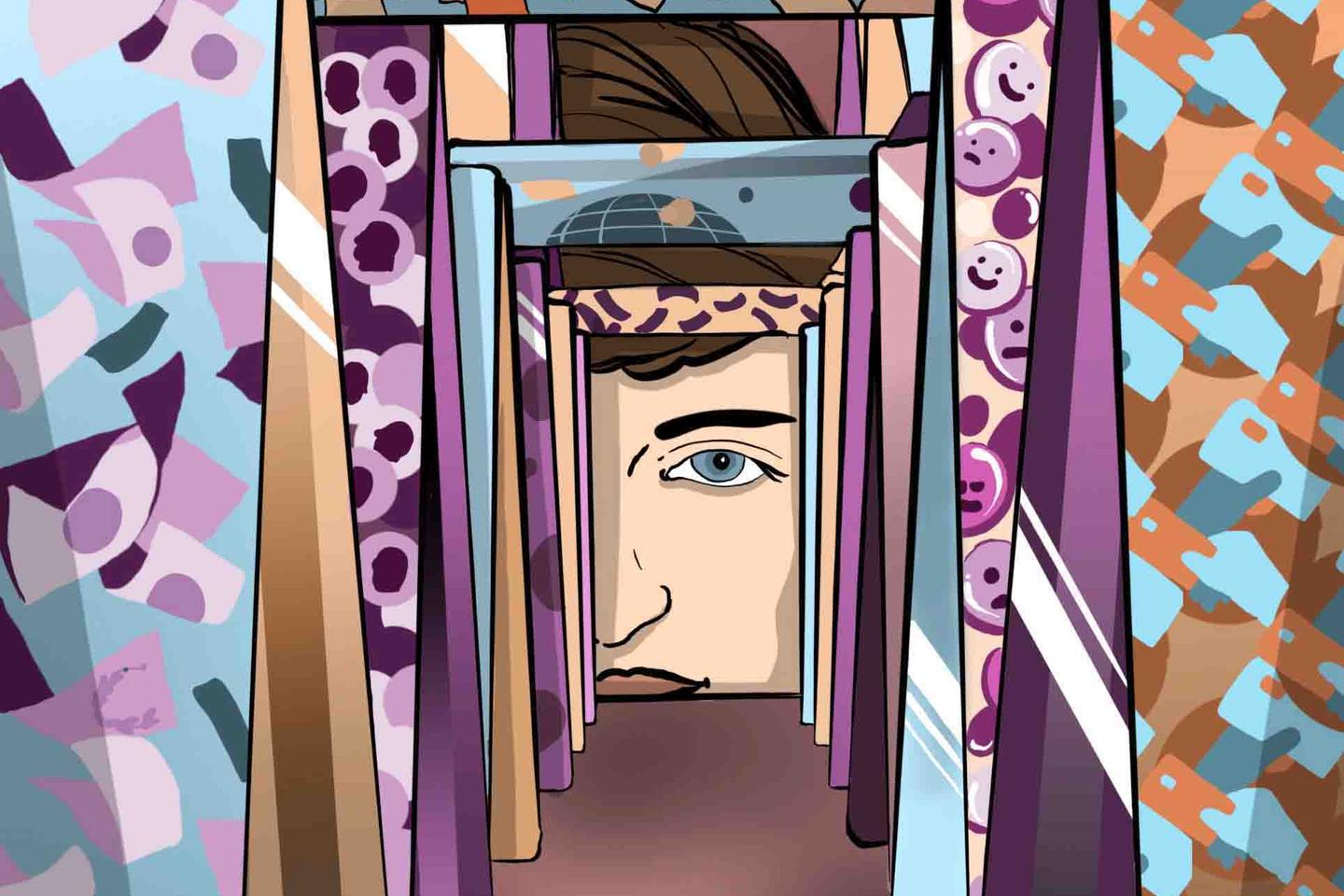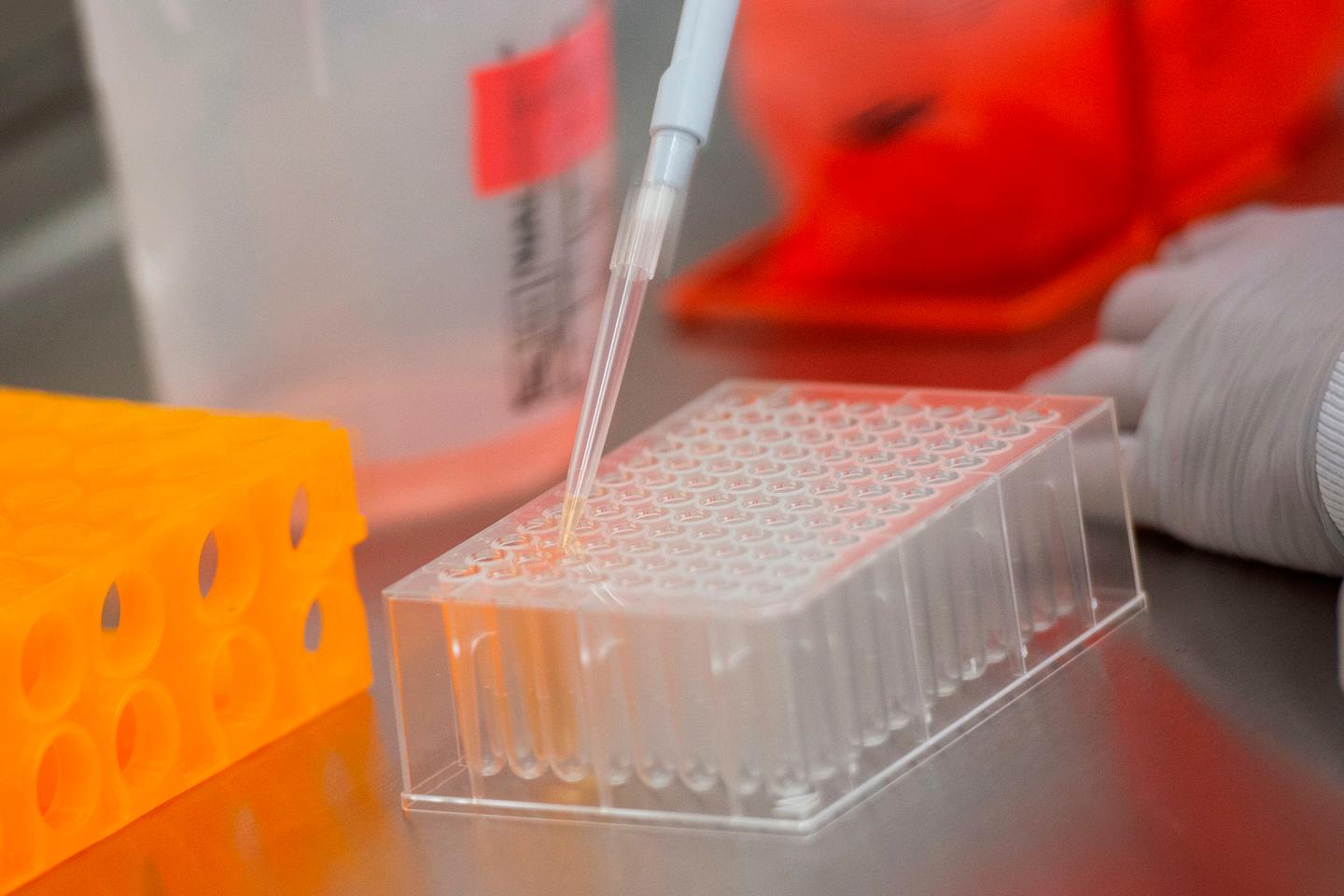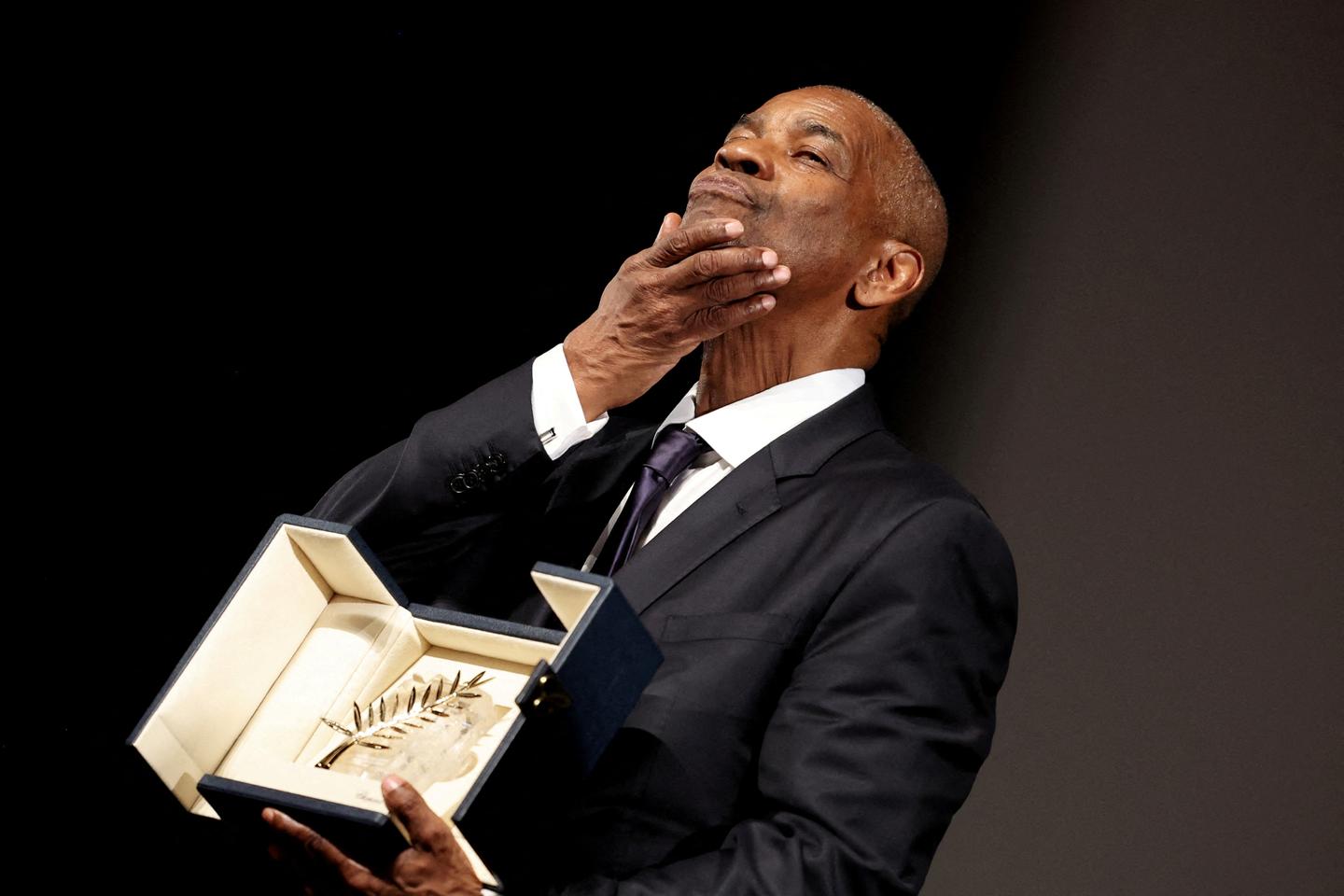Lorsque, six ans plus tôt, elle décrochait son baccalauréat mention très bien et intégrait la prestigieuse faculté de médecine de Tunis, Molka Berrebah était loin d’imaginer qu’elle exercerait dans de telles conditions. Salaires dérisoires, pénurie de personnel et de matériel, retards de paiements… L’hôpital public tunisien ne fait pas de cadeaux aux nouveaux venus. En tant qu’interne – l’année intermédiaire qui correspond à la dernière année d’externat en France –, l’étudiante de 24 ans enchaîne les gardes à un rythme effréné.
Variables d’ajustement d’un système de santé à bout de souffle, les jeunes médecins sont corvéables à merci. En stage au service d’orthopédie de l’hôpital Charles Nicolle de Tunis, Molka Berrebah doit gérer, avec les résidents de garde – l’équivalent des internes en France –, l’ensemble du service. La chambre de repos ne dispose que de trois lits, puisque, théoriquement, seuls deux résidents et un interne sont censés y travailler. Mais, pour faire tourner le service, jusqu’à cinq résidents peuvent parfois assurer la garde, dont trois ne sont pas reconnus par l’Etat et ne sont donc pas rémunérés.
« C’est intenable, on nous pousse à partir », déplore la jeune femme, engagée depuis 2024 auprès de l’Organisation tunisienne des jeunes médecins (OTJM). Jeudi 15 mai, une nouvelle réunion s’est tenue entre l’OTJM et des représentants du ministère de la santé pour débloquer la situation. En vain. D’après un communiqué de l’organisation, le ministère invoque des raisons « administratives et de bureaucratie » pour expliquer le temps de latence.
Face à cette impasse, les jeunes médecins brandissent désormais la menace d’une grève de cinq jours dès le 1er juillet qui, si elle devait avoir lieu, paralyserait le fonctionnement des hôpitaux publics, portés à bout de bras par les résidents et les internes. « On va aussi boycotter le choix des postes de stage, ce qui signifie qu’il n’y aura plus de résidents à l’hôpital dès le mois de juillet », prévient Baha Eddine Rabaï, vice-président de l’OTJM.
Un premier débrayage a eu lieu le 2 mai. Selon l’organisation, la grève a été suivie par plus de 93 % des étudiants en médecine (externes, internes et résidents). Plusieurs centaines d’entre eux ont manifesté le jour même devant le ministère de la santé. Après ses 24 heures de garde, malgré la fatigue, Molka Berrebah était en première ligne, décidée à « se battre pour rester en Tunisie », affirme-t-elle.
Exil massif
Chaque année, depuis 2021, entre 1 300 et 1 500 médecins quittent le pays pour exercer à l’étranger. Ils étaient plus de 1 400 en 2024 et environ 1 500 en 2023, selon Nizar Laâdhari, secrétaire général du Conseil de l’Ordre des médecins. Une moyenne annuelle qui dépasse désormais largement le nombre de nouveaux diplômés, estimé à 800 personnes chaque année, selon un rapport de l’Institut tunisien des études stratégiques (ITES), de mars 2024.
Au total, environ 6 000 médecins ont quitté la Tunisie au cours des quatre dernières années, dont une très grande majorité de jeunes praticiens. Un décompte auquel il faudrait ajouter les résidents qui choisissent de poursuivre leur spécialité à l’étranger, relève Baha Eddine Rabaï, vice-président de l’OTJM. Selon ce dernier, pour la seule année 2024, plus de 1 600 étudiants ont quitté la Tunisie afin d’achever leur formation.
Restez informés
Suivez-nous sur WhatsApp
Recevez l’essentiel de l’actualité africaine sur WhatsApp avec la chaîne du « Monde Afrique »
Rejoindre
D’après plusieurs études, du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) et de l’ITES, les diplômés qui choisissent l’exil partent massivement vers la France, l’Allemagne, la Suisse, le Canada, le Qatar et les Etats-Unis. Pourtant, souligne le récent rapport de l’ITES, 78 % des médecins qui ont émigré seraient prêts à retourner en Tunisie, à condition que leurs conditions de travail et leurs rémunérations s’améliorent.
Ces revendications qui font écho à celles portées par l’Organisation tunisienne des jeunes médecins, qui réclame notamment une revalorisation des rémunérations des internes et des résidents, sans avancer de montant. « Nous ne sommes pas encore à ce stade de négociation avec le ministère », précise Baha Eddine Rabaï, son vice-président.
Une garde à deux dinars de l’heure
Le montant des primes de gardes est particulièrement discuté. Aujourd’hui, il s’élève à 48 dinars bruts (14 euros) pour 18 heures de garde. Une fois déduits les frais de repas, ceux de l’entretien de la chambre de repos ou encore de la blouse, le montant net perçu par le médecin tombe à 36 dinars (11 euros). Pour une garde de 24 heures, le montant net s’élève à 40 dinars (12,30 euros). « Ça fait environ 2 dinars de l’heure, c’est de l’exploitation », s’indigne Molka Berrebah. Deux dinars de l’heure qui, du reste, peuvent mettre des années à être versés. « J’ai de la chance, je n’ai qu’un retard de trois mois pour le moment », ironise l’étudiante.
Les externes, entre la première et la cinquième année, ne sont pas non plus épargnés. Bien qu’ils ne soient pas tenus d’assurer des gardes, ils sont souvent contraints de le faire, sans rémunération, ni repas, ni prise en charge de leur transport. « Certains n’ont pas forcément les moyens de se déplacer, surtout quand l’hôpital est éloigné. Mais eux aussi risquent de voir leur stage invalidé s’ils montrent la moindre réticence », déplore Molka Berrebah. En tant qu’interne, cette dernière perçoit un salaire mensuel de 1 500 dinars (460 euros), qui pourra grimper à 1 900 dinars (580 euros), au terme de ses onze à douze années d’études, lors de sa dernière année de résidanat.
« Aucun moyen à disposition »
Une fois la thèse validée et le titre de médecin spécialiste obtenu, le parcours du combattant se poursuit. Pour pouvoir exercer en Tunisie – ou même partir travailler à l’étranger – les jeunes diplômés doivent obligatoirement effectuer une année de service civil, équivalent d’un service militaire, dans des hôpitaux de régions souvent délaissées. Envoyés dans des déserts médicaux, loin de leurs proches, ils touchent une prime mensuelle allant de 750 à 1 250 dinars (230 à 380 euros), sans couverture sociale.
« Avec cette prime dérisoire, après douze ans d’études, tu dois te débrouiller pour te loger et te nourrir. A cet âge, certains médecins ont déjà une famille, c’est très difficile. Dans ces régions, les habitants sont heureux d’avoir enfin des spécialistes, mais en réalité, il n’y a aucun moyen à disposition. Sans scanner, sans équipements de base, tu passes ton temps à faire des lettres de liaison pour transférer les patients vers d’autres hôpitaux », souligne Molka Berrebah.
La refonte du service civil, instauré en 2010, temporairement supprimé en 2011 avant d’être réintroduit en 2014, est l’une des principales revendications des jeunes médecins. L’OTJM demande d’en être exempté dans certains cas et souhaite une rémunération supérieure, ainsi que la prise en charge de certains frais. Concernant les stages, l’OTJM propose la mise en place de critères d’évaluation transparents, comme l’assiduité ou la réalisation d’un certain nombre d’interventions médicales ou de gardes prédéfinies. Ils sont, pour l’instant, laissés à l’appréciation exclusive des chefs de service. Une situation qui, selon l’organisation, place les étudiants dans une position de dépendance et de précarité, les obligeant à accepter toutes les demandes de disponibilité de leurs supérieurs.